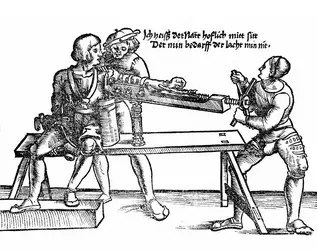RENAISSANCE
La pensée
Espace culturel clos et ouverture anthropologique
L'époque de la Renaissance n'échappe pas à l'oscillation dialectique, qui prend parfois l'aspect d'oppositions irréductibles, entre un système du savoir et une philosophie de la transcendance. Le couple Platon-Aristote marque indubitablement, dans ce champ de gravitation culturelle, l'une des lignes de partage entre les esprits : Jean Bessarion (env. 1402-1472) contre Georges de Trébizonde dans la seconde moitié du Quattrocento, Pietro Pomponazzi (1462-1525) et les autres « Padouans » aristotéliciens contre les « lecteurs royaux » hellénistes de Paris vers le milieu du xvie siècle, Ramus (Pierre de La Ramée, 1512-1572) contre l'enseignement aristotélico-scolastique de nombreux collèges de la seconde moitié du siècle. Toutes questions passionnelles ou contingences historiques écartées, les fidèles d'Aristote, philosophes, pédagogues ou théologiens, se recrutaient plutôt parmi les partisans d'un totalitarisme culturel où tous les éléments du savoir, la totalité des espèces animales ou végétales, les valeurs sociopolitiques ou éthico-religieuses, et la représentation du cosmos lui-même s'inscrivaient dans un espace clos et hiérarchisé, qualitativement et éternellement déterminé, comme les sphères du monde supracéleste, tournant indéfiniment au-dessus du monde humain et terrestre, soumis à la probabilité, sinon à l'incertitude. En associant l'homme concret à des responsabilités plus personnelles, en l'axant davantage sur des problèmes d'éthique individuelle, en privilégiant la recherche de la vérité par rapport à l'acquisition de certitudes, en pratiquant, par la maïeutique socratique, une révolution pédagogique où le dialogue serait à la fois une interrogation sur le savoir et un instrument de découverte des autres et de soi-même, le « divin » Platon apprenait à la génération d'un Pic de La Mirandole ou d'un Marsile Ficin, à celle d'un More, d'un Vivès ou d'un Érasme, au Montaigne des Essais ou au Campanella de La Cité du Soleil le dynamisme créateur de l'homme. Et pourtant ? L'aristotélisme antichrétien et averroïste de Pomponazzi n'a guère de rapport avec l'aristotélisme thomiste ou scotiste de certains théologiens de Louvain ou avec celui de Lefèvre d'Étaples, et l'on aurait du mal à déceler une homologie quelconque de pensée entre les platonisants de Florence et les utopistes-urbanistes des cités communistes ou libertaires. C'est qu'à la vérité la dimension éthico-existentielle, qui ménage à l'esprit humain une ouverture pour aller plus loin, une possibilité indéfinie de contestation ou de remise en question, et la fermeture de la pensée sur un bilan culturel déterminé ne dessinent pas aussi schématiquement les frontières entre les hommes, les œuvres, les écoles, les arts ou les sciences. Rien ne me paraît également aussi caractéristique de l'esprit de la Renaissance que cette volonté, exprimée en de multiples textes, symboles ou actions, d'une conciliation – ou réconciliation – d'Aristote et de Platon : on a reconnu ici l'une des entreprises majeures de Pic, l'auteur du Discours sur la dignité de l'homme, l'un des promoteurs et des illustrateurs de l'humanitas et des humaniores litterae. Conciliation de Platon et d'Aristote, certes. Mais aussi, pour Marsile Ficin le platonicien, accomplissement d'un programme téméraire : celui de l'insertion de la philosophie, ou plutôt de la théologie, de Platon dans un christianisme qui exaltera l'homme pour la plus grande gloire de Dieu. Si l'on regarde enfin la célèbre fresque de L'École d'Athènes de Raphaël, et que l'on examine le titre des ouvrages respectivement tenus par Platon[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Eugenio BATTISTI : professeur à l'université de Florence et à la Pennsylvania State University, membre de l'Institute for the Arts and Humanities
- Jacques CHOMARAT : professeur à l'université de Paris-IV
- Jean-Claude MARGOLIN : professeur de philosophie à l'université de Tours, directeur du département de philosophie et histoire de l'humanisme au Centre d'études supérieures de la Renaissance, Tours
- Jean MEYER : professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de Rennes
Classification
Pour citer cet article
Eugenio BATTISTI, Jacques CHOMARAT, Jean-Claude MARGOLIN et Jean MEYER. RENAISSANCE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
ABSOLUTISME
- Écrit par Jacques ELLUL
- 4 286 mots
Comme tous les concepts à plusieurs dimensions (ici politique, historique, juridique, doctrinal), le concept d'absolutisme est assez flou. Son étude présente trois sortes de difficultés portant sur l'objet lui-même.
La première difficulté tient à ce que l'on désigne généralement par ce...
-
ACADÉMIES
- Écrit par Nathalie HEINICH
- 5 952 mots
L'académie telle qu'elle se développe à partir du Quattrocento italien, dans le grand mouvement de retour à l'Antiquité qui caractérise la Renaissance, est inspirée du modèle grec de l'akademia (le jardin où enseignait Platon). Elle s'épanouit dans toute l'Europe à l'âge...
-
L'ADOLESCENCE CLÉMENTINE, Clément Marot - Fiche de lecture
- Écrit par Yvonne BELLENGER
- 905 mots
L'Adolescence clémentine paraît en 1532 et rassemble les textes de jeunesse du poète. Le recueil frappe par sa diversité. Dans son souci de jouer de toute la gamme du langage, Marot est l'héritier des grands rhétoriqueurs, mais c'est aussi un contemporain des humanistes, un poète de...
-
LES AMOURS, Pierre de Ronsard - Fiche de lecture
- Écrit par Yvonne BELLENGER
- 884 mots
Le titre Les Amours désigne chez Ronsard une série de publications qui vont de ses débuts littéraires à la fin de sa vie. Célébrant Cassandre, Marie, puis Hélène, il invente un lyrisme qui renouvelle la poésie amoureuse.
- Afficher les 137 références
Voir aussi
- PORTRAIT, peinture, jusqu'au XVe s.
- PORTRAIT, sculpture
- PAYSAGE, peinture, jusqu'au XVe s.
- RENAISSANCE ITALIENNE PEINTURE DE LA, XVe s.
- RENAISSANCE ITALIENNE PEINTURE DE LA, XVIe s.
- EUROPE, histoire
- GLACIS, peinture
- IMPÔT, histoire
- BANQUE HISTOIRE DE LA
- LATINE CHRÉTIENNE LITTÉRATURE
- FLORENCE
- ARMÉE, histoire
- FLAMANDE PEINTURE
- ARTISTE
- PLACE, architecture
- TOUCHE, peinture
- PEINTURE TECHNIQUES DE LA
- DOUANES
- ÉTAT-CITÉ
- AGRICOLE RÉVOLUTION MÉDIÉVALE
- COMMANDITAIRES D'ART
- CLIMATIQUES VARIATIONS
- ESPAGNE, histoire : XVIe et XVIIe s.
- RENAISSANCE ARTS DE LA
- ITALIE, histoire, de 1494 à 1789
- ART THÉORIE DE L'
- LATINE LANGUE
- REPRÉSENTATION DANS L'ART
- FRANCE, histoire, du XVIe s. à 1715
- SPHÈRE ARMILLAIRE
- ICONOLOGIE
- CIVILE ARCHITECTURE
- MARCHÉ DE L'ART
- NÉO-LATINE LITTÉRATURE
- RENAISSANCE SCULPTURE DE LA
- RENAISSANCE ARCHITECTURE DE LA
- RENAISSANCE PEINTURE DE LA
- BRUNI LEONARDO (1370-1444)
- MARULLE MICHEL MAROULOS dit TARCHANIOTE (1453 env.-1500)