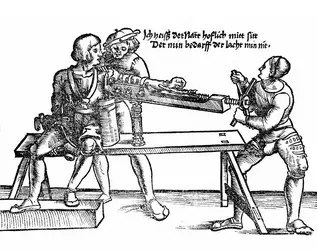RENAISSANCE
André Chastel faisait remarquer un jour que la Renaissance était la seule période de l'histoire qui se fût donné un nom dès les premières manifestations de son essence (les humanistes italiens du Quattrocento parlaient déjà de Rinascità), et Alphonse Dupront commençait un célèbre article intitulé « Espace et humanisme » en identifiant la Renaissance à une idée ou à un mythe spécifique de force, de création, de jeunesse. On ne s'attardera pas ici, après tant d'autres, à examiner l'état actuel d'un problème historique qui, depuis Michelet et Burckhardt, a suscité tant de controverses et de prises de position. Donnera-t-on au mot « Renaissance », du point de vue d'une histoire totale, la signification que lui attribue Jean Delumeau, à savoir « la promotion de l'Occident à l'époque où la civilisation de l'Europe a de façon décisive distancé les civilisations parallèles » ? Ou bien, sous prétexte que la continuité entre le Moyen Âge et la Renaissance se révèle dans tant de domaines de la vie sociale, économique, politique, parlera-t-on, comme on le faisait il y a une quinzaine d'années, d'un « crépuscule de la Renaissance », d'une Renaissance Dämmerung, en problématisant le terme à l'instar de ceux de maniérisme ou de baroque ? Comme on prouve le mouvement en marchant, Chastel démontrait, dans un colloque sur la Renaissance en 1956, le caractère infiniment original de l'esthétique et du développement des arts des xve et xvie siècles européens ; de son côté, le médiéviste M. Mollat insistait sur l'élargissement du champ de l'économie propre aux « marchands » du xvie siècle, tout en montrant que leur dynamisme expansionniste était pondéré par une inquiétude religieuse et métaphysique, alimentée aux sources vives de la morale scolastique ; enfin, troisième volet du triptyque, la notion d'État confrontée à l'idée de la Renaissance permettait à F. Chabod de définir une « modernité » de l'État centralisateur dont le xvie siècle présente plus qu'une ébauche, avec des traits encore accentués par l'idéal du cortegiano, et qui représente un dépassement du débat spécifiquement médiéval entre la « grâce » et la « dévotion » appliqué aux affaires politiques.
Ce qu'il y a de certain, pour le propos de cet article, c'est que les intellectuels de la Renaissance, en Italie d'abord, puis dans l'Europe tout entière, se pensent eux-mêmes, comme ils pensent l'homme et le monde, en termes de rupture et non de continuité. Certes, on se rend mieux compte aujourd'hui de tout ce que la pensée de l'humanisme chrétien doit à la devotio moderna et aux mystiques flamands du xve siècle, et l'on aurait du mal à comprendre le sens de l'individuel ou de la « variété des choses » d'un Jérôme Cardan sans remonter à l'« école de Paris » du xive siècle, au nominalisme d'Occam, de Buridan ou d'Oresme, à l'examen critique de la proposition d'Aristote : « Il n'y a de science que du général. » Mais ces filiations ou cet enracinement médiévaux, comme l'admiration si souvent proclamée et éprouvée pour la pensée antique, ne doivent pas dissimuler ce qu'on appellerait volontiers les grandes mutations intellectuelles de la Renaissance ou, reprenant l'expression hardie d'Eugenio Garin, une révolution culturelle. « La Renaissance, écrit-il avec force, ne prend une signification adéquate au terme que sur le terrain de la culture : elle est, avant tout, un fait de culture, une conception de la vie et de la réalité, qui imprègne les arts, les lettres, les sciences, les mœurs. »
Retenant le terme plus général, et peut-être plus vague, de pensée, de préférence à celui de philosophie (ou de philosophies,[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Eugenio BATTISTI : professeur à l'université de Florence et à la Pennsylvania State University, membre de l'Institute for the Arts and Humanities
- Jacques CHOMARAT : professeur à l'université de Paris-IV
- Jean-Claude MARGOLIN : professeur de philosophie à l'université de Tours, directeur du département de philosophie et histoire de l'humanisme au Centre d'études supérieures de la Renaissance, Tours
- Jean MEYER : professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de Rennes
Classification
Pour citer cet article
Eugenio BATTISTI, Jacques CHOMARAT, Jean-Claude MARGOLIN et Jean MEYER. RENAISSANCE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
ABSOLUTISME
- Écrit par Jacques ELLUL
- 4 286 mots
Comme tous les concepts à plusieurs dimensions (ici politique, historique, juridique, doctrinal), le concept d'absolutisme est assez flou. Son étude présente trois sortes de difficultés portant sur l'objet lui-même.
La première difficulté tient à ce que l'on désigne généralement par ce...
-
ACADÉMIES
- Écrit par Nathalie HEINICH
- 5 952 mots
L'académie telle qu'elle se développe à partir du Quattrocento italien, dans le grand mouvement de retour à l'Antiquité qui caractérise la Renaissance, est inspirée du modèle grec de l'akademia (le jardin où enseignait Platon). Elle s'épanouit dans toute l'Europe à l'âge...
-
L'ADOLESCENCE CLÉMENTINE, Clément Marot - Fiche de lecture
- Écrit par Yvonne BELLENGER
- 905 mots
L'Adolescence clémentine paraît en 1532 et rassemble les textes de jeunesse du poète. Le recueil frappe par sa diversité. Dans son souci de jouer de toute la gamme du langage, Marot est l'héritier des grands rhétoriqueurs, mais c'est aussi un contemporain des humanistes, un poète de...
-
LES AMOURS, Pierre de Ronsard - Fiche de lecture
- Écrit par Yvonne BELLENGER
- 884 mots
Le titre Les Amours désigne chez Ronsard une série de publications qui vont de ses débuts littéraires à la fin de sa vie. Célébrant Cassandre, Marie, puis Hélène, il invente un lyrisme qui renouvelle la poésie amoureuse.
- Afficher les 137 références
Voir aussi
- PORTRAIT, peinture, jusqu'au XVe s.
- PORTRAIT, sculpture
- PAYSAGE, peinture, jusqu'au XVe s.
- RENAISSANCE ITALIENNE PEINTURE DE LA, XVe s.
- RENAISSANCE ITALIENNE PEINTURE DE LA, XVIe s.
- EUROPE, histoire
- GLACIS, peinture
- IMPÔT, histoire
- BANQUE HISTOIRE DE LA
- LATINE CHRÉTIENNE LITTÉRATURE
- FLORENCE
- ARMÉE, histoire
- FLAMANDE PEINTURE
- ARTISTE
- PLACE, architecture
- TOUCHE, peinture
- PEINTURE TECHNIQUES DE LA
- DOUANES
- ÉTAT-CITÉ
- AGRICOLE RÉVOLUTION MÉDIÉVALE
- COMMANDITAIRES D'ART
- CLIMATIQUES VARIATIONS
- ESPAGNE, histoire : XVIe et XVIIe s.
- RENAISSANCE ARTS DE LA
- ITALIE, histoire, de 1494 à 1789
- ART THÉORIE DE L'
- LATINE LANGUE
- REPRÉSENTATION DANS L'ART
- FRANCE, histoire, du XVIe s. à 1715
- SPHÈRE ARMILLAIRE
- ICONOLOGIE
- CIVILE ARCHITECTURE
- MARCHÉ DE L'ART
- NÉO-LATINE LITTÉRATURE
- RENAISSANCE SCULPTURE DE LA
- RENAISSANCE ARCHITECTURE DE LA
- RENAISSANCE PEINTURE DE LA
- BRUNI LEONARDO (1370-1444)
- MARULLE MICHEL MAROULOS dit TARCHANIOTE (1453 env.-1500)