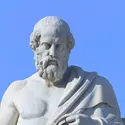PLATON (env. 428-env. 347 av. J.-C.)
L'un, l'être et le non-être
L'un et l'être
La participation signifie que, en l'absence de l'unité que lui communique sa Forme, une chose sensible se pulvériserait en une quantité indéfinie de qualités toutes singulières, donc indicibles. Mais la pensée dialectique n'a que les Formes pour objets. Elles ne sont pensables qu'à la condition de ne pas être des entités massives et fermées sur elles-mêmes. Penser une Forme, c'est s'appliquer à saisir la pluralité interne de ses espèces et la déterminer à l'aide d'autres Formes. Chacune d'entre elles doit donc présenter des articulations naturelles permettant de la diviser, et s'articuler à certaines Formes tout en en excluant d'autres. Or, contre la position de cette double pluralité s'élève la parole du vénérable Parménide énonçant que l'être est un et d'un seul tenant. Platon lui laisse, dans Parménide, l'honneur d'explorer les hypothèses concernant l'unité, et, en fait, de se réfuter lui-même. Si l'un est absolument un, il repousse toute espèce de multiplicité, sensible ou intelligible. Il ne peut alors recevoir aucune détermination, et même pas exister, puisque l'attribution de l'être à l'un présuppose leur dualité. L'un ne peut rester un qu'en se séparant de tout le reste : il est par conséquent inconnaissable, informulable, innommable. Cependant, le discours est capable d'énoncer cette impossibilité de dire, et il faut reprendre l'hypothèse pour rendre compte de cette possibilité-là. Si l'un est, s'il s'accommode de l'être, il se scinde en un-qui-est et en être-un, si bien que « deux indéfiniment s'engendre ». L'un n'est plus une pure unité, c'est une totalité possédant limite et figure. Comme cette totalité a son unité propre, c'est du même coup trois qu'on pose, et toute la suite des nombres ordinaux et cardinaux. L'existence de l'un engendre les nombres, et à partir d'eux les choses sensibles. Au long d'un temps ordonné et indéfiniment progressif, l'unité ne cesse de se multiplier, et la multiplicité de s'unifier sous l'effet de la limitation extrinsèque des nombres qui empêchent la genèse du divers de se poursuivre jusqu'à l'illimité. De l'un qui n'est qu'un, il n'y a ni science, ni opinion, ni sensation. La connaissance de l'un-qui-est est celle d'une multiplicité homogène qu'il est possible d'unifier sous une unité (un nombre) elle-même homogène à ses éléments. À partir de cette connaissance mathématique peuvent s'élaborer toutes les sciences de la nature. Pourtant, le temps n'est pas seulement principe d'ordre et d'accumulation : il est aussi changement qualitatif. Un mode du temps échappe à l'alternative du mouvement et du repos car il est l'intervalle entre les deux : c'est le changement pur, l'instantané. Il introduit le négatif dans le monde, il en interrompt la genèse en n'entrant ni dans les sommes ni dans les continuités effectuées. L'instant est ce par quoi l'un, relativement, n'est pas. Ce qui veut dire que n'existe que du multiple. En l'absence de l'un, chaque chose pourra offrir à un « regard émoussé et lointain » une apparence d'identité et d'unité, alors qu'elle n'est en réalité qu'un amas. Le discours aura tout pouvoir pour décomposer et recomposer à son gré, faire apparaître et disparaître ces fantômes d'unité. L'être réduit à une poussière d'apparences, le discours capable d'en disposer comme il lui plaît : on reconnaît le monde du sophiste. Mais si l'un n'est absolument pas, si n'existe même plus ce simulacre d'unité, rien n'est. Cet abîme de [...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Monique DIXSAUT : professeur à l'université de Paris-I
Classification
Pour citer cet article
Monique DIXSAUT. PLATON (env. 428-env. 347 av. J.-C.) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
LE BANQUET, Platon - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 992 mots
- 1 média
Sans doute le plus connu des dialogues platoniciens, Le Banquet (Sumpósion) ou Sur l'amour, rédigé vers 375 avant notre ère – soit, comme La République, Le Phédon et Le Phédre, durant la période dite de la maturité de Platon (428 env.-347 env. av. J.-C.) – demeure un texte énigmatique....
-
PHÉDON, Platon - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 989 mots
- 1 média
-
PHÈDRE, Platon - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 918 mots
Écrit vers 370 avant J.-C., le Phèdre (Phaidros) marque le point culminant de la polémique (implicite) de Platon (428 env.-347 env. av. J.-C.) à l'égard d'Isocrate, l'auteur de Contre les sophistes (parmi lesquels il incluait les platoniciens) et fondateur d'une école de ...
-
LA RÉPUBLIQUE, Platon - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 822 mots
- 1 média
« J'étais descendu, hier, au Pirée avec Glaucon, fils d'Ariston » (ce dernier n'est autre que le père de Platon). Ainsi commence La Républiquede Platon (428 env.-347 env. av. J.-C.) – en grec Politeia, « Du régime politique », ou Peri dikaiou, « Sur la justice » –,...
-
THÉÉTÈTE, Platon - Fiche de lecture
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 1 122 mots
- 1 média
Probablement rendu public en 370 av. J.-C. (mais cette date n’est pas certaine), le Théétète occupe une place particulière dans l’œuvre de Platon. Consacré à une définition de la science, il inaugure ce que la plupart des commentateurs considèrent comme le troisième volet des dialogues...
-
ACADÉMIE ANTIQUE
- Écrit par Jean-Paul DUMONT
- 1 376 mots
- 1 média
-
ACTEUR
- Écrit par Dominique PAQUET
- 6 815 mots
- 2 médias
...jetés. L'acteur sera pour la Grèce antique cet animal mimétique qui, grâce à la parole poétique, menace de contamination la cité. Contamination dont Platon pose les prémisses dans le dialogue du Ion : « Quand je déclame un passage qui émeut la pitié, dit Ion, le rhapsode d'Homère, mes yeux se remplissent... -
AFFECTIVITÉ
- Écrit par Marc RICHIR
- 12 228 mots
-
ÂGE DE LA TERRE
- Écrit par Pascal RICHET
- 5 143 mots
- 5 médias
...Zénon de Cittium (~335-~264), le premier stoïcien. La question la plus importante, celle de l’origine du monde, ne fut bien sûr pas laissée de côté. Dans la grandiose cosmologie de son dialogue le Timée, Platon affirma que le monde avait connu un début : il lui attribua comme auteur un démiurge... - Afficher les 169 références
Voir aussi
- IMMORTALITÉ
- ORDRE DU MONDE
- REPRÉSENTATION & CONNAISSANCE
- PARTICIPATION, philosophie
- OPINION, philosophie
- CHOSE-EN-SOI
- PROTAGORAS D'ABDÈRE (485-411 av. J.-C.)
- CAVERNE MYTHE DE LA
- SENSIBLE
- ANTIQUE PHILOSOPHIE
- DION DE SYRACUSE (409-354 av. J.-C.)
- DENYS II LE JEUNE, tyran de Syracuse (397-344 av. J.-C.)
- COSMOLOGIES, philosophie
- SAVOIR
- GRECQUE PHILOSOPHIE
- PRINCIPE
- MAÏEUTIQUE
- PLURALITÉ, philosophie
- INSTANT
- MULTIPLICITÉ, philosophie
- GENRE, logique
- IDÉES THÉORIE DES
- SIMULACRE
- PRÉSOCRATIQUES PHILOSOPHES
- SOPHISTES
- EXISTENCE, philosophie
- NON-CONTRADICTION
- PHILOSOPHIE POLITIQUE