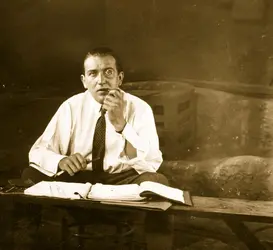CINÉMA (Aspects généraux) Histoire
Le parlant : les années 1930
En Amérique
Le règne des « producers »
Le cinéma muet avait su compenser son infirmité foncière par un surcroît de sensibilité et d'invention. Mais il ne pouvait se passer plus longtemps de la parole et du son. La mise au point technique du parlant ne fut pas déterminante, puisque les premiers essais concluants du synchronisme entre l'image et le son avaient été réalisés en 1919. À l'époque, les producteurs et les distributeurs d'un cinéma muet florissant avaient purement et simplement négligé l'invention. Guettés par la faillite en 1927, les frères Warner jouèrent cette dernière carte. Ce fut Le Chanteur de jazz, dont le succès bouleversa de fond en comble l'industrie et l'art cinématographiques. Toute résistance s'avéra bientôt inutile. Les cinéastes qui avaient porté l'art muet à son apogée durent se plier à la technique sonore, ou se retirer. La loi d'airain du succès entraîna de bien cruelles déchéances : la retraite de D. W. Griffith, l'élimination progressive de Buster Keaton et de Harry Langdon, le départ d'Eric von Stroheim pour l'Europe, où il devait poursuivre sa carrière de comédien.
Mais déjà, à Hollywood, la formidable machine industrielle s'organisait en vue de nouvelles conquêtes. L'invention du doublage permettait à nouveau l'exportation des films. Les grandes sociétés affirmaient leur emprise sur la production, la distribution, l' exploitation (concentration verticale). « Les pionniers bottés ont fait place aux financiers à lunettes, écrira plus tard René Clair. C'est par une sorte de superstition que l'on continue de nommer les réalisateurs et les écrivains d'un film américain. À quelques exceptions près, leurs signatures ne signifient guère rien de plus que celles qui figurent sur les billets de banque. »
Une telle sévérité ne résiste pas à la vision des films. Lorsque les exceptions se nomment Ernst Lubitsch, Josef von Sternberg, Howard Hawks, King Vidor, Leo Mac Carey, George Cukor, Fritz Lang, pour ne citer que les plus grands, on ne peut qu'admirer une fois de plus la puissance créatrice d'Hollywood.
Certes, le cinéma parlant a grandement contribué à établir le producer, gardien de l'efficacité et des conventions, dans ses prérogatives contraignantes. Mais on oublie que cet intermédiaire entre l'art et l'argent, entre le réalisateur (director) et la hiérarchie financière de la compagnie, est souvent un homme de goût, voire de talent : Joseph L. Mankiewicz, par exemple, le futur réalisateur de Chaînes conjugales (A Letter to ThreeWives, 1948), et de La Comtesse aux pieds nus (The Barefoot Contessa, 1954), restera huit ans producer à la Metro-Goldwyn-Mayer ; c'est lui qui produira en 1936 le premier film américain de Fritz Lang, Furie. D'une manière générale, les grands studios imposent aux réalisateurs et aux auteurs un contrat strict, mais honnête : celui d'un spectacle à réussir. Il s'agit d'abord de plaire et de toucher. Le public, roi, jouit alors d'un très grand respect.
Malice et gravité. Lubitsch et Sternberg
La nécessité commerciale n'est nullement avilissante, comme en témoignent les comédies de Lubitsch et les mélodrames de Josef von Sternberg. Lubitsch (1892-1947) a réalisé ses premiers films en Allemagne dès 1915, puis il s'est expatrié en Amérique en 1922. Très vite, il s'est imposé comme un réalisateur à succès. Il produit ses propres films : L'Éventail de Lady Windermere (Lady Windermere's Fan, 1925) ; Le Prince étudiant (The Student Prince in Old Heidelberg, 1927). Né à Vienne, Sternberg débute à Hollywood en 1925. Il est un des maîtres de l'art muet : Les Nuits de Chicago (1927) ; Les Damnés de l'océan (The Docks of New York, 1928). Il se[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Marc CERISUELO : professeur d'études cinématographiques et d'esthétique à l'université de Paris-Est-Marne-la-Vallée
- Jean COLLET : docteur ès lettres, professeur à l'université de Paris-V-René-Descartes, critique de cinéma
- Claude-Jean PHILIPPE : journaliste
Classification
Pour citer cet article
Marc CERISUELO, Jean COLLET et Claude-Jean PHILIPPE. CINÉMA (Aspects généraux) - Histoire [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
ACTEUR
- Écrit par Dominique PAQUET
- 6 815 mots
- 2 médias
Aux débuts du cinéma, l'acteur ne paraît pas un instant différent de l'acteur de théâtre. Car ce sont les mêmes qui, dans les premiers films de Méliès, interprètent les textes classiques. De même, dans le cinéma expressionniste, la technique de monstration et de dévoilement de l'expression appartient... -
AFRICAINS CINÉMAS
- Écrit par Jean-Louis COMOLLI
- 1 131 mots
L'histoire des cinémas africains se sépare difficilement de celle de la décolonisation. Il y eut d'abord des films de Blancs tournés en Afrique. Puis, à partir des années soixante, les nouveaux États africains ont été confrontés au problème de savoir quel rôle, quelle orientation, quels...
-
ALLEMAND CINÉMA
- Écrit par Pierre GRAS, Daniel SAUVAGET
- 10 274 mots
- 7 médias
Le cinéaste Volker Schlöndorff a suggéré que l'histoire du cinéma allemand était faite d'une série de ruptures esthétiques mais aussi d'une grande continuité dans le domaine de l'industrie cinématographique. L'alternance entre les phases les plus inventives, comme celles des années 1918-1933, voire...
-
AMENGUAL BARTHÉLEMY (1919-2005)
- Écrit par Suzanne LIANDRAT-GUIGUES
- 758 mots
L'œuvre d'écrivain de cinéma de Barthélemy Amengual est considérable, autant par sa quantité (une douzaine d'ouvrages et une multitude d'articles) que par l'acuité de son propos. Comparable aux meilleurs analystes français de sa génération (tels André Bazin ou Henri...
- Afficher les 100 références
Voir aussi
- GOEBBELS JOSEPH (1897-1945)
- AMÉRICAIN CINÉMA
- MACCARTHYSME
- KOULECHOV LEV VLADIMIROVITCH (1899-1970)
- EXPLOITATION, cinéma
- EPSTEIN JEAN (1897-1953)
- ASTRUC ALEXANDRE (1923-2016)
- DOUBLAGE, cinéma
- TOURNAGE, cinéma
- SYNCHRONISATION
- TRUCAGE, cinéma
- CINÉMA TECHNIQUES DU
- JAPONAIS CINÉMA
- SPECTACLE
- DÉCOUPAGE, cinéma
- CRICHTON CHARLES (1910-1999)
- ACTEURS ET ACTRICES, cinéma
- IVORY JAMES (1928- )
- CINEMA NOVO, Brésil
- CINÉMA THÉORIES DU
- CINÉMA ET THÉÂTRE
- CINÉPHILIE
- BLOCKBUSTER
- NEWELL MIKE (1942- )
- CORÉEN CINÉMA
- ADAPTATION DES ŒUVRES
- RÉALISME, cinéma
- SOVIÉTIQUE CINÉMA
- FINLANDAIS CINÉMA
- DANOIS CINÉMA
- CINÉMA MUET
- ANGLAIS CINÉMA
- FRANÇAIS CINÉMA
- POLONAIS CINÉMA
- ITALIEN CINÉMA
- SUÉDOIS CINÉMA
- CINÉMATOGRAPHE
- RÉALISATION, cinéma
- CINÉMA HISTOIRE DU
- MOSJOUKINE IVAN (1889-1939)
- ÉROTISME, cinéma
- PÉPLUM
- SMITH GEORGE ALBERT (1864-1959)
- ZECCA FERDINAND (1864-1947)
- CINÉMA POLITIQUE
- IRANIEN CINÉMA
- GUERRA RUY (1931- )
- DISTRIBUTION, cinéma
- BRÉSILIEN CINÉMA
- POLITIQUE CULTURELLE
- MONTAGE, cinéma
- TAÏWAN CINÉMA DE
- HORREUR CINÉMA D'