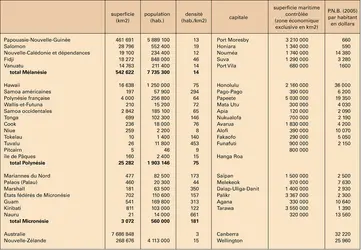OCÉANIE Géographie humaine
- 1. Des populations peu nombreuses mais variées
- 2. Une croissance démographique rapide
- 3. Les transformations de la vie rurale
- 4. La pêche, une ressource d'avenir
- 5. La faiblesse des mines et de l'industrie
- 6. L'essor du transport aérien et le rôle croissant du tourisme
- 7. Fragilité économique et marginalisation géopolitique
- 8. Bibliographie
La faiblesse des mines et de l'industrie
Il n'y a que relativement peu de ressources minières en Océanie insulaire, exception faite de la Papouasie - Nouvelle-Guinée et de la Nouvelle-Calédonie. Il faut mettre à part le cas du petit atoll soulevé de Nauru (21 km2) avec son très riche gisement de phosphates qui lui permit de devenir, dès 1968, le plus petit État indépendant du monde. Entre 1968 et 2001, 43 millions de tonnes de phosphates, valant 2,1 milliards d'euros, ont été extraits de l'île, laissant un environnement dévasté lorsque la ressource a été épuisée. Mais une gestion calamiteuse de ces capitaux énormes a conduit l'île à la banqueroute, la compagnie aérienne nationale Air Nauru à la quasi-faillite, et le gouvernement à des expédients, comme l'accueil de centaines d'établissements financiers se chargeant du recyclage massif d'argent sale en provenance notamment des mafias russes. Rappelons que d'autres gisements de phosphates avaient déjà été épuisés à Océan (Kiribati) et plus anciennement, à Makatea (Polynésie française).
La Papouasie - Nouvelle-Guinée a des ressources minières considérables (25 p. 100 du P.I.B.), d'abord avec les gisements de cuivre de l'île de Bougainville, dont l'exploitation a été fortement perturbée depuis les années 1980 par l'insurrection indépendantiste, ensuite avec le grand gisement d'or et de cuivre d'Ok Tedi, dans la cordillère centrale de Nouvelle-Guinée, près de la frontière de la Papouasie (Irian Jaya) ; d'importants capitaux internationaux (Australie) s'y sont investis, malgré les difficultés d'accès et les problèmes de sécurité. En 2004, la Papouasie - Nouvelle-Guinée a produit 173 000 tonnes de cuivre (15e rang mondial), 73 tonnes d'or (10e rang mondial) et 74 tonnes d'argent. Mais les perspectives d'avenir apparaissent prometteuses également dans le secteur du pétrole et, surtout, du gaz naturel. De gros gisements ont été découverts dans les Southern Highlands (Iagifu pour le pétrole, réserves de gaz de 430 milliards de mètres cubes), d'où le projet de construire un gazoduc de 4 000 kilomètres de longueur vers le nord-est de l'Australie.
Les richesses minières de la Nouvelle-Calédonie sont connues et exploitées depuis la fin du xixe siècle (création de la Société Le Nickel, S.L.N.). Si aujourd'hui on n'exploite plus les minerais de chrome, de manganèse et de fer, en revanche le nickel (5e producteur mondial, 4e pour les réserves) fournit 95 p. 100 des exportations du territoire. Il est soit exporté sous forme de minerais, soit traité dans l'usine de Doniambo à Nouméa par le groupe français Eramet (S.L.N.). Compte tenu de la flambée actuelle des cours (indice 100 en 2000, 172,1 en 2006), de très grands projets sont en cours dans un contexte où politique et économie se mêlent étroitement. Le groupe canadien Inco, leader mondial, construit une unité d'exploitation à Goro dans le sud de l'île. Mais surtout l'État français prévoit de subventionner massivement un autre groupe canadien, Falconbridge, pour la construction d'une deuxième grande usine dans le nord de l'île afin de rééquilibrer le territoire en faveur des indépendantistes de la province Nord, en leur attribuant le très riche massif minier de Koniambo. La situation devient plus complexe encore avec le rachat en 2006 de Falconbridge par le groupe suisse Xstrata, et Eramet ne désespère pas de récupérer finalement tout ou partie de Koniambo et de l'usine du Nord.
Il ne faudrait pas oublier enfin les potentialités que représentent les gisements de nodules polymétalliques du fond de l'océan. L'exploitation de ceux-ci n'est cependant pas encore économiquement rentable faute de techniques appropriées et de cours des métaux assez incitatifs.[...]
- 1. Des populations peu nombreuses mais variées
- 2. Une croissance démographique rapide
- 3. Les transformations de la vie rurale
- 4. La pêche, une ressource d'avenir
- 5. La faiblesse des mines et de l'industrie
- 6. L'essor du transport aérien et le rôle croissant du tourisme
- 7. Fragilité économique et marginalisation géopolitique
- 8. Bibliographie
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Christian HUETZ DE LEMPS : professeur, directeur de l'UFR de géographie, université de Paris-IV-Sorbonne
Classification
Pour citer cet article
Christian HUETZ DE LEMPS. OCÉANIE - Géographie humaine [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
ASIE (Géographie humaine et régionale) - Espaces et sociétés
- Écrit par Philippe PELLETIER
- 23 142 mots
- 4 médias
...d'archipels qui ourlent la façade pacifique des terres continentales asiatiques. Mais elle n'est pas sans complexités car l'Asie est en contact avec les pays de l'Océanie, dont les possessions américaines (les Mariannes par exemple). Le peuplement historique de la Micronésie, de la Mélanésie et de la Polynésie... -
AUSTRALIE
- Écrit par Benoît ANTHEAUME, Jean BOISSIÈRE, Bastien BOSA, Vanessa CASTEJON, Universalis, Harold James FRITH, Yves FUCHS, Alain HUETZ DE LEMPS, Isabelle MERLE, Xavier PONS
- 27 355 mots
- 29 médias
Pays massif, l'Australie oscille entre deux qualificatifs : est-elle la plus grande île de la planète ou son plus petit continent ? Elle représente 85 % des terres émergées de l'Océanie, immense continent maritime. -
AUSTRONÉSIENS
- Écrit par Jean-Paul LATOUCHE
- 919 mots
Pris dans un sens strict, les Austronésiens forment un groupe ethnolinguistique considérable dispersé de Madagascar aux îlesHawaii et recouvrant la totalité de l'Indonésie, de la Malaisie et des Philippines, la quasi-totalité de la Mélanésie et de Formose, et enfin la Micronésie...
-
CHEFFERIE
- Écrit par Henri LAVONDÈS, Jean-Claude PENRAD
- 2 929 mots
Laréflexion sur les systèmes politiques océaniens reste dominée par un retentissant article de Marshall Sahlins (1963), qui, plusieurs fois republié et devenu un classique, oppose le système dit du big man, caractéristique de la Mélanésie, où le statut de chef s'acquiert par des efforts personnels,... - Afficher les 33 références
Voir aussi
- MIGRANTS
- TAHITI
- MÉTISSAGE
- ANANAS
- SANTA ISABEL ou ÎLE ISABEL
- BORA BORA
- OAHU ÎLE D'
- CANNE À SUCRE
- GILBERT ÎLES
- COCOTIER
- COPRAH
- MIGRATIONS HISTOIRE DES
- SAMOA ARCHIPEL DES
- MAORIS
- INDIENS HORS DE L'INDE
- NÉGRITOS
- NOUVELLE-GUINÉE
- AGRICULTURE TRADITIONNELLE
- AGRICOLES PRIX
- PHOSPHATES
- PLANTATION AGRICULTURE DE
- GRANDE-TERRE
- CAROLINES ARCHIPEL DES
- JAPON, économie
- AIDE ÉCONOMIQUE
- DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
- THON
- ZEE (zone économique exclusive)
- MALAITA ÎLE DE
- PIDGIN
- POLYNÉSIEN, langue
- TRANSPORT & TRAFIC AÉRIENS
- MÉLANÉSIENS
- POLYNÉSIENS
- MICRONÉSIENS
- RESSOURCES MINIÈRES
- NOUVELLES-HÉBRIDES, auj. VANUATU
- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
- CONSERVES ALIMENTAIRES
- IRIAN JAYA, Nouvelle-Guinée
- MURUROA
- WAIKIKI, Hawaii