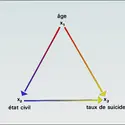IDÉALISME
Les problèmes cartésiens et l'idéalisme
Descartes
Descartes accorde aux idées une existence objective, c'est-à-dire en tant qu'elles sont des représentations. Elles sont le terme immédiat du connaître : « Je ne puis avoir aucune connaissance de ce qui est hors de moi que par l'entremise des idées que j'en ai eues en moi et je me garde de rapporter mon jugement immédiat aux choses, et de leur rien attribuer de positif, que je ne l'aperçoive auparavant en leurs idées, mais je crois aussi que ce qui se trouve en ces idées est nécessairement dans les choses » (Lettre à Gibieuf, 1642). Cela circonscrit l'idéalisme de Descartes, qui réside surtout dans l'importance accordée aux données de conscience et aux idées que nous trouvons en nous, comme sources ou moyens de connaissance certaine.
Descartes reproduit les distinctions scolastiques. « Par la réalité objective d'une idée, j'entends l'entité ou l'être de la chose représentée par cette idée en tant que cette entité est dans l'idée » (Réponses aux secondes objections) : c'est la chose comme objet dans notre esprit ou dans notre représentation. Les idées, « toutes et quantes fois qu'elles sont considérées en tant qu'elles représentent quelque chose, ne sont pas prises matériellement, mais formellement » (Réponses aux quatrièmes objections).
Que l'esprit connaît les choses seulement par les idées qu'il en a ne saurait guère être contesté, et peut servir de prémisse commune à l'idéalisme et au réalisme. L'esprit n'atteint les choses que par ce qui lui en est présenté. En plus, l'idéalisme considère que la réalité objective des idées tient lieu de réalité extérieure ou indépendante : cette réalité des idées est la réalité tout court, plutôt que simplement l'objet de la connaissance et dans la connaissance. Par suite, la connaissance ne connaît qu'elle-même : c'est là une conséquence très éloignée de l'opinion de Descartes et que les cartésiens évitent en supposant que Dieu est source de nos idées ou bien que nous trouvons nos idées en lui. Descartes maintient que les idées (du moment qu'elles sont claires et distinctes) ont une réalité formelle, c'est-à-dire une cause dans un sujet, lequel peut être soit Dieu, soit la nature propre de l'individu pensant (idées innées), ou encore les choses extérieures, qui envoient une image dans l'esprit : « Je ne vois rien qui me semble plus raisonnable que de juger que cette chose étrangère envoie et imprime en moi sa ressemblance plutôt qu'aucune autre chose. » Le sensualisme, commun aux thomistes et aux occamiens, apparemment conservé par Descartes, postule une similarité du connaissant, ou plutôt de l'acte de connaître, et du connu. Cette similarité doit s'entendre « selon la forme », ce qui évite l'absurdité d'admettre que l'idée du cercle est circulaire, celle d'espace, spatiale, etc.
Descartes n'est pas idéaliste techniquement ; il l'est d'une façon indirecte, par le doute méthodique à l'égard des sens, par l'insistance à marquer que la connaissance des choses sensibles dépend de la connaissance de l'esprit par lui-même, par l'explication mécaniste (c'est-à-dire par figure et mouvement), qui rend vraisemblable l'existence d'un écart entre ce que nous présentent les sens et ce que sont les objets hors de nous.
Malebranche
L'idéalisme est le fait de penseurs qui viennent après Descartes. Plus cartésiens que le maître, ils sont tout près de trouver en lui des vestiges de scolastique et d'infrarationnel. Malebranche et Berkeley, dont les doctrines comportent des analogies et des différences, sont des ecclésiastiques en réaction contre le thomisme et l'aristotélisme[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean LARGEAULT : professeur à l'université Paris-XII-Val-de-Marne, Créteil
Classification
Pour citer cet article
Jean LARGEAULT. IDÉALISME [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Autres références
-
BERKELEY GEORGE (1685-1753)
- Écrit par Geneviève BRYKMAN
- 2 919 mots
- 1 média
Soucieux d'enrayer la marée montante du scepticisme induite par le progrès des sciences positives, Berkeley fut essentiellement un apologiste. Mais il fut aussi un authentique philosophe, dont l'ambition paradoxale était de définir, d'une façon à la fois nouvelle et traditionnelle, les rapports...
-
BOSANQUET BERNARD (1848-1923)
- Écrit par Françoise ARMENGAUD
- 895 mots
Philosophe anglais, qui fut professeur à Saint Andrews. Bosanquet est un représentant original, avec Bradley et Royce, de l'idéalisme néo-hégélien. Il était le combattant d'une cause perdue en ce qu'il se voulait le défenseur de l'idéalisme ancien (absolu) contre les « hérésies » de l'idéalisme...
-
BRUNSCHVICG LÉON (1869-1944)
- Écrit par Françoise ARMENGAUD
- 948 mots
Philosophe français, né à Paris, Léon Brunschvicg entre, en 1880, à l'École normale supérieure et suit à la Sorbonne les cours de Victor Brochard et d'Émile Boutroux. Sa thèse de doctorat a pour sujet et pour titre La Modalité du jugement(1892). Il fonde, en 1893, la Revue de...
-
CAUSALITÉ
- Écrit par Raymond BOUDON, Marie GAUTIER, Bertrand SAINT-SERNIN
- 12 987 mots
- 3 médias
On doit donc choisir entre deux positions métaphysiques : l'idéalisme, qui part des représentations, et limite ses ambitions, du moins en sciences, à « sauver les phénomènes » ; le réalisme, qui pense que, même si « le réel est voilé », on peut soulever certains coins du voile, et avoir accès à ce... - Afficher les 40 références
Voir aussi
- OCCASIONNALISME
- REPRÉSENTATION & CONNAISSANCE
- LOGIQUE MATHÉMATIQUE
- CHOSE-EN-SOI
- ÉTENDUE, philosophie
- HARMONIE, philosophie
- HYPOTHÈSE, épistémologie
- SAVOIR
- DÉMONSTRATION
- IDÉE
- PRINCIPE
- VÉRITÉ, logique
- SENSATION, philosophie
- SUBSISTANCE ou SUBSISTENCE, philosophie
- PHILOSOPHIE HISTOIRE DE LA
- IMMATÉRIALISME
- A PRIORI CONNAISSANCE