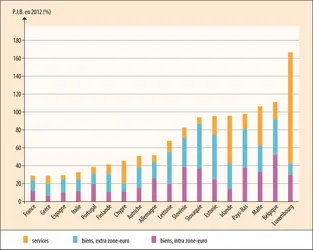EURO
L’unification monétaire en Europe est le résultat d’un long processus, marqué par les rapports Werner (1970) et Delors (1989), puis par le traité de Maastricht (1991), le gel des parités de onze monnaies accompagné de la mise en place d'une politique monétaire unique (1999), l’introduction des billets et pièces en euros (2002) et divers élargissements ayant conduit à une union de dix-huit des États membres de l’Union européenne au 1er janvier 2014. Déclenchée par la crise financière mondiale de 2008, la crise de la zone euro, à partir de 2009, a mis en évidence les faiblesses d’une construction européenne hybride, dont l’euro constitue, avec la politique commerciale et la politique de la concurrence, le seul dispositif réellement fédéral. Les Européens se sont alors attelés à compléter le dispositif à l’aide d’un fonds de secours aux États en difficulté et par l’unification de la surveillance des banques. La question du fédéralisme budgétaire a également ressurgi à l’occasion de cette crise.
La longue marche vers l'euro
L'euro est né le 1er janvier 1999 (même si les billets et pièces n’ont été introduits qu’en 2002). Dès janvier 1999, dix monnaies européennes (l'escudo, le florin, le franc belgo-luxembourgeois, le franc français, le deutsche Mark, le mark finlandais, la lire italienne, la livre irlandaise, la peseta, le schilling) ont cessé de vivre des existences séparées pour devenir de simples subdivisions (ou multiple, dans le cas de la livre irlandaise) de l'euro. La drachme (Grèce) a rejoint le groupe le 1er janvier 2001, suivie des monnaies de la Slovénie en 2007, de Chypre et Malte en 2008, de la Slovaquie en 2009, de l’Estonie en 2011, de la Lettonie en 2014, de la Lituanie en 2015 et de la Croatie en 2023. Au 1er janvier 2023, la zone euro comptait donc vingt membres. La zone euro a vocation, à terme, à accueillir tous les pays de l'Union européenne, même si trois d'entre eux (Danemark, Suède et Royaume-Uni – sorti de l'UE en 2020) conservent la possibilité de ne pas rejoindre la zone. Cette révolution monétaire est l'aboutissement d'un long processus d'intégration monétaire en Europe.
L'entrée d'un pays dans l'euro est décidée après examen de cinq critères de convergence (art. 140.1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), lesquels portent sur le niveau du déficit et de la dette des administrations publiques (qui doivent, respectivement, être inférieurs à 3 % et se rapprocher de 60 % du PIB du pays), l'inflation (qui ne doit pas dépasser de plus de 1,5 point de pourcentage la moyenne des trois pays où elle est la plus basse), les taux d'intérêt à long terme, la stabilité du taux de change pendant deux ans, sans dévaluation, au sein du mécanisme de change européen et l'indépendance de la banque centrale. Un pays satisfaisant à ces différents critères s’intégrera en principe plus facilement dans l’union monétaire, car ses prix relatifs par rapport aux partenaires sont stables, et ses finances publiques en ordre ne feront pas pression à la hausse sur les taux d’intérêt de la zone. La situation des différents pays concernant ces critères fait l’objet de rapports de la Commission européenne et de la BCE. Le Royaume-Uni (État membre jusqu’en 2020) et le Danemark ont obtenu de choisir le moment où ils adopteraient la monnaie unique. Les autres États membres de l’Union n’ont pas cette possibilité : ils rejoignent en principe l’euro dès lors qu’ils respectent les critères.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Européens font face à une pénurie de moyens de paiement pour leurs échanges commerciaux, leurs monnaies étant inconvertibles et leurs réserves en or et en dollars, limitées. C'est pourquoi ils mettent en place, en 1950, l'Union européenne des paiements, système[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Agnès BÉNASSY-QUÉRÉ : professeur à l'École d'économie de Paris, université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne
Classification
Pour citer cet article
Agnès BÉNASSY-QUÉRÉ. EURO [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
ARRIVÉE DE L'EURO
- Écrit par Marie-France BAUD-BABIC
- 243 mots
- 1 média
Le 1er janvier 2002, dans douze pays de l'Union européenne, 300 millions de consommateurs découvrent les pièces et les billets de la monnaie qui leur servira désormais d'instrument de paiement commun, l'euro. Trois ans après sa naissance juridique et financière, l'euro fiduciaire...
-
CRISE DE LA ZONE EURO
- Écrit par Arnaud BALVAY
- 326 mots
À partir de 2010, la zone euro est confrontée à une crise économique liée à la dette publique des États qui la composent.
À partir de 2007, la crise des subprimes (prêts immobiliers à taux variable) contraint les principaux pays industrialisés, dont la dette publique est très importante depuis...
-
ACHAT POUVOIR D'
- Écrit par Stéfan LOLLIVIER
- 5 643 mots
- 2 médias
...au prix des biens qu'ils achètent le plus fréquemment, et jugent alors leurs évolutions de pouvoir d'achat en fonction des hausses de prix de ces biens. Le passage à l'euro constitue un cas d'école venant illustrer ce phénomène. Lors du passage à l'euro en 2002, l'indice des prix à la consommation n'a... -
BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE (BCE)
- Écrit par Jézabel COUPPEY
- 1 142 mots
La Banque centrale européenne (B.C.E.) est entrée en fonction le 1er juillet 1998, quelques mois avant l'ultime phase de l'union monétaire (la troisième phase de l'Union économique et monétaire selon le traité sur l'Union européenne signé à Maastricht en 1992), marquée par le basculement à l'...
-
CHANGE - Les opérations de change
- Écrit par Henri BOURGUINAT, Gunther CAPELLE-BLANCARD
- 7 015 mots
- 2 médias
Traditionnellement, la livre sterling (GBP) était cotée au certain et faisait donc exception par rapport à la plupart des autres grandes monnaies. Elle a été rejointe au 1er janvier 1999 par l'euro (EUR), qui est également coté au certain. Ainsi, par exemple, on cote, respectivement à Paris... -
CHANGE - Les régimes de change
- Écrit par Patrick ARTUS
- 6 907 mots
- 5 médias
Même entre des pays raisonnablement similaires, comme ceux de la zone euro, on voit apparaître des chocs asymétriques ou des différences structurelles. La nature des négociations salariales n'est pas la même en France ou en Allemagne, la taille de l'industrie et des services diffère, la structure géographique... - Afficher les 43 références
Voir aussi
- SANCTIONS
- CEE (Communauté économique européenne)
- PAIEMENT MODES DE
- PRIX POLITIQUE DES
- CHANGE FIXE
- EUROPE, politique et économie
- DÉFLATION
- UNITÉ DE COMPTE
- POLITIQUE MONÉTAIRE
- POLITIQUE ÉCONOMIQUE
- PARITÉ MONÉTAIRE
- BIENS & SERVICES
- CROISSANCE ÉCONOMIQUE
- ÉCHANGE, économie
- DÉPENSES PUBLIQUES
- SEBC (Système européen de banques centrales)
- SME (système monétaire européen)
- ÉCU, unité de compte européenne
- UNITÉ MONÉTAIRE
- MAASTRICHT ou MAËSTRICHT TRAITÉ DE (1992)