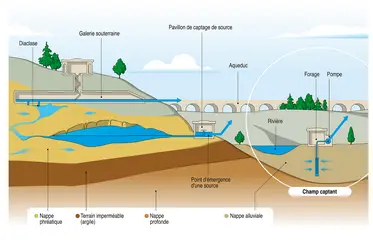EAU Approvisionnement et traitement
Épuration des eaux usées
Le milieu naturel possède un certain pouvoir d'absorption de toutes les pollutions, à de rares exceptions près ; mais le plus souvent, les charges polluantes atteignent une valeur telle que les micro-organismes présents dans le milieu naturel ne peuvent plus réaliser une autoépuration suffisante. C'est une question de dose. Le degré d'épuration des eaux est donc défini en fonction de la capacité du milieu récepteur, généralement liquide (fleuve, rivière, lac, mer), à « digérer » le rejet (quantité totale, valeurs de pointe). Il doit aussi tenir compte de l'aspect spatio-temporel, c'est-à-dire pendant combien de temps et jusqu'où le rejet fera ressentir son effet. C'est le problème de l'amont-aval et de l'évaluation de l'impact des nuisances. Il est donc nécessaire de bien connaître la quantité et la composition du rejet, ses fluctuations dans le temps, les caractéristiques et leurs variations au cours du cycle hydrologique du milieu récepteur et son potentiel d'acceptation. L'optimisation technico-économique exige des études préalables exhaustives. Depuis l'adoption en France de la première loi sur l'eau (1964), de nombreuses recherches et concertations ont été menées et ont abouti à la mise en place, non seulement en France mais aussi au sein de l'Union européenne, d'un ensemble de lois et de textes réglementaires et techniques.
En s'appuyant sur ces textes, la France a adopté une politique cohérente qui tend à la généralisation obligatoire de l'assainissement, avec des dates limites de réalisation en fonction de l'importance de la charge polluante des rejets. Un contrôle technique des réalisations et de leur fonctionnement a été mis en place ainsi qu'une aide financière. Les textes ont établi une classification des zones et milieux récepteurs (carte des zones dites sensibles) ainsi que les niveaux d'épuration à obtenir en fonction des milieux récepteurs considérés et des exigences en aval. La réglementation vise également la destruction finale des sous-produits de l'épuration (boues, odeurs). Les textes précisent les conditions dans lesquelles des rejets non domestiques (industriels, toxiques, artisanaux) peuvent être acceptés dans les réseaux de collecte urbains ; dans le cas contraire, ils doivent être traités ou prétraités séparément.
Traitement des eaux usées urbaines
Les eaux résiduaires urbaines charrient des objets grossiers, des matières minérales en suspension enduites de matières organiques putrescibles, des particules organiques de faible dimension, des matières organiques dissoutes, des substances azotées (azote organique, ammoniaque) et phosphorées (orthophosphates) et des sels minéraux. En leur sein pullulent une faune et une flore de micro-organismes pathogènes ou saprophytes, des algues, des protozoaires, etc. Elles constituent un excellent milieu de culture bien équilibré en éléments nutritifs (carbone, azote, phosphore). Cette capacité spontanée de développement d'une activité biologique intense est utilisée avec des variantes diverses dans les stades dits biologiques, soit en condition oxygénée (aérobie), soit en absence d'oxygène et de nitrates (anaérobie) ou en absebce d'oxygène et en présence de nitrates (anoxie). Les teneurs en charges « polluantes » sont variables du simple au double. Pour fixer un ordre de grandeur, elles représentent en moyenne 1 300 grammes de matières par mètre cube dont 400 g/m3 sont décantables aisément et 600 g/m3 sont dissoutes. La proportion de matières organiques est de l'ordre de 70 p. 100. On conçoit pourquoi les processus d'épuration biologique jouent un rôle prépondérant dans le traitement des eaux usées urbaines.
Selon le niveau de traitement souhaité, une épuration des eaux usées urbaines[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Georges BREBION : directeur du département eaux-biologie à l'Institut national de recherche chimique appliquée
- Cyrille GOMELLA : ingénieur-conseil, président d'honneur de la Société d'études des techniques de l'urbanisme et de l'environnement
- Bernard LEGUBE : docteur ès sciences, professeur des Universités, directeur du laboratoire de chimie de l'eau et de l'environnement (U.M.R. 6008, C.N.R.S.), École supérieure d'ingénieurs de Poitiers (université de Poitiers)
Classification
Pour citer cet article
Georges BREBION, Cyrille GOMELLA et Bernard LEGUBE. EAU - Approvisionnement et traitement [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
EAU (notions de base)
- Écrit par Jean-Paul DELÉAGE
- 6 238 mots
- 5 médias
De toutes les planètes du système solaire, la Terre est la seule à être pourvue d'une hydrosphère. Celle-ci recouvre plus des deux tiers de sa surface. Les propriétés de l'eau sont tout à fait exceptionnelles : condition de la vie, solvant quasi universel, vecteur de chaleur, puissant régulateur thermique,...
-
EAU DU MANTEAU TERRESTRE
- Écrit par Édouard KAMINSKI
- 2 666 mots
- 3 médias
On qualifie souvent la Terre de « planète bleue » parce que l'eau des océans recouvre plus des deux tiers de sa surface. Les géologues spécialistes de l'intérieur de la Terre pourraient la qualifier plutôt de « planète verte », car le manteau – enveloppe la plus importante de la planète qui s'étend...
-
EAU TERRESTRE (ORIGINE DE L')
- Écrit par Francis ALBARÈDE, Marie-Laure PONS
- 2 121 mots
- 5 médias
La Terre, troisième planète du système solaire, est un corps tellurique aujourd'hui couvert d'eau (H2O) liquide sur plus de 70 p. 100 de sa surface. Outre cette eau océanique, notre planète se caractérise également par la présence de glace et de vapeur d'eau à l'air libre : l'eau...
-
ABSORPTION VÉGÉTALE
- Écrit par René HELLER, Jean-Pierre RONA
- 4 440 mots
- 6 médias
Les plantes, pour la plupart, tirent du sol l'eau et les sels minéraux qui leur sont nécessaires. Les racines – qui forment l'appareil radiculaire – et les poils absorbants localisés sur les plus jeunes d'entre elles, jouent pour cela un rôle essentiel. En effet, elles absorbent les éléments...
-
AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ
- Écrit par Denis COUVET
- 1 558 mots
- 1 média
La création de l’Agence française pour la biodiversité (A.F.B.), promise dès 2012 par le gouvernement, a été votée en première lecture par l’Assemblée nationale le 18 mars 2015. Instrument d’une politique générale et ambitieuse de la biodiversité, elle a comme objectifs la préservation, la gestion...
-
ALGÉRIE
- Écrit par Charles-Robert AGERON, Universalis, Sid-Ahmed SOUIAH, Benjamin STORA, Pierre VERMEREN
- 41 835 mots
- 25 médias
L'Algérie est un pays aux ressources en eau très limitées, une situation qui est aggravée par la faiblesse des précipitations, l'insuffisante mobilisation de cette ressource et la forte concurrence entre les différentes consommations (domestique, industrielle et agricole). -
AQUAPORINES
- Écrit par Pierre LASZLO
- 2 344 mots
Les aquaporines sont des protéines qui favorisent le passage des molécules d'eau à travers les membranes cellulaires, réalisant une ingénieuse hydraulique au service des organismes.
Un petit sac, au contenu immuable, baignant dans une eau minérale, de composition plus ou moins variable...
- Afficher les 65 références
Voir aussi
- ENTÉROCOQUES
- CONTAMINATION
- ADDUCTION D'EAU
- CAPTAGE OUVRAGES DE
- SOURCE
- ARTÉSIEN PUITS
- POMPES
- MICRO-ORGANISME
- FLOCULATION
- FILTRATION, physico-chimie
- OZONE
- PRESSION, physique
- QUALITÉ
- BIOXYDE DE CHLORE
- ASSAINISSEMENT
- ÉPURATION DES EAUX
- RECYCLAGE DES DÉCHETS ET DES MATÉRIAUX
- ESCHERICHIA COLI ou COLIBACILLE
- CHIMIQUES SUBSTANCES, écotoxicologie
- AGGLOMÉRATION
- EAUX SOUTERRAINES
- NAPPE, hydrogéologie
- PUITS
- DÉBIT, hydrologie
- AQUIFÈRE
- SABLE
- SÉCURITÉ SANITAIRE
- MICROFILTRATION
- BIOMASSE
- DÉPOLLUTION
- CONDUITES, hydraulique
- EAU DE JAVEL (hypochlorite de sodium)
- DÉSINFECTANTS
- FLOTTATION
- FERTILISATION
- BASSIN DE RETENUE, hydrologie
- BIODÉGRADABILITÉ
- DÉNITRIFICATION
- EAUX PLUVIALES
- EAUX USÉES
- DÉCANTATION, traitement des eaux
- RÉACTEUR BIOLOGIQUE
- BIOFILTRATION
- ENVIRONNEMENT, droit et politique
- FRANCE, droit et institutions
- NITRIFICATION
- ALIMENTAIRE HYGIÈNE ou HYGIÈNE NUTRITIONNELLE
- GERMES, biologie
- DÉVERSOIR
- EAU APPROVISIONNEMENT ET TRAITEMENT DE L'
- POREUX MILIEU
- ULTRAFILTRATION
- CONSOMMATION ALIMENTAIRE
- EAU POTABLE
- COAGULATION, traitement des eaux
- BOUES ACTIVÉES, traitement des eaux
- BOUES RÉSIDUELLES, traitement des eaux
- NORMALISATION
- SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS