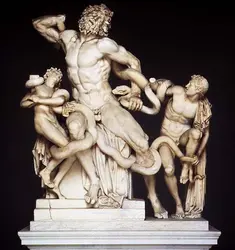CONSERVATION DES ŒUVRES D'ART
Conservation des peintures
Au xixe siècle, une polémique s'est instituée entre Français et Italiens, les uns et les autres prétendant avoir eu au xviiie siècle l'initiative de la restauration des tableaux anciens. Cette polémique était vaine, car, en fait, la restauration des peintures fut pratiquée dès le xvie siècle. En 1550, en effet, Jan Van Scorel et Lancelot Blondeel sont appelés à remettre en état le Retable de l'Agneau mystique de Jan Van Eyck à Gand et, conformément à l'habitude ancienne d'adapter les choses au goût du temps, ils y ajoutent quelques éléments pour l'embellir. Déjà, entre 1537 et 1540, le Primatice est appelé à intervenir à Fontainebleau sur la Grande Sainte Famille et le Saint Michel de Raphaël, tandis qu'en Italie le plafond de la chapelle Sixtine, peint par Michel-Ange, fait l'objet entre 1566 et 1572 de mesures de consolidation appliquées par Domenico Carnevale. Dès le xviie siècle, la conservation des grandes collections princières est confiée à un « garde » (en anglais keeper ou curator) qui est le plus souvent un peintre et qui est chargé d'entretenir les tableaux. La grande activité que déploie le commerce d'art suscite un peu partout en Europe, à Amsterdam, à Anvers, à Paris, à Rome, des restaurateurs de tableaux (souvent plus ou moins faussaires) dont le rôle consiste à effacer les lacunes provenant d'écailles tombées et à rifiorire (rénover) la peinture, comme on dit en Italie, ce qui, en dehors du renouvellement des vernis jaunis, entraîne des interventions plus ou moins fâcheuses. Le xviiie siècle apporte de nombreuses innovations techniques, bénéfiques ou non, dans le traitement des supports de tableaux (bois ou toile). Le rentoilage, renforcement d'une toile originale fragilisée par une toile neuve collée, est mentionné pour la première fois en France en 1688, à propos d'un Titien du Louvre. Cette technique, déjà répandue en Italie, s'impose dans toute l'Europe. Vers 1715, la transposition apparaît en France et en Italie ; ce traitement radical, considéré de nos jours comme particulièrement néfaste, trouve, en France, sa première application au musée du Louvre avec la restauration de La Charité d'Andrea del Sarto par le restaurateur R. Picault. Ce traitement du support, qui consiste à éliminer totalement le bois ou la toile du tableau restauré pour le remplacer par une toile neuve, fut couramment pratiqué, témoignage d'une certaine virtuosité technique, jusqu'au milieu du xxe siècle. Vers 1740, les premiers parquetages – système de maintien fixé au dos des supports en bois des tableaux – furent mis au point, en France, par le restaurateur Hacquin.
Les administrations de la conservation et de la restauration apparaissent au xviiie siècle. Dès 1699, Antoine Paillet fut le premier responsable du service d'entretien – et donc de restauration – des collections de Louis XIV. En 1770, à Venise, un Anglais, Pietro Edwards, est chargé de la surveillance du patrimoine ; il organise un des premiers ateliers de restauration et crée une école où l'on enseigne la restauration des tableaux, qui est installée au couvent San Giovanni e Paolo.
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Germain BAZIN : conservateur en chef au musée du Louvre, ancien élève de l'École normale supérieure, professeur à l'université de Paris-III-Sorbonne nouvelle
- Vincent POMARÈDE : conservateur des musées de France, département des peintures, musée du Louvre
Classification
Pour citer cet article
Germain BAZIN et Vincent POMARÈDE. CONSERVATION DES ŒUVRES D'ART [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
ABU SIMBEL
- Écrit par Christiane M. ZIVIE-COCHE
- 1 974 mots
- 6 médias
Les temples d'Abu Simbel, mis en péril par la construction du grand barrage d'Assouan, furent, avec les autres temples de basse Nubie, l'objet d'une vaste campagne de sauvetage internationale, dirigée par l' U.N.E.S.C.O. à la demande de l'Égypte et qui se déroula de 1963 à 1968. Le déplacement des deux... -
ADHÉMAR JEAN (1908-1987)
- Écrit par Jean-Pierre MOUILLESEAUX
- 1 312 mots
La Bibliothèque nationale de Paris conserve depuis Colbert (1667) des milliers d'images rassemblées dans le cabinet des Estampes. Gravures, affiches, dessins ou collections iconographiques, photographies enfin sont venus régulièrement s'accumuler au gré des acquisitions et des dons, mais surtout avec...
-
ARCHÉOLOGIE (Archéologie et société) - Archéologie et enjeux de société
- Écrit par Jean-Paul DEMOULE
- 4 676 mots
- 2 médias
Non dénué d'ambiguïté, le métier d'archéologue ne saurait donc se limiter à une pure activité scientifique. À un bout de la chaîne, l'archéologue doit veiller à la préservation du patrimoine et à la sauvegarde des sites, ce qui le met immédiatement en conflit parfois avec des intérêts purement... -
ART & SCIENCES
- Écrit par Jean-Pierre MOHEN
- 6 165 mots
- 3 médias
Cesare Brandi, en 1950, dans un livre intitulé Teoria del restauro, Harold Plenderleith, en 1956, avec ses travaux sur La Conservation des antiquités et des œuvres d'art, Paul Coremans, dans ses cours professés à l'Institut royal du patrimoine artistique de Bruxelles, ont défini, chacun, les... - Afficher les 32 références
Voir aussi
- RENTOILAGE
- STACCO, enduit
- PARQUETAGE
- CONVENTION NATIONALE, Révolution française
- RESTAURATION, art
- HIÉROPE
- GAIGNIÈRES ROGER DE (1642-1715)
- CHINOISE PEINTURE
- GREC ART
- ROMAIN ART
- COLLECTION, art et culture
- CHAMPMOL CHARTREUSE DE
- TŌDAI-JI MONASTÈRE DE
- PARTHÉNON
- VERNIS PEINTURE AUX
- COPIE, art
- MÉDIÉVAL ART
- RENAISSANCE ARTS DE LA
- RENAISSANCE ITALIENNE ARTS DE LA, XVIe s.
- SIXTINE CHAPELLE
- INVENTAIRE MONUMENTAL
- LOUVRE MUSÉE DU
- MUSÉE DES MONUMENTS FRANÇAIS
- TECHNIQUES HISTOIRE DES, XVIIe et XVIIIe s.
- MONUMENTS HISTORIQUES
- REMPLOI ou RÉEMPLOI, architecture
- ANTIQUITÉ, sculpture
- ANTIQUITÉS NATIONALES
- LEBRUN JEAN-BAPTISTE PIERRE (1748-1813)
- VITET LOUIS, dit LUDOVIC (1802-1873)
- VILLOT FRÉDÉRIC (1809-1875)