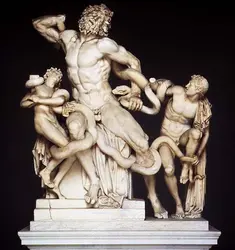CONSERVATION DES ŒUVRES D'ART
« Le premier sentiment de l'homme fut celui de son existence, le second celui de sa conservation », déclarait Jean-Jacques Rousseau. Il est certain que les plus anciens témoignages que nous ait laissés l'humanité attestent le soin déployé de tout temps par l'homme pour conserver ses objets et ses outils. Un singe peut éventuellement se servir d'un bâton comme d'une arme, mais il le jette aussitôt après usage ; l'homme le plus primitif garde son outil jusqu'à ce qu'il soit usé et ne puisse plus servir ; de sorte qu'il en connaît le maniement, se familiarise avec son emploi et est ainsi amené à le perfectionner. La conservation se révèle donc un facteur essentiel de l'évolution et du progrès. Dès les origines, le sentiment d'un au-delà, sorte de prolongement de la vie terrestre, poussa l'homme à conserver les objets qu'il avait créés, en raison de la nécessité qu'il y avait à pourvoir le défunt d'objets et d'aliments propres à entretenir la vie. Peut-être même l'ocre rouge – couleur du sang –, répandue sur les cadavres dans les sépultures paléolithiques, répondait-elle à ce but, de même que, chez les Égyptiens, la coutume de momifier les cadavres. Dans certaines des plus anciennes civilisations, en Mésopotamie, en Chine et plus récemment chez les Scythes ou les Vikings, les funérailles d'un souverain temporel provoquaient des hécatombes d'animaux, voire de femmes et de serviteurs destinés à l'accompagner dans l'au-delà. Les Égyptiens entretenaient des inspecteurs des tombes royales, dont la mission particulière était d'empêcher les déprédations commises par les voleurs qu'attiraient les trésors déposés dans la sépulture des pharaons. Bien des tombes ayant été pillées dès l'époque pharaonique, de telles tentatives demeurèrent souvent vaines.
L'idée de conservation s'est attachée aussi à tout ce qui concernait le divin. C'est ainsi que chez les Égyptiens les temples étaient construits en pierre, tandis que les demeures profanes, celles même des souverains, étaient édifiées en matériaux périssables. Il en fut ainsi jusqu'à l'époque hellénistique, les Grecs habitant en effet des maisons très pauvres à côté de temples somptueux.
Apparition du musée
Les trésors des temples grecs, constitués par les ex-voto des fidèles, étaient conservés pieusement. La responsabilité en incombait aux hiéropes, commis à la garde des temples et qui procédaient à toutes les opérations de gestion et de conservation d'une collection : inventaires, réparations, réforme ou envoi à la fonte des objets irréparables. Considérés comme vétustes et pourtant remplacés, les idoles ou objets sacrés n'étaient pas jetés à la voirie, mais enterrés près du temple dans des fosses ou favissae. Cette coutume s'est conservée dans la religion chrétienne. En 1571, le IVe concile provincial de Milan, qui recommande de rénover les images pieuses, prescrit de brûler celles qui sont considérées comme ne répondant plus au sentiment populaire et d'en enterrer les cendres dans l'église. De même, en 1763, lorsque le jubé gothique de la cathédrale de Chartres fut détruit pour être remplacé par un monument néo-classique, ses débris furent enfouis dans le sol de la cathédrale. Au Brésil, enfin, les plus anciennes statues religieuses venues jusqu'à nous – celles du xviie siècle – ont été ensevelies et conservées dans des fosses à images lorsque au siècle suivant on leur substitua des images plus modernes.
Le musée, apparu au iie siècle avant J.-C. chez les princes grecs de l'Orient, prendra un grand développement chez les Romains, incitera à la conservation des œuvres d'art appartenant aux époques classique et archaïque, pour des raisons cette fois esthétiques et non plus[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Germain BAZIN : conservateur en chef au musée du Louvre, ancien élève de l'École normale supérieure, professeur à l'université de Paris-III-Sorbonne nouvelle
- Vincent POMARÈDE : conservateur des musées de France, département des peintures, musée du Louvre
Classification
Pour citer cet article
Germain BAZIN et Vincent POMARÈDE. CONSERVATION DES ŒUVRES D'ART [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
ABU SIMBEL
- Écrit par Christiane M. ZIVIE-COCHE
- 1 974 mots
- 6 médias
Les temples d'Abu Simbel, mis en péril par la construction du grand barrage d'Assouan, furent, avec les autres temples de basse Nubie, l'objet d'une vaste campagne de sauvetage internationale, dirigée par l' U.N.E.S.C.O. à la demande de l'Égypte et qui se déroula de 1963 à 1968. Le déplacement des deux... -
ADHÉMAR JEAN (1908-1987)
- Écrit par Jean-Pierre MOUILLESEAUX
- 1 312 mots
La Bibliothèque nationale de Paris conserve depuis Colbert (1667) des milliers d'images rassemblées dans le cabinet des Estampes. Gravures, affiches, dessins ou collections iconographiques, photographies enfin sont venus régulièrement s'accumuler au gré des acquisitions et des dons, mais surtout avec...
-
ARCHÉOLOGIE (Archéologie et société) - Archéologie et enjeux de société
- Écrit par Jean-Paul DEMOULE
- 4 676 mots
- 2 médias
Non dénué d'ambiguïté, le métier d'archéologue ne saurait donc se limiter à une pure activité scientifique. À un bout de la chaîne, l'archéologue doit veiller à la préservation du patrimoine et à la sauvegarde des sites, ce qui le met immédiatement en conflit parfois avec des intérêts purement... -
ART & SCIENCES
- Écrit par Jean-Pierre MOHEN
- 6 165 mots
- 3 médias
Cesare Brandi, en 1950, dans un livre intitulé Teoria del restauro, Harold Plenderleith, en 1956, avec ses travaux sur La Conservation des antiquités et des œuvres d'art, Paul Coremans, dans ses cours professés à l'Institut royal du patrimoine artistique de Bruxelles, ont défini, chacun, les... - Afficher les 32 références
Voir aussi
- RENTOILAGE
- STACCO, enduit
- PARQUETAGE
- CONVENTION NATIONALE, Révolution française
- RESTAURATION, art
- HIÉROPE
- GAIGNIÈRES ROGER DE (1642-1715)
- CHINOISE PEINTURE
- GREC ART
- ROMAIN ART
- COLLECTION, art et culture
- CHAMPMOL CHARTREUSE DE
- TŌDAI-JI MONASTÈRE DE
- PARTHÉNON
- VERNIS PEINTURE AUX
- COPIE, art
- MÉDIÉVAL ART
- RENAISSANCE ARTS DE LA
- RENAISSANCE ITALIENNE ARTS DE LA, XVIe s.
- SIXTINE CHAPELLE
- INVENTAIRE MONUMENTAL
- LOUVRE MUSÉE DU
- MUSÉE DES MONUMENTS FRANÇAIS
- TECHNIQUES HISTOIRE DES, XVIIe et XVIIIe s.
- MONUMENTS HISTORIQUES
- REMPLOI ou RÉEMPLOI, architecture
- ANTIQUITÉ, sculpture
- ANTIQUITÉS NATIONALES
- LEBRUN JEAN-BAPTISTE PIERRE (1748-1813)
- VITET LOUIS, dit LUDOVIC (1802-1873)
- VILLOT FRÉDÉRIC (1809-1875)