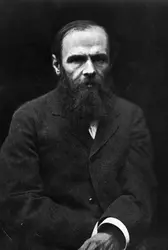ROMAN Roman et société
Le roman peut aussi bien traduire la réalité sociale que la trahir. D'une part, il est le mode d'expression artistique dont les relations avec cette réalité sont les plus amples et les plus précises : la fiction chinoise Le Rêve du pavillon rouge, les œuvres de Balzac, de Proust ou de Joyce auront retranscrit, chacun en son temps, une somme de rapports sociaux, et surtout le clavier des langages d'une zone sociale. D'autre part, les termes de « roman » et de « romanesque » désignent des récits propres à déformer, à idéaliser, à masquer la vie sociale réelle. Dans les deux cas cependant, qu'il soit réaliste ou irréaliste à l'extrême, le roman est le genre où se lisent le plus nettement la texture et la structure d'une société : celle-ci se laisse non moins déchiffrer dans L'Astrée que dans Le Roman bourgeois, dans Fantomas que dans À la recherche du temps perdu. « Volontairement et explicitement, le romancier réaliste décrit une société avec un souci d'exactitude ; le romancier non réaliste le fait sans le vouloir », écrit l'historien Seignobos.
Évidente chez Antoine de La Sale ou Dickens, voilée chez Mlle de Scudéry, maquillée dans maints feuilletons, cette transparence du social à travers le romanesque tient fondamentalement aux privilèges que les romanciers attribuent depuis toujours aux individus et aux individualités, qu'il s'agisse de les faire apparaître comme représentants d'un groupe ou, au contraire, de montrer leur caractère d'exception. Le roman n'exprime le Nous qu'en exposant la destinée d'un Il ou d'un Je, mais qui appartiennent à une société, qui en sont membres et en sont les médiateurs. Car, à la différence du héros tragique ou épique, le personnage romanesque n'est pas situé au-dessus ou en dehors de telle ou telle collectivité : il la désigne, même et surtout quand il s'oppose à elle, ou quand il existe dans l'une de ses marges. On peut comparer ce personnage à un élément du chœur tragique, qui soudain cesserait de parler le même langage que les autres pour s'exprimer en son nom propre, mais toujours en regard, en fonction des autres. Dans la mesure où il narre l'histoire de un ou de plusieurs individus mis en relief et en valeur sur une toile de fond sociale, le roman est toujours psychologique à quelque degré.
Du mythe au roman
La dualité complémentaire du social et de l'individuel ne caractérise pas seulement les contenus, les thèmes, la substance du roman : elle appartient consubstantiellement au romanesque en tant qu'ouvrage, en tant que fait de culture et de civilisation. À moins de jouer sur les mots, et de ranger dans le romanesque les aventures d'Ulysse, les exploits de Gilgamesh ou encore les innombrables légendes ou récits populaires qui constituent le fonds de toutes les cultures, le roman se présente comme une œuvre assez longue, écrite par un seul auteur (à de rares exceptions près) et qui est destinée à une lecture individuelle, ou du moins « privée ». Le couple écriture-lecture caractérise avant tout le roman. Manuscrit ou imprimé, et presque toujours signé, le roman est de l'ordre du livre, de l'ordre aussi de la prose. Même rédigé en vers (le Roman de la Rose), un roman fait pencher les symboles du poétique vers les aspects prosaïques (quotidiens, familiers, utiles, sociaux en un mot) de l'existence. Mais, en deçà même de ces traits formels fondamentaux, le roman a pour caractère primordial d'être écrit par un auteur qui sait, et fait savoir à son lecteur, que son ouvrage se compose de faits imaginés, et qui pourtant concernent ou reflètent l'existence concrète, terrestre des hommes. « Un romancier écrit des fictions consciemment », observe Luxun dans son Histoire du roman chinois. En d'autres termes, l'écrivain romanesque[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Michel ZÉRAFFA : maître de recherche au C.N.R.S., écrivain
Classification
Pour citer cet article
Michel ZÉRAFFA. ROMAN - Roman et société [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
ROMAN D'AVENTURES
- Écrit par Sylvain VENAYRE
- 3 878 mots
- 9 médias
À la fin du xviiie siècle, une mutation remarquable vient affecter le genre du récit de voyage : alors que l’âge classique avait privilégié les connaissances rapportées par le voyageur, le nouveau récit s’organisa autour de la personnalité de ce dernier, de ses sentiments, des aventures survenues...
-
ROMAN FAMILIAL
- Écrit par Catherine CLÉMENT
- 847 mots
C'est dans le livre d'Otto Rank, Le Mythe de la naissance du héros (1909), que Freud inséra un petit texte intitulé « Le Roman familial des névrosés ». Le phénomène auquel se rattache ledit « roman » est le processus général de distanciation entre parents et enfants, processus...
-
ROMAN HISTORIQUE
- Écrit par Claude BURGELIN
- 1 009 mots
Le roman a toujours puisé dans l'histoire de quoi nourrir ses fictions et leur donner les prestiges du vraisemblable. Mais, en tant que genre spécifiquement déterminé, le roman historique a pris son essor — comme la plupart des formes romanesques — au xixe siècle, alors que la bourgeoisie...
-
ROMAN POPULAIRE
- Écrit par Jean TULARD
- 4 060 mots
C'est au moment où la narration hésite entre différentes formes d'expression que s'effectue un retour aux sources populaires, à cette littérature qui privilégia l'imagination aux dépens de l'intelligence, le style direct contre le langage obscur, le respect des valeurs établies face à la remise en question...
-
ROMAN SENTIMENTAL
- Écrit par Isabelle ANTONUTTI
- 2 475 mots
- 1 média
En 2015, tandis que 12 p. 100 des Français se déclarent lecteurs de romans sentimentaux (Les Français et la lecture, mars 2015), Marc Levy est l’auteur français contemporain le plus lu dans le monde (sondage Opinionway, 18 mars 2015). Roman à l’eau de rose, littérature sentimentale, romance : voici...
-
GENRES LITTÉRAIRES, notion de
- Écrit par Guy BELZANE
- 1 847 mots
...quadripartition aristotélicienne (dramatique haut, dramatique bas, narratif haut, narratif bas), il n'était presque rien dit du dernier terme (la parodie). Cette case demeurée vide semble faite pour accueillir le roman, qui n'est autre qu'une représentation d'actions de personnages inférieurs en mode narratif.... -
AFRIQUE DU SUD RÉPUBLIQUE D' ou AFRIQUE DU SUD
- Écrit par Ivan CROUZEL, Dominique DARBON, Benoît DUPIN, Universalis, Philippe GERVAIS-LAMBONY, Philippe-Joseph SALAZAR, Jean SÉVRY, Ernst VAN HEERDEN
- 29 784 mots
- 28 médias
Le roman forme l'essentiel de l'activité littéraire. Le romancier afrikaner choisit, durant cette période, de donner à sa langue une dimension qu'elle ne possède pas encore. Il s'agit de produire, aussi rapidement que possible, l'équivalent d'une quelconque littérature romanesque européenne. Le roman,... -
ALLEMANDES (LANGUE ET LITTÉRATURES) - Littératures
- Écrit par Nicole BARY, Claude DAVID, Claude LECOUTEUX, Étienne MAZINGUE, Claude PORCELL
- 24 585 mots
- 29 médias
La première moitié du xxe siècle est, en Allemagne comme ailleurs, l'âge des sommes romanesques. Si certains, comme Heinrich Mann (1871-1950), s'en tenaient à l'image satirique et à la caricature, son frère Thomas (1875-1955) érigeait ses architectures savantes, où thèmes et leitmotive s'enchevêtrent... -
ANGLAIS (ART ET CULTURE) - Littérature
- Écrit par Elisabeth ANGEL-PEREZ, Jacques DARRAS, Jean GATTÉGNO, Vanessa GUIGNERY, Christine JORDIS, Ann LECERCLE, Mario PRAZ
- 28 170 mots
- 30 médias
La publication, en 1922, de Ulysses changea radicalement la conception du roman. Joyce avait révélé les possibilités illimitées offertes par le jeu avec et sur le langage. Dès les années 1930, cependant, les romanciers anglais réagissaient contre les innovations de leurs grands prédécesseurs, pour en... - Afficher les 75 références
Voir aussi