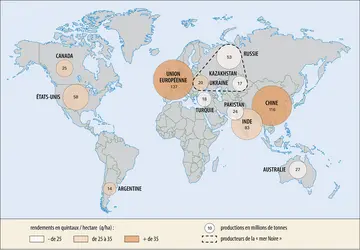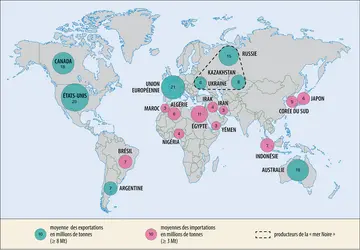BLÉ
Le blé demeure la céréale la plus consommée de façon directe par les hommes dans le monde et la plus échangée sur les marchés internationaux. Il appartient à la famille des Poacées (anciennement Graminées). Originaire des steppes semi-arides du Proche-Orient, il est étroitement associé aux peuples méditerranéens et européens. Sa culture remonte à 8000-7000 avant J.-C. Elle s'étend aujourd'hui, grâce à la diversité des variétés cultivées, sous les latitudes tempérées des deux hémisphères. Produit dans des contextes agronomiques, économiques, sociaux et politiques très divers, le blé présente des rendements à l'hectare, et encore davantage par unité de main-d’œuvre, très contrastés. Ces disparités ne manquent pas de poser problème lorsque les producteurs se trouvent confrontés, de façon plus ou moins directe en fonction des protections ou soutiens divers dont ils bénéficient, avec le cours « mondial » du blé. Le prix du blé sur le marché a cependant doublé depuis 2006, ce qui constitue un handicap pour les pays importateurs.
Le blé est principalement consommé directement par les humains (80 p. 100 de la production mondiale) sous forme de pains, galettes, pâtes, biscuits, semoules... Il sert également à quelques utilisations industrielles et en alimentation animale. Cette céréale demeure très peu utilisée pour produire de l’éthanol. Contrairement au maïs, il n’existe pas encore de variétés génétiquement modifiées mises à la disposition des agriculteurs.
Les différents types de blé
Le terme blé ou « bled » a longtemps été utilisé pour désigner l'ensemble des céréales. C'est seulement à partir du xixe siècle qu'il a été appliqué au seul froment (mot venant du latin frumentum), aujourd'hui appelé blé tendre.
Le blé, qui appartient au genre Triticum, regroupe des espèces correspondant à différents équipements chromosomiques. Compte tenu d'un génome de base comportant sept chromosomes (n = 7), on distingue un groupe diploïde (2n = 14) ou groupe de l'engrain (Triticummonococcum), un groupe tétraploïde (2 n = 28) ou groupe de l'amidonnier (Triticumdicoccum) et un groupe hexaploïde (2n = 42) ou groupe de l'épeautre (Triticumspelta).
Les blés durs (durumwheats) appartiennent au groupe des blés tétraploïdes. Adaptés aux climats semi-arides, ils ne sont pas panifiables. Ils sont donc consommés sous forme de semoules (« couscous »), de gâteaux ou de pâtes alimentaires. Ils sont principalement cultivés dans la Prairie canadienne et dans les pays du pourtour méditerranéen.
Les blés tendres ou froments relèvent du groupe des blés hexaploïdes. Ils proviennent d’un croisement, sans doute fortuit, intervenu au IIIe millénaire avant J.-C., entre un blé tétraploïde et une autre poacée, vraisemblablement Aegilops squarrosa. Très proches les uns des autres, les blés tendres appartiennent à une espèce unique : Triticumaestivum L. (ouTriticumvulgare). Le nombre de leurs cultivars (plus de 20 000) explique qu'ils puissent être cultivés sous des climats très variés, à l'exception des climats équatoriaux, humides toute l'année : ils ont en effet besoin d'une période relativement sèche en fin de cycle végétatif pour parvenir à maturité. Les blés tendres fournissent, après broyage de leurs grains puis tamisage, des farines utilisées pour fabriquer différents types de pains, des galettes, des biscuits et pâtisseries, des pizzas….
Les Anglo-Saxons distinguent, en se fondant sur les teneurs en protéines, trois grandes catégories de blés tendres:
– Les blés hard, à teneur élevée en protéines,appelés en français « blés de force » ou « blé améliorants ». Utilisés pour améliorer la valeur boulangère des farines, ils permettent de fabriquer des pains de mie (pains de type anglais).
– Les blés soft[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean-Paul CHARVET : professeur émérite à l'université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, membre de l'Académie d'agriculture de France
Classification
Pour citer cet article
Jean-Paul CHARVET. BLÉ [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
AGRICOLE RÉVOLUTION
- Écrit par Abel POITRINEAU, Gabriel WACKERMANN
- 8 076 mots
« L'habitude s'est prise de désigner, sous le nom de révolution agricole, les grands bouleversements de la technique et des usages agraires qui, dans toute l'Europe, à des dates variables selon les pays, marquèrent l'avènement des pratiques de l'exploitation contemporaine » (Marc Bloch)....
-
AGRICULTURE - Agriculture et industrialisation
- Écrit par François PAPY
- 7 421 mots
- 3 médias
...qui leur assure une bonne qualité sanitaire. Dans une course continue, les facteurs et conditions qui limitent le rendement sont, pas à pas, supprimés. La culture du blé illustre bien cette évolution vers un usage de plus en plus grand de produits chimiques de synthèse. Pour se rapprocher du potentiel,... -
AGROMÉTÉOROLOGIE
- Écrit par Emmanuel CHOISNEL, Emmanuel CLOPPET
- 6 627 mots
- 7 médias
Unexemple classique du risque de forte chaleur est l'« échaudage » du blé. C'est un accident de croissance des grains qui peut se produire pendant une période d'une dizaine de jours, appelée « palier d'eau », lequel se situe immédiatement avant la phase de maturation physiologique du grain, au cours... -
ARGENTINE
- Écrit par Jacques BRASSEUL, Universalis, Romain GAIGNARD, Roland LABARRE, Luis MIOTTI, Carlos QUENAN, Jérémy RUBENSTEIN, Sébastien VELUT
- 37 033 mots
- 18 médias
- Afficher les 34 références
Voir aussi