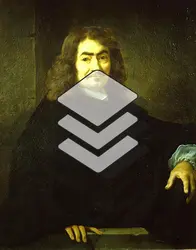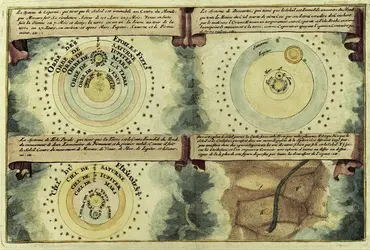DESCARTES RENÉ (1596-1650)
- 1. La vocation intellectuelle
- 2. L'œuvre et sa publication
- 3. La méthode et le projet de science universelle
- 4. La science cartésienne
- 5. Science et métaphysique
- 6. La métaphysique : le doute et le « je pense »
- 7. La métaphysique : les idées et Dieu
- 8. La véracité divine et le problème de l'erreur
- 9. L'homme concret
- 10. Bibliographie
L'homme concret
Des questions embarrassantes
En dehors de Dieu, substance incréée et infinie, il existe, selon Descartes, deux sortes de substances, des substances créées, immatérielles et pensantes : les âmes ; des substances créées, matérielles et étendues : les corps. Nous pouvons penser l'âme sans faire intervenir l'idée du corps, et réciproquement. Nous avons donc de l'âme et du corps deux idées « distinctes » et, la véracité divine garantissant la correspondance entre la distinction des idées et celle des choses, nous pouvons conclure que l'âme n'a pas besoin du corps pour exister, ni le corps de l'âme, autrement dit que la substance spirituelle et la substance corporelle sont réellement distinctes.
Il n'en reste pas moins que l'homme est composé de ces deux substances, et résulte de l'union, voulue par Dieu, d'une âme et d'un corps. Or, dans les années qui suivent la publication des Méditations, Descartes est amené à réfléchir, plus qu'il ne l'avait fait jusqu'alors, sur les problèmes posés par cet homme concret. D'une part, son disciple Regius, se croyant fidèle à la philosophie de Descartes, soutient que l'homme est un être par accident (ens per accidens), c'est-à-dire une rencontre. Une telle affirmation, opposée à la doctrine de l'École, lui vaut maint ennui, et Descartes doit préciser que, selon lui, l'homme est, sinon, à proprement parler, une substance, du moins un être par soi (ens per se). D'autre part la princesse Élisabeth, avec laquelle, à partir de 1643, la correspondance de Descartes est abondante, pose de bien embarrassantes questions. Fidèle aux enseignements du cartésianisme, elle ne parvient pas à concevoir l'union de l'âme et du corps, et demande à Descartes de l'éclairer. Comment comprendre en effet qu'une volonté puisse mouvoir la matière, ou qu'un mouvement de matière puisse produire une douleur ? Ayant divisé l'homme en deux substances, Descartes pourra-t-il les réunir ?
En vérité, Descartes avait déjà noté que l'âme n'est point dans le corps « ainsi qu'un pilote en son navire ». Si, en effet, remarque-t-il en la Méditation sixième, l'âme avait une telle position par rapport au corps, « lorsque mon corps est blessé, je ne sentirais pas pour cela de la douleur, moi qui ne suis qu'une chose qui pense, mais j'apercevrais cette blessure par le seul entendement, comme un pilote aperçoit par la vue si quelque chose se rompt en son vaisseau ». Autrement dit, un esprit uni du dehors à un corps verrait ce corps à titre d'objet. L'expérience de l'affectivité prouve suffisamment que tel n'est pas le cas pour l'homme.
Mais cette constatation n'est pas une explication. Et il faut reconnaître que, aux questions que lui pose Élisabeth, Descartes ne fournit aucune réponse proprement explicative. Pour caractériser l'union de l'âme et du corps, il invoque une troisième notion primitive, et déclare que c'est « en usant seulement de la vie et des conversations ordinaires et en s'abstenant de méditer et d'étudier aux choses qui exercent l'imagination qu'on apprend à concevoir l'union de l'âme et du corps ». Renonçant même à la règle de la distinction des idées, il supplie Élisabeth « de vouloir attribuer [....] matière et [...] extension à l'âme, car cela n'est autre chose que la concevoir unie au corps ». On le voit, cela revient à dire que le problème de l'union se situe en dehors de la philosophie, et même qu'on ne peut concevoir cette union qu'en cessant de philosopher.
Les passions et la liberté
Et pourtant, s'il en est ainsi, ne faut-il pas renoncer à la morale ? Car la morale s'adresse à l'homme concret, à l'homme fait de désirs et de passions,[...]
- 1. La vocation intellectuelle
- 2. L'œuvre et sa publication
- 3. La méthode et le projet de science universelle
- 4. La science cartésienne
- 5. Science et métaphysique
- 6. La métaphysique : le doute et le « je pense »
- 7. La métaphysique : les idées et Dieu
- 8. La véracité divine et le problème de l'erreur
- 9. L'homme concret
- 10. Bibliographie
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Ferdinand ALQUIÉ : professeur honoraire à l'université de Paris-Sorbonne, membre de l'Institut (Académie des sciences morales et politiques)
Classification
Pour citer cet article
Ferdinand ALQUIÉ. DESCARTES RENÉ (1596-1650) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
DESCARTES ET L'ARGUMENTATION PHILOSOPHIQUE (dir. F. Cossutta)
- Écrit par Jean LEFRANC
- 1 443 mots
L'œuvre de Descartes, qui fonde le rationalisme des temps modernes, peut-elle résister aux analyses réductrices des sociologues, des linguistes, des théoriciens de l'argumentation ? La philosophie doit-elle se résigner à n'être qu'un phénomène social, un « reflet » selon les marxistes,...
-
LA DIOPTRIQUE (R. Descartes)
- Écrit par Bernard PIRE
- 180 mots
René Descartes (1596-1650) publie à Leyde (Hollande) La Dioptrique en appendice de son Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Il y montre que sa méthode est supérieure à la façon commune. Dans les deux premiers discours, intitulés « De la...
-
DISCOURS DE LA MÉTHODE, René Descartes - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 1 003 mots
-
MÉDITATIONS MÉTAPHYSIQUES, René Descartes - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 985 mots
Les Méditations métaphysiques (Meditationes de prima philosophia, 1641) sont la première œuvre proprement philosophique de Descartes (1596-1650), et d'ailleurs le premier ouvrage publié sous son nom. Alors que le Discours de la méthode (1637) garde un caractère de circonstance, ne se voulant...
-
LES PASSIONS DE L'ÂME, René Descartes - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 885 mots
- 1 média
Paru en novembre 1649 à Paris et Amsterdam, rédigé directement en français comme le Discours de la méthode(1637), Les Passions de l'âmeest le dernier grand ouvrage de René Descartes (1596-1650), installé depuis peu à Stockholm, et le dernier texte publié de son vivant. Il s'agit d'abord,...
-
AFFECTIVITÉ
- Écrit par Marc RICHIR
- 12 228 mots
...aller de soi. C'est particulièrement frappant, dans le champ politique, chez Machiavel et chez Hobbes, dans le champ plus proprement philosophique chez Descartes, pour qui, on le sait, le réamorçage de la philosophie ne peut se faire qu'à travers l'épreuve du doute, non seulement méthodique, mais hyperbolique.... -
ALQUIÉ FERDINAND (1906-1985)
- Écrit par Jean BRUN
- 1 586 mots
Né à Carcassonne, Ferdinand Alquié avait gravi tous les échelons de la carrière universitaire ; ayant commencé comme maître d'internat, il devait devenir professeur à la Sorbonne puis membre de l'Institut. Son œuvre, très importante, relève à la fois de la philosophie et de l'histoire...
-
ARCHITECTURE (Thèmes généraux) - Architecture et philosophie
- Écrit par Daniel CHARLES
- 5 459 mots
Le texte des Réponses aux septièmes objections est significatif : Descartes se compare à un architecte qui « creuse » jusqu'au « roc » (c'est-à-dire qui doute jusqu'au cogito) afin de construire enfin quelque chose de bien fondé. Cependant, le « fond » que découvre Descartes... -
ASÉITÉ
- Écrit par Marie-Odile MÉTRAL-STIKER
- 829 mots
Appartenant strictement à la langue philosophique, le terme « aséité », qui évoque inévitablement la causa sui de Spinoza, désigne la propriété de ce qui a sa propre raison d'être en soi-même et n'est pas relatif à un autre pour ce qui est de son existence. Sur ce sens général,...
- Afficher les 124 références
Voir aussi
- ANIMAL-MACHINE THÉORIE DE L'
- ONTOLOGIQUE PREUVE
- RÉFLEXION & RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE
- REPRÉSENTATION & CONNAISSANCE
- GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE
- DÉDUCTION
- IDÉE
- COGITO
- NATURE IDÉE DE
- CERTITUDE
- PHILOSOPHIE HISTOIRE DE LA
- LOGIQUE HISTOIRE DE LA
- MATHÉMATIQUES HISTOIRE DES
- PERFECTION IDÉE DE
- BIOLOGIE HISTOIRE DE LA