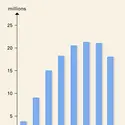GRÈVE
Sociologie des grèves modernes
Le monde salarié s'est approprié les principaux éléments qui caractérisent la civilisation industrielle au xxe siècle et les a appliqués aux grèves. Parmi eux, on peut noter : la rationalisation scientifique, d'où l'effort pour rationaliser et planifier tout l'ensemble des grèves dont les formes ont profondément changé ; la primauté dévolue à l'économique, d'où l'assignation d'objectifs économiques et gestionnaires s'ajoutant aux classiques revendications de salaires et modifiant le but des grèves ; l'influence croissante de la publicité, d'où le fait que la grève tend à devenir elle aussi un phénomène d'opinion, destiné à frapper le grand public ; la montée progressive des cadres et techniciens, d'où l'extension de la grève à de nouveaux participants.
Le développement de nouvelles formes de grève
Les grèves illimitées du type de celles qui ont inspiré Zola dans son célèbre Germinal sont en régression sensible à notre époque. Tous les grévistes cessaient le travail en même temps, les lieux du travail étaient déserts, le manque à gagner se faisait de plus en plus lourd à mesure que les journées de non-salaire s'accumulaient, bref, c'étaient des grèves « d'usure ». La grève des mineurs de 1963, en France, appartenait encore à ce type. Mais les syndicats ont constaté qu'une action répétée, coordonnée et plus « légère », se déroulant suivant un plan bien établi, était susceptible d'avoir une répercussion plus importante sur la marche de l'entreprise. En effet, elle est capable de désorganiser le planning de production tout en diminuant par ailleurs les sacrifices pécuniaires de chacun des travailleurs. Les grèves sont donc beaucoup moins « héroïques » et beaucoup plus « techniques » au xxe siècle, au point que Serge Mallet, en étudiant « la nouvelle condition ouvrière », qualifie les arrêts modernes de travail de « grèves presse-bouton ».
Certaines sont « tournantes », affectant un atelier après l'autre, une catégorie de travailleurs après l'autre. Elles supposent une véritable prévision sur calendrier, avec détermination précise de l'échelonnement des divers niveaux de production où devront se produire les débrayages successifs. Elles ont évidemment un effet perturbateur tant d'un point de vue technique que social. Le trafic de la gare Saint-Lazare fut ainsi désorganisé pendant six jours, alors que la durée de la grève n'avait été que de trois heures par gréviste. De tels mouvements sociaux se répercutent sur le travail des ouvriers non grévistes.
D'autres sont courtes et répétées. Les grévistes « débrayent » lorsqu'ils demeurent sur les lieux du travail pendant le court laps de temps de la grève (une demi-heure ou une heure). La cadence des grèves, leur « période » sont également des données méditées et décidées en un plan général.
Les grèves sont dites « perlées » lorsqu'elles affectent le rendement et consistent en une diminution volontaire de la cadence de production (les fondeurs par exemple n'assurent qu'une production de fonte égale à 60 p. 100 de la production habituelle). La baisse d'efficacité dans un atelier peut d'ailleurs retentir sur d'autres activités qui en dépendent.
À l'inverse, les travailleurs font une grève « de zèle » quand ils déploient une activité excessive. Ils observent minutieusement les formalités, en un surcroît soudain d'attention (grève des douaniers, des postiers, des agents de la navigation aérienne), embouteillant le service public et alourdissant sa gestion.
Plus récemment la pratique s'est encore affinée, mettant au point la stratégie de la « grève thrombose » ou « grève bouchon ». Une immense usine peut ainsi être bloquée[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Hélène SINAY : professeur émérite à l'université Robert-Schuman, Strasbourg, faculté de droit
- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Pour citer cet article
Universalis et Hélène SINAY. GRÈVE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
DROIT DE GRÈVE (France)
- Écrit par Bernard VALADE
- 208 mots
- 1 média
La loi votée le 25 mai 1864 modifie les articles 414-416 du Code pénal visant la grève. La répression n'est désormais prévue que dans le cas de violence, de menaces ou d'atteintes à la liberté du travail. La grève cesse donc d'être considérée comme un délit. Depuis la...
-
AFL-CIO (American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations)
- Écrit par Claude JULIEN, Marie-France TOINET
- 6 913 mots
- 2 médias
C'est alors la grande époque de l'agitation sociale aux États-Unis. La grande grève de 1877, qui atteint tous les centres ferroviaires et voit la ville de Pittsburgh occupée par les insurgés ; les événements de Haymarket en 1886 ; les grèves de Homestead en 1892, de Pullman en 1894 et de Cœur d'Alene... -
AMIENS CHARTE D' (1906)
- Écrit par Paul CLAUDEL
- 865 mots
Motion votée au IXe congrès confédéral de la C.G.T., tenu du 8 au 16 octobre 1906, la Charte d'Amiens est considérée comme le texte fondamental du syndicalisme révolutionnaire.
La C.G.T. avait été créée au congrès de Limoges en 1895 par la Fédération des Bourses du travail...
-
BELGIQUE - La période contemporaine
- Écrit par Universalis, Jean FANIEL, Xavier MABILLE
- 9 047 mots
- 2 médias
Un des événements majeurs de l'époque se situe au cœur de l'hiver de 1960-1961 : il s'agit de la grande grève en opposition à un important projet de loi du gouvernement Eyskens. La coalition des sociaux-chrétiens et des libéraux, qui était alors au pouvoir, avait jugé habile de... -
BRÉSIL - Le Brésil contemporain
- Écrit par Luiz Felipe de ALENCASTRO, Universalis
- 5 681 mots
- 4 médias
...syndicalisme combatif a charpenté l'opposition au régime. Entre 1960 et 1980, la proportion de travailleurs du secteur industriel passa de 12,9 à 24,4 %. Les grèves, déclenchées à partir de 1976, montraient que cette nouvelle classe ouvrière débordait les structures corporatives, héritées de la première... - Afficher les 33 références
Voir aussi
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, droit et institutions
- ALLEMAGNE, droit et institutions
- SÉCURITÉ SOCIALE
- SALAIRE
- CONVENTIONS COLLECTIVES
- INDUSTRIELLE SOCIÉTÉ
- FONCTIONNAIRE
- NÉGOCIATION COLLECTIVE
- SYNDICAL DROIT
- CONTRAT DE TRAVAIL
- TRAVAIL DROIT DU
- DEHAENE ARRÊT (7 juill. 1950)
- CANUTS RÉVOLTE DES (1831)
- MATIGNON ACCORDS (1936)
- TRADE UNIONS
- TAFT-HARTLEY LOI (1947)
- OUVRIÈRE CLASSE
- ROYAUME-UNI, histoire, de 1945 à nos jours
- CPE (contrat première embauche)
- GRÈVE GÉNÉRALE
- ÉTUDIANTS
- CLOSED SHOP
- LICENCIEMENT
- REVENDICATION
- SERVICE PUBLIC
- ITALIE, histoire, de 1945 à nos jours
- CONCILIATION
- ALLEMAGNE RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D' (RFA), histoire depuis 1990
- GRENELLE ACCORDS DE (1968)
- AUROUX LOIS (1982)
- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1945 à nos jours
- FRANCE, droit et institutions
- ÉMEUTE
- FRANCE, histoire, de 1958 à 1974
- FRANCE, histoire, de 1974 à nos jours
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours
- ROME, l'Empire romain
- AUTOMOBILE INDUSTRIE
- FRANCE, histoire, de 1871 à 1939
- UAW (United Automobile Workers)
- USW (United Steel Workers)
- MÉDIATION, droit du travail