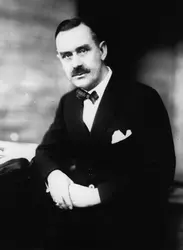CRÉATION LITTÉRAIRE
Genèse du mythe, génie du lieu
Il est banal de dire que les « lieux » littéraires sont devenus des lieux sacrés. À jamais le modeste chemin qui mène aux Charmettes et ses pervenches printanières ont pris, grâce aux Confessions, l'ampleur d'une route et de stations de pèlerinage. Ce lac près d'Aix-les-Bains que Lamartine, lors d'un très bref séjour, a immortalisé dans un célèbre poème rejoint la rive de l'Arno à jamais fixée par la rencontre de Béatrice. L'idéal classique avait bien souligné, dans la règle de l'unité de lieu, l'importance pour ainsi dire incantatoire du topos. Mais Macbeth, La Tempête, Hamlet ou Le Roi Lear peuvent-ils dresser leur transcendance tragique sans la lande et les antres de sorcières, sans l'île déserte, la terrasse d'Elseneur, la désolation déjà en soi catastrophique des paysages maudits où erre l'infortuné roi fou ? Il ne s'agit pas du tout d'une émanation réaliste de l'œuvre à partir de la description géographique. Tout au contraire, il faut, plus que jamais, revenir à une espèce de Rezeptionstheorie : ce n'est pas la Provence qui « inspire » l'œuvre de Mistral, celles de Giono ou de Bosco, ce sont au contraire Mireille – renforcée par l'opéra et les livrets de L'Arlésienne ou de Mireille –, Le Mas Théotime ou Regain, sans oublier les Lettres de mon moulin, qui ont érigé une Provence légendaire. Que l'origine « provençale » des auteurs ne fasse pas illusion : le mythe que crée leur œuvre, ce mythe d'un régionalisme puissant jusqu'à la sécession linguistique des félibres est créé de toute pièce aussi certainement que la Calédonie des poèmes ossianesques, l'Espagne de Mérimée ou de Montherlant, l'Alsace d'Erckmann et Chatrian, la Sologne d'Alain Fournier, la Lorraine de Barrès. Ce sont les romans et les poèmes qui « inventent » les paysages de l'âme. Ernst Benz, partant d'une réflexion sur le « paysage culturel » de Pétrarque, montre bien que, dans les paysages et les hauts lieux littéraires et religieux tels que Montserrat, San Francisco, le mont Athos, le Grand Canyon ou Sakurashima, c'est l'investissement affectif, culturel, légendaire qui choisit, crée, prône le paysage. Nous avions proposé naguère le terme de « décor mythique » pour exprimer cet impératif créateur de l'écriture littéraire qui privilégie tel ou tel regard sur les espaces et sur les choses. Nous montrions alors comment Stendhal privilégie, pour exalter tel ou tel sens de l'œuvre, soit un « portant épique », soit un « portant mystique » du décor : portants qui vont situer, dansLa Chartreuse de Parme, une Italie imaginaire, mais qui n'en viennent pas moins soit des souvenirs d'enfance de Beyle lors de ses séjours bénis près des luoghi ameni aux confins de la Savoie et du Dauphiné, soit des lectures de l'Arioste et du Tasse... La prégnance créatrice de l'œuvre est si forte que l'on peut dire de la littérature ce que Malraux dit de la peinture : « On ne peint pas d'après la nature, mais d'après la peinture. » Autrement dit, toute une géographie littéraire – à laquelle n'échappe pas la géographie tout court ! – est créée, quelquefois de toutes pièces, comme l'Afrique de Raymond Roussel ou la Comté et le Mordor de Tolkien, par l'œuvre littéraire, ou plus haut encore dans le temps par le récit religieux. Que seraient Jérusalem, la Galilée, la Judée, la Palestine sans l'immense image créatrice lancée par la Bible, reprise de siècle en siècle par l'écriture de saint Bernard, de Jean de la Croix, de Racine, de Hugo ou de Thomas Mann ? Pour en revenir à notre exemple stendhalien, rappelons que l'écrivain éprouve le besoin d'un changement de décor – tout comme le dramaturge[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Gilbert DURAND : professeur à l'université de Grenoble
Classification
Pour citer cet article
Gilbert DURAND. CRÉATION LITTÉRAIRE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
ART (Aspects esthétiques) - La contemplation esthétique
- Écrit par Didier DELEULE
- 3 634 mots
...plaisir en assistant au spectacle tragique ? C'est d'abord pour Freud un problème d'ars poetica et il s'en explique dans un article de 1908, « La Création littéraire et le rêve éveillé ». L'artiste est celui qui atténue le caractère égotique du rêve diurne au moyen de changements et de voiles... -
ART POUR L'ART
- Écrit par Florence FILIPPI
- 1 084 mots
-
ARTS POÉTIQUES
- Écrit par Alain MICHEL
- 5 904 mots
- 3 médias
Dès lors, l'influence de Mallarmé va se diviser en deux courants. Le premier, qu'illustre Valéry, met dans la création poétique l'accent sur le rôle de l'« intellect ». L'auteur décrit les démarches de l'esprit dans leur spécificité artistique, en se référant à un des maîtres les plus profonds de... -
BACHELARD GASTON (1884-1962)
- Écrit par Jean-Jacques WUNENBURGER
- 3 478 mots
- 1 média
...(particulièrement son enfance rêvée) à des réseaux de signification d’images transindividuelles, dont témoignent les mythes. Bachelard développe ainsi progressivement unepsychologie de la création, qui retrouve l'inspiration de la « fantastique transcendantale » chère au poète romantique Novalis. - Afficher les 24 références
Voir aussi