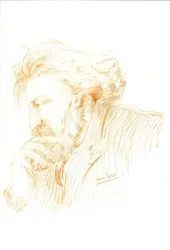BACHELARD GASTON (1884-1962)
L'œuvre du philosophe français Gaston Bachelard est dominée par deux thématiques bien distinctes, développées dans deux séries d’ouvrages aux références et aux lecteurs bien différents. Bachelard constitue de ce fait une figure singulière du paysage intellectuel français. Il échappe à toute simplification et se range malaisément dans une école de pensée. C'est bien cette singularité, mais aussi cette complexité et cette richesse qui rassemblent autour de lui tant de lecteurs dans le monde entier. Ceux-ci trouvent dans son œuvre des ressources inégalées de savoir, mais aussi des intuitions, des orientations de vie ou de pensée aux formes souvent insoupçonnées.
Gaston Bachelard est né le 27 juin 1884 à Bar-sur-Aube (Champagne). Marqué par sa participation aux combats de la Première Guerre mondiale et le décès en 1920 de sa jeune épouse, il doit gagner sa vie comme préposé aux postes, puis comme professeur de physique et de chimie au collège de Bar-sur-Aube. Après des études tardives de philosophie, il entre comme professeur à la faculté des lettres de Dijon (1930-1940), avant d’achever sa carrière à la prestigieuse chaire d'histoire et de philosophie des sciences de la Sorbonne à Paris (1940-1955). Cet itinéraire académique comprend d'abord des travaux d'histoire et de philosophie des sciences, en pleine révolution de leurs fondements et résultats (relativité, mécanique quantique), afin de mieux comprendre les formes de développement psychologique et historique et la valeur éducative et citoyenne de la rationalité objective (Le Nouvel Esprit scientifique, 1934). À partir des années 1935, des recherches sur les processus de l'imagination créatrice, dans ses dimensions temporelle et spatiale, débouchent sur une description systématique de la rêverie, fondée sur la symbolique des quatre éléments.
L’analyse de l’esprit scientifique est marquée par la primauté du concept abstrait, affirmée par le rationalisme qui conduit de Descartes aux Lumières. S’y imposent une vision linéaire des progrès de la raison, chère à Auguste Comte, et un idéalismemathématique hérité de Léon Brunschvicg. Au contraire, la conception de l'imaginaire que formule Bachelard ne manque pas de faire écho à la cosmologie des présocratiques, aux pouvoirs de l'imagination chez les penseurs de la Renaissance (néo-platonisme et alchimie, en tant qu'elle conjuguait matérialisme et spiritualisme), aux théories de l'idéalisme allemand (Fichte, Hegel, Schelling), et enfin aux idées de Schopenhauer, Nietzsche et Freud.
La rationalité scientifique
À partir de son doctorat de philosophie (Essai sur la connaissance approchée, 1927), Bachelard va chercher à comprendre l’aventure scientifique, celles des mathématiciens, physiciens, chimistes. Parmi les premiers, il s’efforce d’interpréter les hypothèses novatrices de la physique mathématique, à l'échelle de l'infiniment grand (la vitesse de la lumière) ou de l'infiniment petit (le monde atomique et subatomique). Comme son maître Léon Brunschvicg, il va privilégier, le mouvement de la raison par lequel concept et réel se rapprochent progressivement l'un de l'autre, tout en restant limités à une connaissance phénoménale et non élargie au monde en soi, comme le pensent divers scientismes.
Gaston Bachelard s’efforce d’abord de rendre compte de la construction du savoir scientifique et de la suite de « ruptures » épistémologiques qu’il lui faut accomplir aussi bien avec les croyances de l'opinion et de l'évidence naturelle, qu'avec un expérimentalisme non instruit et dogmatique (La Formation de l'esprit scientifique, 1938). Il aborde ainsi la psychologie et l'éducation de l'esprit scientifique en mettant en évidence la confrontation impérative du concept aux images spontanées, toujours chargées de motifs inconscients,[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean-Jacques WUNENBURGER : professeur émérite de philosophie à l'université Jean-Moulin, Lyon
Classification
Pour citer cet article
Jean-Jacques WUNENBURGER. BACHELARD GASTON (1884-1962) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Média
Autres références
-
LA POÉTIQUE DE LA RÊVERIE, Gaston Bachelard - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 784 mots
L'œuvre de Gaston Bachelard (1884-1962) apparaît double, et bien des commentateurs ont interrogé cette duplicité. Philosophe et historien des sciences, il mène au nom du « concept » une guerre sans merci à « l'imagination » et n'a de cesse de marquer (par exemple dans La...
-
APPRENTISSAGE PROFOND ou DEEP LEARNING
- Écrit par Jean-Gabriel GANASCIA
- 2 645 mots
- 1 média
...intrinsèque à l’apprentissage supervisé qui tient au langage de description des exemples : celui-ci demeure figé et ne peut s’accroître automatiquement. Or, ce que le philosophe américain et historien des sciences Thomas Kuhn (1922-1996) appelle des « révolutions scientifiques », ou ce que le Français... -
COBRA, mouvement artistique
- Écrit par Catherine VASSEUR
- 2 421 mots
- 1 média
...expériences respectives de ses membres. Le poète Dotremont, qui fut d'abord en contact avec Raoul Ubac et les surréalistes belges, gagne Paris en 1940. Il y rencontre Gaston Bachelard et collabore, à partir de 1941, à La Main à plume, revue clandestine animée par Noël Arnaud, avec lequel il fondera,... -
CRITIQUE LITTÉRAIRE
- Écrit par Marc CERISUELO, Antoine COMPAGNON
- 12 918 mots
- 4 médias
Cette psychologie des profondeurs rejoint la critique thématique française de Gaston Bachelard et de Jean-Pierre Richard, fondée sur l'étude des sensations. La catégorie fondamentale reste l'imaginaire et l'hypothèse essentielle est toujours l'unité d'une conscience créatrice, donc de l'œuvre entière... -
EAUX SYMBOLISME DES
- Écrit par Gilbert DURAND
- 4 082 mots
- 1 média
...officiel » de la fécondité aquatique toutes les configurations que repèrent des psychanalystes comme Marie Bonaparte dans son ouvrage sur Edgar Poe, ou Gaston Bachelard dans le chapitre « L'Eau maternelle et l'eau féminine » (L'Eau et les rêves). Bachelard se plaît à repérer dans l'eau... - Afficher les 26 références
Voir aussi