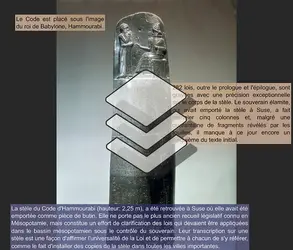CODIFICATION
Les termes « code », « codifier », « codification » sont des pavillons qui couvrent des marchandises diverses et parfois frelatées. La race des codes est considérée comme noble, plus que celle des lois ou des décrets, de sorte que l'on a vu publier en France, par exemple, un « code des restaurants ». Si l'on exclut les abus de langage, on peut définir un code comme un ensemble de textes juridiques classés selon un ordre chronologique ou systématique et concernant soit la totalité du droit d'un pays ou d'une société, soit une matière particulière. À l'intérieur de cette définition générale, des distinctions doivent être faites.
Certains codes ne sont que des compilations, qui peuvent être d'origine publique ou privée. Publique : le gouvernement décide de regrouper tous les textes antérieurs et d'y ajouter au fur et à mesure les textes nouveaux, sans les modifier ni les ordonner ; c'est seulement un moyen commode de les retrouver et de savoir lesquels sont en vigueur. Privée : des juristes ou des éditeurs prennent l'initiative de tels regroupements, généralement par matières, pour la commodité des praticiens, sans que leur œuvre ait une valeur juridique officielle.
D'autres codes, qui ne reçoivent d'ailleurs pas toujours cette appellation, sont en réalité des actes de « coordination » ou de « consolidation », consistant, à l'occasion d'une loi nouvelle, à reprendre les lois antérieures que celle-ci modifie, afin d'en faciliter la lecture et la compréhension.
Les deux catégories qui suivent sont les plus importantes. Il s'agit, d'une part, des grandes œuvres réformatrices qui rénovent l'ensemble d'une matière et qui mêlent dans un texte unique la reprise de règles traditionnelles et la formulation de règles nouvelles. Le Code civil français de 1804 en est sans doute l'exemple le plus connu. Il s'agit, d'autre part, de la mise en ordre du droit existant, avec une répartition rationnelle des matières entre les codes et une organisation méthodique de chacun d'entre eux. Cette entreprise est plus modeste que les précédentes, parce qu'elle ne comporte pas d'innovations ; mais elle est, en un sens, plus ambitieuse, car elle vise à ordonner ainsi la plus grande partie du droit, sinon sa totalité.
Quelle que soit leur catégorie, les codes ne se définissent pas par leur niveau dans la hiérarchie des normes ; ils n'ont pas d'autre valeur que celle des textes qu'ils reprennent ou qu'ils édictent – lois, décrets, arrêtés, coutumes. Quant à la codification, elle n'est rien d'autre qu'une opération ou une politique de fabrication de codes, par regroupement de normes anciennes ou création de normes nouvelles.
Les origines de la codification
La codification est une vieille ambition de l'humanité. Les plus anciens codes aujourd'hui connus apparaissent en Mésopotamie deux mille ans avant notre ère. Après le Code d'Our-Nammou, rédigé en réalité, semble-t-il, par son fils Shoulgi (2094-2047 av. J.-C.), et le Code d'Eschouna (vers 1800 av. J.-C.), du nom d'une ville, le plus complet et le plus intéressant est le célèbre Code d'Hammourabi (première moitié du xviiie s. av. J.-C.). Ce n'est pas seulement un recueil de jurisprudence, comme on l'a parfois écrit ; c'est une œuvre législative, ordonnée et novatrice, de 282 articles encadrés par un prologue et un épilogue, qui, tout en groupant certaines règles posées par les tribunaux, repose sur une philosophie politique et tend à substituer un droit étatique à des usages particuliers. Ce code a été recopié par des scribes pendant quinze siècles environ, ce qui montre l'importance qu'il a eue dès l'Antiquité.
La Bible offre dans la première partie de l'Ancien Testament, le[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Guy BRAIBANT : président de section au Conseil d'État, président de l'Institut international des sciences administratives, vice-président de la Commission supérieure de codification
Classification
Pour citer cet article
Guy BRAIBANT. CODIFICATION [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Média
Autres références
-
CODIFICATION (sociologie)
- Écrit par Laurence DUMOULIN
- 1 348 mots
Le terme codification fait immédiatement référence au monde du droit. Codifier, c’est réunir dans un même volume un ensemble de règles qui sont non seulement matériellement regroupées au même endroit, mais aussi ordonnées et hiérarchisées entre elles. Il est courant de distinguer deux formes de codification,...
-
ASSURANCE - Histoire et droit de l'assurance
- Écrit par Jean-Pierre AUDINOT, Universalis, Jacques GARNIER
- 7 490 mots
- 1 média
Cette codification sera perfectionnée au xviie siècle, notamment par l'Ordonnance de Colbert (1681), qui aura une grande influence sur le développement ultérieur du droit des assurances maritimes. -
CANONIQUE DROIT
- Écrit par Patrick VALDRINI
- 8 003 mots
Le recours à la codification, bien que maintenant admis et habituel dans l'Église, est un phénomène tardif dans l'histoire des sources du droit canonique. Les premiers âges ont donné une forme au droit de l'époque en le présentant, dès le ive siècle, dans des collections réunissant... -
CHINE - Droit
- Écrit par Jean-Pierre CABESTAN
- 10 329 mots
- 1 média
...contribué à la puissance de l'Occident, favoriser le renforcement de la nation, donc de l'État chinois face à ce dernier. C'est pourquoi, si les efforts de codification et de modernisation du droit positif ont été réels, au cours de la dernière décennie de l'Empire mandchou, grâce notamment à des réformateurs... -
CODE CIVIL ALLEMAND (Bürgerliches Gesetzbuch)
- Écrit par Jacqueline BARBIN
- 602 mots
Le Bürgerliches Gesetzbuch (Code civil allemand), qui entra en vigueur dans l'Empire allemand en 1900, a été appliqué dans la République démocratique allemande jusqu'à l'unification.
Ce Code est divisé en cinq parties. La première est générale et définit les concepts relatifs...
- Afficher les 30 références
Voir aussi
- CONVENTION NATIONALE, Révolution française
- SOCIALISTE DROIT
- ANTIQUE DROIT
- CODE DE COMMERCE
- CODE DU TRAVAIL
- INSTITUTES
- COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
- JAPON, droit et institutions
- COMPILATIONS JURIDIQUES
- DROIT ÉCRIT
- SERVICE PUBLIC
- FRANÇAIS ANCIEN DROIT
- ANGLAIS DROIT
- FRANCE, droit et institutions
- ROME, l'Empire romain
- TESTAMENT ANCIEN
- FRANCE, histoire, du XVIe s. à 1715
- FRANCE, histoire, de 1789 à 1815
- FISCAL DROIT
- DROIT, histoire