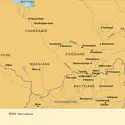BIJOUX
Moyen Âge occidental
Un grand nombre d'objets du haut Moyen Âge nous sont parvenus grâce à la coutume d'ensevelir les morts accompagnés de leur parure. Les bijoux retrouvés dans les tombes manifestent le goût de cette époque pour l'or et pour le décor de pierres et verres colorés, souvent sertis à froid dans un réseau géométrique formé par des cloisons soudées préalablement, selon la technique de l'orfèvrerie cloisonnée. L'ensemble mis au jour à Saint-Denis en 1959 est tout à fait exemplaire : il comportait deux fibules circulaires en orfèvrerie cloisonnée, trois épingles, des garnitures de baudrier, de chaussures et de jarretières, des éléments de ceinture, ainsi qu'un anneau d'or portant une inscription et un monogramme, lus ARNEGUNDIS REGINE, ce qui conduisit à identifier la défunte avec Aregonde, l'une des femmes de Clotaire Ier (497-561).
Les bijoux conservés de l'époque carolingienne sont beaucoup moins nombreux. Les textes décrivent Charlemagne et son entourage parés, lors des cérémonies importantes, de diadèmes, colliers, pectora et agrafes d'or enrichis de pierres précieuses, mais très peu d'objets permettent de confirmer l'existence de ces ornements luxueux. Le pendentif connu sous le nom de Talisman de Charlemagne (Trésor de la cathédrale, Reims) est sans doute postérieur au règne de l'empereur et date plus probablement de la seconde moitié du ixe siècle ; il est cependant un exemple de ces bijoux portés sur la poitrine mentionnés par les textes. Quelques pendentifs de cristal de roche gravé sont également conservés ; le plus somptueux est celui dit « de Lothaire », orné de scènes de l'histoire de Suzanne faisant sans doute allusion à l'affaire du divorce de Lothaire II (795-869), qui provient de l'abbaye de Waulsort (British Museum, Londres). Autre décor typique de l'art carolingien, l'émail cloisonné sur or, recouvre la couronne du Trésor de Monza, selon des motifs proches de ceux de l'autel d'or de Milan, don de l'évêque Angilbert.
Dans la partie orientale de l'ancien empire carolingien, les souverains ottoniens (936-1024) puis saliens (1024-1125) se veulent les successeurs des empereurs carolingiens. Quelques parures précieuses exécutées à leur demande sont conservées, comme la Couronne du Saint Empire (Schatzkammer, Vienne), dont le décor associe or, pierres précieuses et émaux cloisonnés : le bandeau fut exécuté pour Otton Ier ou Otton II dans la seconde moitié du xe siècle, tandis que l'étrier (la partie supérieure) fut ajouté pour le couronnement impérial de Conrad II en 1027. L'ensemble de bijoux découverts à Mayence en 1880 (Kunstgewerbemuseum, Berlin, et Landesmuseum, Mayence) appartint très probablement à une impératrice, que l'on a proposé d'identifier avec Gisela, épouse de Conrad II, ou avec Agnès, épouse de Henri III (1017-1056). Certaines pièces, principalement un collier et un grand ornement de poitrine, témoignent d'une forte influence byzantine, tandis que d'autres, comme le fermail circulaire et la fibule émaillée ornée d'un aigle présentent d'étroits parallèles avec l'orfèvrerie de la première moitié du xie siècle.
Peu de bijoux de l'époque romane sont conservés. Ce sont surtout des anneaux, comme ceux, au décor très simple, mis au jour à Lark Hill, en Angleterre (British Museum, Londres), avec des monnaies de l'époque de Henri Ier (1069-1135) ou celui qui aurait été trouvé dans la tombe de l'évêque Maurice de Sully (1120-1196) à Notre-Dame de Paris (Louvre) dont le jonc porte un décor niellé associant monstres et rinceaux.
Si les couronnes des rois et reines de France autrefois conservées à Saint-Denis ont disparu, les bijoux du xiiie siècle nous sont cependant parvenus[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Sophie BARATTE : archiviste-paléographe, conservateur du Patrimoine, conservateur au département des Objets d'art du musée du Louvre
- Catherine METZGER : conservateur en chef au musée du Louvre, département des Antiquités grecques, étrusques et romaines
- Évelyne POSSÉMÉ : conservateur au musée des Arts décoratifs
- Elisabeth TABURET-DELAHAYE : conservateur en chef au département des Objets d'art du musée du Louvre
- Christiane ZIEGLER : agrégée d'histoire, docteure en égyptologie Université de Paris-IV Sorbonne, conservarice générale, directrice de la mission archéologique du Louvre à Saqqara (Égypte), directrice honoraire du département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre, conseillère scientifique du Louvre Abou Dabi
- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Pour citer cet article
Sophie BARATTE, Universalis, Catherine METZGER, Évelyne POSSÉMÉ, Elisabeth TABURET-DELAHAYE et Christiane ZIEGLER. BIJOUX [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
ALBERS ANNI (1899-1994)
- Écrit par Camille VIÉVILLE
- 900 mots
Anni Albers, dont l’œuvre a parfois été occulté par celui de Josef Albers (1888-1976), son époux, est une artiste majeure de l’art textile du xxe siècle.
Née à Berlin le 12 juin 1899, Annelise Fleischmann étudie au Studienateliers für Malerei und Plastik (1916-1918) auprès du peintre postimpressionniste...
-
ARTISANAT DU BRONZE (Gaule préromaine)
- Écrit par Cécile BRETON
- 2 454 mots
- 1 média
Dans le contexte des parures de La Tène, on note une évolution locale qui semble aller vers la disparition du travail en déformation mécanique. Les parures de la période précédente, le Hallstatt, sont en effet souvent composées de tôles. D'abord extrêmement variés, les bijoux, dont la... -
ASIE CENTRALE
- Écrit par Henri-Paul FRANCFORT, Frantz GRENET
- 9 700 mots
- 4 médias
...des thèmes. Les orfèvres qui accompagnaient les conquérants nouèrent des contacts avec les artistes locaux, aboutissant à la création d'extraordinaires bijoux mixtes comme ceux qu'a révélés la nécropole de Tilla-tépé où, par exemple, l'on voit Dionysos chevaucher des animaux contorsionnés dans le plus... -
BYZANCE - Les arts
- Écrit par Catherine JOLIVET-LÉVY, Jean-Pierre SODINI
- 13 538 mots
- 10 médias
Les objets parvenus jusqu'à nous sont surtout des bijoux (colliers, croix, amulettes, médaillons, bracelets, bagues, agrafes, boucles d'oreilles, ceintures), généralement retrouvés dans des trésors enfouis dans la terre par leurs propriétaires (trésors de Chypre, de Mersin, de Mytilène, etc.). Pour la... - Afficher les 24 références
Voir aussi
- CLOISONNÉ TECHNIQUE DU
- ORIENTALISANT ART
- ÉGYPTIEN ART
- GREC ART
- OR ORFÈVRERIE D'
- ROMAIN ART
- PARURE
- MÉTAUX PRÉCIEUX, histoire
- BIJOUX, Antiquité grecque, étrusque et romaine
- BIJOUX, Égypte
- BIJOUX, Renaissance
- BIJOUX, Moyen Âge
- BIJOUX, Temps modernes
- CRISTAL DE ROCHE
- PIERRES PRÉCIEUSES
- HELLÉNISTIQUE ART
- CAROLINGIEN ART
- FUNÉRAIRE ART
- JOAILLERIE
- MÉDIÉVAL ART
- RENAISSANCE ARTS DE LA
- ROMANTIQUE ART
- SECOND EMPIRE, art, industrie, société
- TECHNIQUES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge
- TECHNIQUES HISTOIRE DES, XVIIe et XVIIIe s.