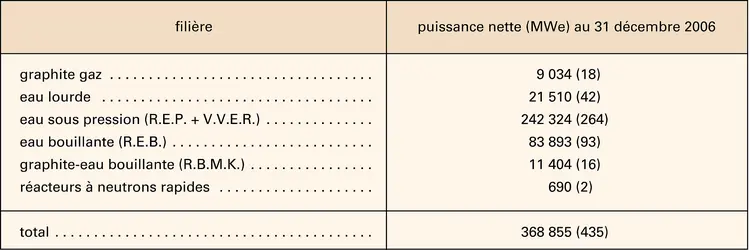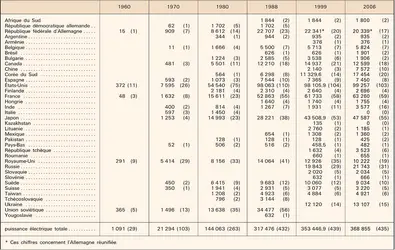NUCLÉAIRE Réacteurs nucléaires
Les filières de réacteurs nucléaires
Les réacteurs se classent, en premier lieu, d'après leur objectif : production d'électricité, propulsion navale, production de plutonium ou de tritium pour la défense nationale, production de flux intenses de neutrons pour des essais techniques ou pour la recherche fondamentale, étude de caractéristiques neutroniques avec des maquettes critiques de puissance négligeable, etc. Alors que les premiers réacteurs ont pu être construits pour des objectifs multiples, la recherche de performances poussées a ensuite généralement imposé la spécialisation. Ainsi le réacteur à haut flux de l'Institut Max von Laue-Paul Langevin, mis en service en 1972 à Grenoble, comme le réacteur Orphée, opérationnel depuis 1981 sur le site de Saclay, et le réacteur F.R.M.-2 (Forschungsreaktor Muenchen 2), fonctionnant depuis 2004 sur le site de Garching (Allemagne), sont destinés quasi exclusivement à la production de faisceaux intenses de neutrons pour des recherches fondamentales en physique, chimie et biologie.
Pour la production d'électricité, quatre filières seulement ont connu un réel développement industriel (tabl. 2).
– Les réacteurs modérés au graphite et refroidis par un gaz ont été les premiers construits en France (filière U.N.G.G., Uranium naturel-graphite-gaz) et en Grande-Bretagne (filière Magnox et filière A.G.R. – Advanced Gas-Cooled Reactors).
– Les réacteurs modérés à l'eau lourde ont été construits dans de nombreux pays, mais il n'y a vraiment qu'au Canada qu'ils aient été développés en série (filière Candu).
– Les réacteurs à eau ordinaire constituent de loin la filière la plus importante et représentent la majeure partie de l'équipement électronucléaire mondial (plus de 85 p. 100 en nombre et en puissance installée). Il en existe trois types : les réacteurs à eau sous pression (R.E.P, ou P.W.R. pour Pressurized Water Reactor), les réacteurs à eau bouillante (R.E.B., ou B.W.R. pour Boiling Water Reactor), enfin les réacteurs modérés au graphite et refroidis à l'eau ordinaire (R.B.M.K. : Reaktor Bolchoï Mochtchnosti Kanalnogotipa), ces derniers ayant été construits exclusivement en ex-U.R.S.S. C'est aux États-Unis que les réacteurs R.E.P. et R.E.B. ont connu les développements les plus importants avant d'être adoptés par la plupart des pays du monde. En particulier la France qui s'est engagée, à partir de 1970, dans la construction d'une série de réacteurs R.E.P. représentant aujourd'hui la quasi-totalité de son équipement électronucléaire. Enfin, l'ex-U.R.S.S. a également exporté vers les autres pays de l'Est des réacteurs à eau sous pression de type V.V.E.R. (Vodo Vodyanoi Energuietitchesk Reaktor).
– Les réacteurs à neutrons rapides (R.N.R), dont seulement des prototypes refroidis au sodium ont été construits, sont appelés à prendre le relais des réacteurs à eau vers le milieu du xxie siècle, en raison de leur capacité à bien utiliser l'uranium (par la surgénération), d'autant plus que le développement de l'énergie nucléaire conduit à des tensions sur le marché de l'uranium et à un fort renchérissement de cette ressource. Cette perspective tend à être accréditée par la forte augmentation du prix de l'uranium : en effet, celui-ci, après avoir longtemps stagné jusqu'en 2003, a été multiplié par dix de cette date à 2007, passant ainsi de 20 dollars à environ 200 dollars le kilogramme.
Les réacteurs à neutrons rapides utiliseront, pour leur déploiement, le plutonium produit par les réacteurs à eau actuels comme matériau fissile et l'uranium appauvri, sous-produit des usines d'enrichissement en uranium 235, comme matériau fertile (dans le cœur et les couvertures). On estime que les matières nucléaires produites par le fonctionnement d'un[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean BUSSAC : conseiller scientifique au Commissariat à l'énergie atomique, Fontenay-aux-Roses
- Frank CARRÉ : directeur adjoint du développement et de l'innovation nucléaire au Commissariat à l'énergie atomique (CEA), ingénieur
- Robert DAUTRAY : membre de l'Académie des sciences
- Jules HOROWITZ : directeur de l'Institut de recherche fondamentale du Commissariat à l'énergie atomique, Gif-sur-Yvette
- Jean TEILLAC : professeur honoraire à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie, haut-commissaire à l'énergie atomique, membre du Conseil économique et social
Classification
Pour citer cet article
Jean BUSSAC, Frank CARRÉ, Robert DAUTRAY, Jules HOROWITZ et Jean TEILLAC. NUCLÉAIRE - Réacteurs nucléaires [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
NUCLÉAIRE (notions de base)
- Écrit par Universalis
- 4 128 mots
- 18 médias
Depuis la découverte de la radioactivité en 1896 par Henri Becquerel et celle du noyau atomique par Ernest Rutherford en 1911, des progrès scientifiques importants ont été accomplis en physique nucléaire. La maîtrise des réactions nucléaires a permis en particulier, dès le milieu du xxe siècle,...
-
FRANCE - L'année politique 2021
- Écrit par Nicolas TENZER
- 6 168 mots
- 5 médias
...Emmanuel Macron présente un plan d’investissement « France 2030 » dont le but est de « faire émerger les futurs champions technologiques de demain ». Après un moment d’hésitation, il annonce en novembre un plan de relance du nucléaire, destiné à répondre aux défis de l’indépendance énergétique du pays... -
TICE (Traité d'interdiction complète des essais nucléaires) ou CTBT (Comprehensive Test Ban Treaty)
- Écrit par Dominique MONGIN
- 936 mots
- 1 média
Le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (T.I.C.E.), ou Comprehensive Test Ban Treaty (C.T.B.T.), est un traité multilatéral élaboré dans le cadre de la Conférence du désarmement de l’Organisation des Nations unies (O.N.U.). Il a été ouvert à la signature des États en septembre...
Voir aussi
- COMMANDE
- BLINDAGE, génie nucléaire
- ABSORPTION, physique
- PRESSION, physique
- PUISSANCE, physique
- ACCIDENTS
- REFROIDISSEMENT, technologie
- SÉCURITÉ
- ISOTOPES
- NOYAU ATOMIQUE
- RÉACTEUR À EAU PRESSURISÉE (REP) ou PWR (pressurised water reactor)
- RÉACTEUR À EAU BOUILLANTE (REB) ou BWR (boiling water reactor)
- RÉACTEUR À EAU LOURDE
- RÉACTEUR À GRAPHITE-GAZ
- ENCEINTE DE CONFINEMENT, génie nucléaire
- IRRADIATION
- CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES
- RECYCLAGE DES DÉCHETS ET DES MATÉRIAUX
- EAU, physico-chimie
- RÉACTEUR À NEUTRONS RAPIDES (RNR)
- ÉNERGIE SOURCES D'
- NUCLÉAIRES RÉACTIONS
- SECTION EFFICACE
- CAPTURE DE NEUTRONS
- AGR (advanced gas-cooled reactor)
- COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE
- FLUIDE CALOPORTEUR
- ACTINIDES
- RÉGÉNÉRATION, génie nucléaire
- SURGÉNÉRATEURS
- PHÉNIX, génie nucléaire
- RÉACTION EN CHAÎNE, physique nucléaire
- FISSION NUCLÉAIRE
- GÉNIE NUCLÉAIRE
- FISSILES MATÉRIAUX
- FERTILES MATÉRIAUX
- MODÉRATEUR, génie nucléaire
- FILIÈRES, génie nucléaire
- RÉFLECTEURS, génie nucléaire
- DIFFUSION NEUTRONIQUE
- ÉNERGIE NUCLÉAIRE
- RBMK (Reaktor Bolchoi Mochtchnosti Kanalni) RÉACTEUR
- VAPEUR D'EAU
- EAU LOURDE (oxyde de deutérium)
- HÉLIUM
- GRAPHITE
- DIOXYDE D'URANIUM
- NUCLÉAIRES SOUS-MARINS
- GAINAGE, génie nucléaire
- ZIRCALOY
- PILE ATOMIQUE
- ASN (Autorité de sûreté nucléaire)
- MDEP (Multinational Design Evaluation Programme)
- COOPÉRATION INTERNATIONALE
- NUCLÉAIRE DROIT
- FRANCE, droit et institutions
- ÉNERGIE THERMIQUE
- CŒUR, génie nucléaire
- CENTRALE NUCLÉAIRE
- HTR (high temperature reactor)
- SUPER-PHÉNIX, génie nucléaire
- CANDU FILIÈRE
- NAUTILUS, sous-marin
- RETRAITEMENT, génie nucléaire
- RÉACTEUR NUCLÉAIRE
- ACCIDENTS NUCLÉAIRES
- NUCLÉAIRE INDUSTRIE
- TECHNIQUES HISTOIRE DES, XXe et début du XXIe s.
- ÉNERGIE CINÉTIQUE
- PROPULSION NUCLÉAIRE
- ENRICHISSEMENT, génie nucléaire
- DÉCHETS RADIOACTIFS ou DÉCHETS NUCLÉAIRES
- TRANSMUTATION, physique nucléaire
- RALENTISSEMENT, génie nucléaire
- SÛRETÉ NUCLÉAIRE
- TCHERNOBYL
- ÉNERGIE PRODUCTION D'
- ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
- CARBONIQUE GAZ ou DIOXYDE DE CARBONE
- RISQUES TECHNOLOGIQUES