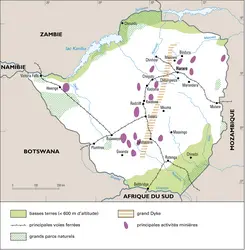ZIMBABWE
| Nom officiel | République du Zimbabwe (ZW) |
| Chef de l'État et du gouvernement | Emmerson Mnangagwa (depuis le 24 novembre 2017) |
| Capitale | Harare |
| Langues officielles | Anglais, chewa, chibarwe, kalanga, khoisan, nambya, ndau, ndebele, shangani, shona, sotho, tonga, tswana, venda, xhosa et langue des signes |
| Unité monétaire | Dollar du Zimbabwe 3, 4 |
| Population (estim.) |
15 706 000 (2024) |
| Superficie |
390 757 km²
|
Histoire
L'histoire du Zimbabwe est une histoire particulièrement tourmentée, dont les grandes phases sont globalement les suivantes :
– avant la colonisation britannique ;
– de la colonisation britannique à la Déclaration unilatérale d'indépendance de la Rhodésie ;
– de la Déclaration unilatérale d'indépendance au Zimbabwe indépendant.
Avant la colonisation britannique
Les premiers occupants du territoire furent des Bochiman (ou Bushmen), mais des tribus shona d'origine bantou firent leur apparition sur le plateau central vers le milieu du xe siècle. Ils développèrent une activité d'élevage qui fut bientôt complétée par un véritable réseau commercial tant avec l'arrière-pays qu'avec la zone côtière. Ils furent notamment à l'origine du célèbre royaume du Zimbabwe, fondé par l'ethnie karanga et qui sut tirer parti du site carrefour qu'il occupait, à la jonction des principales voies de communication qui assuraient l'acheminement de l'or, de l'ivoire ou des tissus à travers l'Afrique australe.
L'exploitation des gisements d'or attira d'ailleurs rapidement les convoitises extérieures : Arabes et Portugais, notamment, vont s'intéresser de près au pays. Les Shona continuent toutefois leur expansion. Après le déclin du royaume du Zimbabwe, au xvie siècle, d'autres royaumes se constituent : ceux de Monomotapa et de Rozwi auront plus d'éclat que les autres. Le premier, surtout, bénéficiera d'une véritable légende, alimentée par les récits des voyageurs arabes ou portugais. Au début du xviie siècle, le roi du Monomotapa dut accepter un traité humiliant avec le Portugal, qui venait d'organiser une expédition militaire ; il cédait les mines d'or, d'étain, de cuivre, de fer et de plomb au souverain du Portugal, dont il devenait ainsi le vassal, mais conservait le droit de gouverner le pays.
La colonisation portugaise, fortifiée par l'attrait des mines d'or et les divisions internes du royaume, se poursuivra pendant les premières décennies du xviie siècle. Les troubles ne cessèrent pas pour autant dans le royaume, et les colons portugais en firent les frais à l'occasion. Cette instabilité chronique du Monomotapa entraîna progressivement le royaume vers son déclin.
Mais déjà, du côté de l'Afrique du Sud, les regards se tournent vers la zone occupée par les Shona, le Mashonaland. Les Portugais, qui avaient pris pied au Mozambique et en Angola, vont se heurter à la fois aux Britanniques et aux Boers.
Vers les années 1830, un groupe appartenant à l'ethnie des Zoulous, les Ndebele, remonte vers le nord à la suite de sanglantes luttes tribales et pénètre dans le Mashonaland, au sud-ouest du Zimbabwe actuel. Il aura rapidement raison des défenses, au demeurant peu efficaces, qui lui sont opposées. Peuplade guerrière, bien organisée derrière un souverain tout-puissant, les Ndebele (ou Matabelele) étendront leur domination sur les Shona de l'Est, qu'ils réduisent pratiquement en esclavage.
De leur côté, les Européens ne restent pas inactifs. Voyageurs, commerçants, aventuriers et missionnaires se succèdent au royaume des Ndebele. Avec les autorités britanniques de la province du Cap et avec les Boers du Transvaal, les relations des monarques de Bulawayo furent souvent tendues, malgré les traités signés de temps à autre. Un homme jouera ici un rôle déterminant : Cecil J. Rhodes. Installé au Cap, où il a su prendre le contrôle d'une importante société diamantifère (la De Beers), avant d'entamer une carrière politique et de devenir Premier ministre de la province, il rêve d'un axe britannique allant du Caire au Cap. Mais il redoute que son entreprise ne soit compromise par les ambitions des dirigeants boers de la république du Transvaal, qui entendent pour leur part donner aux « Afrikanders » le contrôle de[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Daniel COMPAGNON : professeur des Universités, professeur de science politique à l'Institut d'études politiques de Bordeaux
- Philippe GERVAIS-LAMBONY : professeur à l'université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense
- Franck MODERNE : professeur à l'université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne
- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Pour citer cet article
Daniel COMPAGNON, Universalis, Philippe GERVAIS-LAMBONY et Franck MODERNE. ZIMBABWE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
ZIMBABWE, chronologie contemporaine
- Écrit par Universalis
-
AFRIQUE (Structure et milieu) - Géologie
- Écrit par Anne FAURE-MURET
- 18 789 mots
- 22 médias
Les cratons du Kaapvaal et duZimbabwe sont caractérisés par l'association granites-ceintures vertes. La plus grande partie (80 %) des roches sont des granites et des gneiss qui forment des sortes de dômes au milieu des ceintures vertes, ou semblent les recouper. Les ceintures vertes apparaissent comme... -
AFRIQUE (Structure et milieu) - Géographie générale
- Écrit par Roland POURTIER
- 21 496 mots
- 29 médias
...encadrement urbain. Beaucoup de villes anciennes ont disparu sans laisser de ruines, car elles étaient à peu près toutes construites en terre, à l'exception des zimbabwe, ces enceintes de pierre parfaitement appareillées qui ont donné son nom à l'ancienne Rhodésie du Sud. De véritables réseaux urbains n'existaient,... -
AFRIQUE (Histoire) - Les décolonisations
- Écrit par Marc MICHEL
- 12 424 mots
- 24 médias
...sanctions et à réduire les oppositions intérieures. Mais tout aussi importantes ont été les dissensions intestines qui déchirèrent les partis nationalistes. En 1966, la Zimbabwe African National Union ( Z.A.N.U.) de Robert Mugabe était passée la première à l'action terroriste au nord de la Rhodésie. Chaque... -
AFRIQUE AUSTRALE
- Écrit par Jeanne VIVET
- 6 100 mots
- 5 médias
...vivrière peu rentable et peu mécanisée coexiste toujours avec une agro-industrie puissante, exportatrice et intégrée aux circuits économiques mondiaux. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe lança quant à lui une violente réforme agraire au début des années 2000, expulsant quatre mille fermiers blancs.... - Afficher les 24 références
Voir aussi
- PORTUGAIS EMPIRE COLONIAL
- MALNUTRITION
- AGRAIRES RÉFORMES
- SÉGRÉGATION
- REPRÉSENTATION ÉLECTORALE
- RHODÉSIE DU SUD
- COLON
- EXPROPRIATION
- KARIBA BARRAGE DE
- CAP COLONIE DU
- AGRAIRES STRUCTURES
- PNUD (Programme des Nations unies pour le développement)
- PAUVRETÉ
- RÉSERVES, Indiens et autres populations
- GUERRE CIVILE
- NYASSALAND
- AGRICOLES EXPLOITATIONS
- BULAWAYO
- AFRIQUE CENTRALE FÉDÉRATION D'
- BRITISH SOUTH AFRICA CHARTERED COMPANY (BSACCo)
- FONCIÈRE RURALE POLITIQUE
- VELD
- MASHONALAND
- RHODÉSIE DU NORD
- GRÈVE GÉNÉRALE
- OPPOSITION POLITIQUE
- TSVANGIRAI MORGAN (1952-2018)
- POLITIQUE ÉCONOMIQUE
- PARTI UNIQUE
- MDC (Mouvement pour le changement démocratique)
- FRAUDES
- URBANISATION
- BRITANNIQUE EMPIRE, Afrique
- AFRIQUE, géographie
- AFRIQUE NOIRE, histoire, période coloniale
- AFRIQUE NOIRE, histoire, des indépendances à nos jours
- AFRIQUE NOIRE ÉTATS D'
- EXODE RURAL
- ÉPIDÉMIES
- AFRIQUE NOIRE, histoire précoloniale
- RHODÉSIE
- MUZOREWA ABEL (1925- )
- ZAPU (Zimbabwe African People's Union ou Union du peuple africain du Zimbabwe)
- ZANU (Zimbabwe African National Union ou Union nationale africaine du Zimbabwe)
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours
- SALISBURY ACCORD DE (1976)
- LANCASTER HOUSE ACCORD DE (1979)
- CONFLIT ARMÉ
- POLITIQUES MOUVEMENTS
- RESSOURCES MINIÈRES
- ANC (African National Congress)
- AIDE ALIMENTAIRE
- CORRUPTION