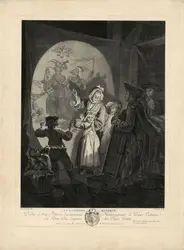IMAGE ANIMÉE
Le temps de l’industrialisation
Cette fusion va se concrétiser complètement au cours de l'année 1895. Louis Lumière, qui connaît le kinétoscope et les appareils de projection d'Émile Reynaud et de Georges Demenÿ, dépose le 13 février 1895 un brevet pour un appareil chronophotographique réversible, non encore nommé Cinématographe, et qui va être présenté le 22 mars 1895 à Paris, devant les membres de la Société d'encouragement. Lumière a copié le film Edison en reprenant le format 35 mm, mais il l’a perforé différemment (un trou rond de chaque côté de l'image) afin, peut-être, d’éviter un procès. Cette exhibition du kinétoscope de projection – ainsi est baptisée, à cette époque précise, la machine de Lumière – suscite l’admiration générale des spectateurs et journalistes présents. La suite est bien connue : après plusieurs projections privées, ce n'est que le 28 décembre 1895, au cours de la séance du Grand Café à Paris, que les Lumière montrent enfin au public, en échange d'un droit d'entrée, une dizaine de films réalisés par leurs soins et projetés par le Cinématographe – l’appareil a été enfin baptisé en mai (nom emprunté à une caméra précédemment mise au point en 1892 par Léon Bouly). Les films projetés, d’excellente qualité, remportent un vif succès : L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat, L’Arroseur arrosé, Le Déjeuner de bébé, La Sortie des usines Lumière à Lyon…
La démarche esthétique de Louis Lumière et de ses opérateurs (environ 1 400 films réalisés à travers le monde de 1895 à 1904) diffère de celle de Marey et d’Edison. Marey voulait « voir l’invisible », notamment à l’aide de la prise de vues à grande vitesse (jusqu’à 100 images par seconde). Pour lui, montrer un train dans une gare, à vitesse réelle, ne présentait strictement aucun intérêt, puisque l’œil nu pouvait déjà voir ce spectacle. Il voulait, comme Méliès plus tard, créer des images que personne n’avait vues avant lui. Edison et Dickson, de leur côté, flattent les sens du public et posent les bases du futur cinéma hollywoodien : films de fiction et de genre, violence. Marey, Edison, Lumière, Méliès offrent chacun une palette nouvelle et extraordinairement riche, inédite, qui va permettre à l’industrie naissante de satisfaire très rapidement tous les goûts et les demandes.
Pour en revenir à la stricte chronologie : le premier en Europe à gagner de l'argent en montrant des projections de films est l’Allemand Max Skladanowsky qui, le 1er novembre 1895, au Wintergarten de Berlin, donne des séances de « Bioskop ». Cet appareil à double bande est cependant complexe : deux films 54 mm, dont les perforations sont renforcées par des œillets métalliques, défilent en même temps, mais les images sont projetées alternativement d’une bande à l’autre (on peut y voir une fidélité aux doubles lanternes magiques à fondu enchaîné). Les images réalisées avec une caméra rustique et reproduisant des scènes de music-hall sont cependant de belle qualité.
Pourquoi le Cinématographe Lumière, dont le mécanisme repose presque entièrement sur des idées anciennes et déjà exploitées (la chronophotographie, la projection, la pellicule 35 mm perforée, la came triangulaire, et enfin un mécanisme d’entraînement inspiré de celui de la machine à coudre), a-t-il ainsi et malgré tout remporté la course technologique, alors que son concepteur est arrivé si tardivement dans cette longue histoire, et en quasi dilettante ? Pourquoi, par exemple, le mareysien Georges Demenÿ, obsédé par la chronophotographie depuis 1882, n’a-t-il pas pu relever ce défi ? Pourquoi Edison, à l’affût des nouveautés avec toute une armée d’ingénieurs surdoués, est-il passé à côté d’une nouvelle manne financière (son kinétoscope allait disparaître presque instantanément après l’arrivée du[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Laurent MANNONI : directeur scientifique du patrimoine à la Cinémathèque française
Classification
Pour citer cet article
Laurent MANNONI. IMAGE ANIMÉE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
ANTHROPOLOGIE VISUELLE
- Écrit par Damien MOTTIER
- 4 464 mots
...des séquences spécifiques de l’activité humaine pour en favoriser l’étude. Puis il a élaboré un programme d’anthropologie visuelle avant l’heure (Piault, 2000), faisantdes images animées une source d’analyse comparée du mouvement des corps, selon une théorie où la différence raciale prévalait. -
CINÉMA (Aspects généraux) - Les techniques du cinéma
- Écrit par Michel BAPTISTE, Pierre BRARD, Jean COLLET, Michel FAVREAU, Tony GAUTHIER
- 17 534 mots
- 17 médias
Au cours du xxie siècle, des évolutions dans les techniques de restitution d'images animées en relief pourront permettre d'éviter l'utilisation de lunettes stéréoscopiques. Plusieurs inventeurs ont déjà tenté de mettre au point des procédés de projection stéréoscopique où le relief serait visible... -
CINÉMA (Cinémas parallèles) - Le cinéma d'animation
- Écrit par Bernard GÉNIN, André MARTIN
- 17 657 mots
- 6 médias
Depuis les années cinquante, mais seulement dans des laboratoires réservés aux recherches militaire, industrielle et architecturale, le couplage du tube cathodique et de l'ordinateur préparait l'émergence d'un nouveau système de création picturale. Lié à un codage de toutes les valeurs visuelles en... -
CINÉMA (Réalisation d'un film) - Musique de film
- Écrit par Alain GAREL
- 6 489 mots
- 5 médias
...montage, enfin de la seule vertu symphonique de son orchestration visuelle. [...] Mais, dès mon premier film, je déchantai. J'avais aperçu à temps que l'image animée n'a pas, par vertu propre, le pouvoir affectif que je lui attribuais ; que sans musique les images ne parlent pas ; que la musique,... - Afficher les 10 références
Voir aussi
- FILM
- CAMÉRA
- REYNAUD ÉMILE (1844-1918)
- PRISE DE VUE
- PROJECTEURS
- SKLADANOWSKY MAX (1863-1939) et EMIL (1859-1945)
- PHOTOGRAPHIE SCIENTIFIQUE
- CINÉMATOGRAPHE
- TECHNIQUES HISTOIRE DES, XIXe s.
- CINÉMA HISTOIRE DU
- PROJECTION LUMINEUSE
- MOUVEMENT ENREGISTREMENT DU
- RENAISSANCE PEINTURE DE LA
- DELLA PORTA GIAMBATTISTA (1535-1615)
- CHRONOPHOTOGRAPHIE
- EFFETS SPÉCIAUX, cinéma
- SCIENCES HISTOIRE DES