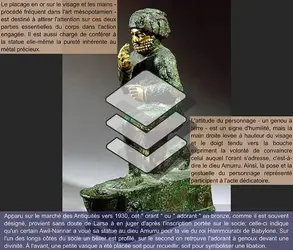BABYLONE
Civilisation
Le roi et les institutions publiques
Dès sa première dynastie, la Babylonie est une grande monarchie centralisée qui a profité des expériences unificatrices des royaumes sumériens et akkadiens. Le prince, « roi de la totalité », prétend à une domination universelle. Vicaire du dieu national, Mardouk, il est à la fois législateur, juge suprême, administrateur et chef militaire. Dans son Code (1694 env. avant J.-C.), Hammourabi transmet à ses sujets des lois inspirées par les dieux, mais couvertes de son autorité temporelle. On possède des édits émanant du premier (Samsou-ilouna) et du quatrième (Ammi-tsadouqa) successeur de ce roi, et quelques débris d'une loi néo-babylonienne. La juridiction même s'est laïcisée : les juges de Hammourabi sont des officiers civils et le roi rend la justice, non plus en qualité de grand-prêtre, mais de magistrat souverain. L'administration du royaume est dirigée par le Palais, sous le contrôle d'un Premier ministre. Des inspecteurs parcourent le pays pour transmettre les ordres du roi et veiller à leur exécution. Les lettres royales révèlent la multiplicité de ses tâches : comme juge, le roi prescrit des enquêtes sur les plaintes des particuliers, notamment contre les abus des fonctionnaires ; comme administrateur, il veille aux travaux publics (curage des canaux par les riverains, entretien des temples), à la collecte de l'impôt et même à l'unification du comput du temps (auparavant chaque cité décidait si l'année en cours compterait douze ou treize mois) ; il prescrit le mode de gestion de son domaine, pour partie exploité en régie, pour partie affermé à des particuliers ou concédé en bénéfice à des fonctionnaires. Les rois kassites et surtout les monarques de l'empire néo-babylonien reprennent les grandes lignes de cette organisation. Cette dernière période connaît une nouvelle accentuation de la laïcisation du pouvoir : la classe sacerdotale entre en conflit avec la monarchie et contribue à l'abattre avec l'aide de l'étranger.
Tout au long de l'histoire babylonienne, l'accession au trône se fait en principe par dévolution héréditaire. Mais les prêtres et l'aristocratie militaire livrent parfois le pouvoir à des usurpateurs : tel roi kassite, Nazibougash, et le fondateur de la dynastie néo-babylonienne, Nabopolassar, se disent ouvertement « fils de personne ». Nabonide, dernier roi de Babylone, est un Araméen qui a gagné sa légitimité par de riches donations aux temples.
La structure sociale
La fusion des ethnies sumérienne et sémitique, juste avant le xixe siècle, marque la naissance de la Babylonie. Le sumérien, devenu langue savante, est supplanté par l'akkadien, et c'est dans cet idiome, désormais seul officiel, que Hammourabi entend parachever, au moyen de son Code, l'unification du droit : il semble avoir tenu compte, notamment en matière de mariage, de la coexistence de deux traditions.
La société babylonienne se compose en majorité d'hommes libres. La classe supérieure est celle des citoyens (awilouti), stratifiée, suivant la fortune et la fonction, depuis la famille du prince jusqu'aux simples paysans en passant par les hauts fonctionnaires, les prêtres, les propriétaires fonciers, artisans et commerçants. La distinction entre ces catégories trouve des applications en droit pénal : ainsi, la violence légère commise envers un membre du même échelon social est frappée d'une peine pécuniaire, une mine d'argent, tandis que le même délit perpétré sur une personne de la classe supérieure entraîne un châtiment corporel, soixante coups de nerf de bœuf. Les « mesquins » sont encore des hommes libres, mais ils constituent une classe inférieure : la compensation qui leur est due à l'occasion de certains délits est inférieure à celle que reçoit l'[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Guillaume CARDASCIA : professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de Paris
- Gilbert LAFFORGUE : maître assistant à l'université de Paris-Sorbonne
Classification
Pour citer cet article
Guillaume CARDASCIA et Gilbert LAFFORGUE. BABYLONE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
CHUTE DE BABYLONE
- Écrit par Jean-Claude MARGUERON
- 178 mots
- 1 média
-
CONSTRUCTION DU PREMIER EMPIRE BABYLONIEN - (repères chronologiques)
- Écrit par Jean-Claude MARGUERON
- 298 mots
-
EMPIRE NÉO-BABYLONIEN - (repères chronologiques)
- Écrit par Jean-Claude MARGUERON
- 260 mots
-
AKITU
- Écrit par Daniel ARNAUD
- 866 mots
- 2 médias
Mot qui désigne, dans la civilisation assyro-babylonienne, à la fois une des plus importantes fêtes du calendrier liturgique et civil et, en même temps, le temple où une part essentielle du rituel se déroulait. Peu de textes nous en transmettent le récit ; encore sont-ils lacuneux et souvent, volontairement...
-
ALEXANDRE LE GRAND (356-323 av. J.-C.)
- Écrit par Paul GOUKOWSKY
- 6 470 mots
- 5 médias
Ses capitales tombèrent l'une après l'autre. D'abord Babylone, qui accueillit Alexandre en libérateur car de vieilles haines, surtout d'ordre religieux, remontèrent alors contre les Perses. Ce fut pourtant l'un d'eux, Mazaios, qui fut nommé satrape, premier signe d'un rapprochement avec l'aristocratie... -
AMORRITES ou AMORRHÉENS
- Écrit par Gilbert LAFFORGUE
- 728 mots
Amorrites, ou Amorrhéen, est un nom de peuple que les orientalistes ont tiré du mot akkadien Amourrou, par lequel les Mésopotamiens désignaient la région située à l'ouest de leur pays et aussi ses habitants.
Comme les Amorrites n'ont pas écrit leur langue, nous ne les connaissons que par...
-
ANCIEN EMPIRE HITTITE, en bref
- Écrit par Jean-Claude MARGUERON
- 170 mots
- 1 média
À la suite de la fondation, au xixe siècle avant J.-C., d'un premier royaume considéré par la tradition mythique comme l'ancêtre du royaume hittite, une séquence dynastique mène au roi Labarna, généralement considéré comme le fondateur de l'ancien empire (— 1680-— 1500) établi au cœur même du plateau...
- Afficher les 46 références
Voir aussi
- CHALDÉENS
- SUCCESSIONS
- ORIENT ANCIEN
- MONOGAMIE
- ANTIQUE DROIT
- MÉRODACH-BALADAN II ou MARDOUK-APAL-IDDIN II roi de Babylone (721-710 av. J.-C.)
- NABUCHODONOSOR Ier (1124-1103 av. J.-C.)
- KASSITES
- TOUKOULTI-NINOURTA Ier ou TUKULTI-NINURTA Ier, roi d'Assyrie (env. 1245-1208 av. J.-C.)
- TOUKOULTI-APIL-ESHARRA III ou TÉGLATH-PHALASAR III, roi d'Assyrie (746-727 av. J.-C.)
- ENOUMA ELISH
- MARIAGE, anthropologie
- ARCHIVES ARCHÉOLOGIQUES, Orient ancien
- ASSARHADDON ou ASSOUR-AH-IDDIN, roi d'Assyrie (680-669 av. J.-C.)
- BÊL, divinité mésopotamienne
- BABEL TOUR DE
- COMMERCE, histoire
- TEMPLE, Moyen-Orient
- ÉCONOMIE ANTIQUE
- ÉGYPTE, histoire : l'Antiquité
- PERSE, histoire : Antiquité
- RÉPUDIATION
- BABYLONIE
- ASSOUR-DAN Ier, roi d'Assyrie (1179-1134 av. J.-C.)
- AGOUM II, roi de Babylone (XVIe s. av. J.-C.)
- NABOU-APLA-OUTSOUR ou NABOPOLASSAR, roi de Babylone (626-605 av. J.-C.)
- ANTHROPOLOGIE HISTORIQUE
- VILLE, urbanisme et architecture
- SAMSOU-ILOUNA, roi de Babylone (env. 1749-1712 av. J.-C.)
- SHAMASH-SHOUM-OUKÎN (mort en 648 av. J.-C.) roi de Babylone
- DROIT, histoire
- FEMMES DROITS DES
- MÉSOPOTAMIENNE ARCHÉOLOGIE
- ANTIQUITÉ, architecture
- VILLES PRIMITIVES
- SCRIBES, Orient ancien