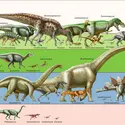THERMORÉGULATION, biologie
La température corporelle des homéothermes et sa régulation
La température corporelle n'est pas uniforme
La chaleur produite par le métabolisme cellulaire doit être transportée à la surface du corps pour pouvoir se dissiper vers l'extérieur, qui est en général à une température inférieure à celle du corps. La température de la surface du corps est donc inférieure à celle du centre, et cela permet le transfert de chaleur. En d'autres termes, la température du corps n'est pas uniforme. La production de chaleur par les tissus n'est pas davantage homogène, car certains organes (cœur, cerveau, viscères) en produisent bien plus que les autres, en particulier chez l'individu au repos. Nous pouvons donc, en première approximation, considérer le corps comme étant formé d'un noyau, dans lequel la plus grande partie de la production de chaleur prend place, et d'une enveloppe, qui comprend la peau et les muscles, et qui produit seulement une faible partie de la chaleur. Cela ne vaut que pour l'animal au repos. Lors d'un exercice musculaire, la situation est très différente, car le métabolisme augmente par un facteur 10, voire davantage. Cette augmentation correspond au fonctionnement des muscles (y compris les muscles respiratoires).
La température centrale de l'homme et des autres homéothermes montre des fluctuations journalières régulières de 1 à 2 0C. Les animaux diurnes montrent un maximum le jour et un minimum la nuit, les animaux nocturnes montrent des variations inverses. Ces cycles journaliers ont une origine endogène, et ils persistent pendant plusieurs semaines, même si l'animal est maintenu en éclairement continu. La température corporelle moyenne diffère entre les groupes de mammifères et d'oiseaux. Elle est, en particulier, nettement plus basse chez les monotrèmes et les autres groupes d'homéothermes « primitifs ».
La balance thermique des homéothermes
Le métabolisme énergétique d'un homéotherme varie avec la température ambiante : il reste constant dans une zone plus ou moins large (zone de neutralité thermique) et devient plus élevé en deçà de cette zone (mise en jeu d'une thermogenèse régulatrice) et au-delà de cette zone (mise en jeu d'une thermolyse accrue).
La régulation thermique au froid
Pour maintenir une température constante, un animal doit maintenir un état stationnaire, où la production de chaleur métabolique est égale aux pertes par conduction, convection, rayonnement et évaporation. Pour les températures relativement basses, l'évaporation correspond presque exclusivement aux pertes pulmonaires, qui ne représentent qu'un faible pourcentage du total. Il est possible de les négliger et d'écrire que Htot = Q = c ( (TC − TA), où Htot représente la chaleur produite par la thermogenèse de l'animal au repos (métabolisme basal), Q la chaleur perdue (thermolyse) et c un coefficient de conductance. Quand un animal change de milieu pour un milieu de température différente, il peut jouer sur l'un ou plusieurs des trois termes TC, c et Htot. Si nous ne considérons que le cas d'homéothermes, TC est constante (sauf en cas d'hibernation). Il ne reste donc que deux termes sur lesquels jouer, la production de chaleur Htot et la conductance c.
Augmentation de la production de chaleur (Htot)
L'augmentation de la production de chaleur peut prendre trois voies : des exercices musculaires volontaires, des tremblements involontaires des muscles (frissons thermiques) et une thermogenèse dans des tissus non musculaires. Les muscles ayant un rendement faible, une grande partie (> 80 p. 100) de l'énergie chimique qu'ils consomment est transformée en chaleur. Le travail musculaire produit donc une grande quantité de chaleur. Les frissons thermiques correspondent à des contractions simultanées de muscles antagonistes, qui se traduisent[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- René LAFONT : professeur des Universités
Classification
Pour citer cet article
René LAFONT. THERMORÉGULATION, biologie [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
DÉSERTS
- Écrit par Roger COQUE, François DURAND-DASTÈS, Huguette GENEST, Francis PETTER
- 20 885 mots
- 16 médias
...pas compatibles avec la vie animale. Des animaux typiquement désertiques exposés en plein soleil aux heures chaudes de la journée meurent rapidement. Tous les animaux « à sang chaud » sont pourvus d'organes régulateurs qui leur permettent de maintenir leur température corporelle à un niveau normal voisin... -
DINOSAURES
- Écrit par Eric BUFFETAUT
- 7 341 mots
- 16 médias
...ont beaucoup varié au fil du temps. Les paléontologues les ont longtemps considérés comme de simples versions énormément agrandies de reptiles actuels. De ce fait, leur physiologie aurait été de type reptilien, c'est-à-dire que la température de leur corps variait en fonction de celle de leur milieu ;... -
ÉCOLOGIE
- Écrit par Patrick BLANDIN, Denis COUVET, Maxime LAMOTTE, Cesare F. SACCHI
- 20 635 mots
- 15 médias
...statistiques, des relations entre certaines caractéristiques physiologiques ou morphologiques et certains facteurs du milieu, en particulier la température. Chez les homéothermes, par exemple, les tailles les plus grandes se rencontrent dans les régions les plus froides (règle de Bergmann). Cela est lié au... -
ÉPIPHYSE ou GLANDE PINÉALE
- Écrit par Berthe VIVIEN-ROELS
- 2 324 mots
- 1 média
Des corrélations étroites ont également été établies chez de nombreuses espècesentre le développement de la glande pinéale et le degré d'homéothermie. De plus, il est démontré que la glande pinéale et les organes qui lui sont souvent associés chez les Vertébrés inférieurs (œil pariétal des lézards,... - Afficher les 19 références
Voir aussi
- CONGÉLATION
- CONVECTION ou CONVEXION
- POÏKILOTHERMIE ou PŒCILOTHERMIE
- ECTOTHERMIE
- ENDOTHERMIE
- BALANCE THERMIQUE, physiologie
- THERMOGENÈSE
- TRANSPIRATION ANIMALE ou SUDATION ANIMALE
- SUDORALES GLANDES
- THERMORÉCEPTEUR
- PHYSIOLOGIE
- ÉVAPORATION, physique
- TEMPÉRATURE
- POLYPNÉE
- HYPERTHERMIE
- ADIPEUX BRUN TISSU
- THERMOLYSE
- ACCLIMATEMENT
- BIOÉNERGÉTIQUE
- MUSCULAIRE TRAVAIL
- HOMÉOTHERMIE
- ADAPTATION BIOLOGIQUE
- AQUATIQUE VIE
- RAYONNEMENT THERMIQUE
- TAILLE CORPORELLE
- CONDUCTION THERMIQUE