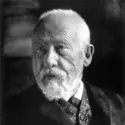RICŒUR PAUL (1913-2005)
Paul Ricœur est né le 27 février 1913 à Valence (France). Orphelin de père et de mère il est initié à la philosophie au lycée de Rennes par Roland Dalbiez. Au cours des années 1930, il poursuit son apprentissage philosophique dans le compagnonnage de Gabriel Marcel et d'Emmanuel Mounier. Après son retour de captivité en Poméranie (1940-1945), et au terme de trois années de retraite dans la communauté cévenole du Chambon-sur-Lignon, il est professeur à l'université de Strasbourg (1948-1956), puis de Paris-Sorbonne. Il est nommé à l'université de Nanterre, où il enseigne la philosophie de 1965 à 1970, et où il est doyen de la faculté des lettres pendant les années particulièrement turbulentes de 1969-1970. De 1970 à 1985, il enseigne à l'université de Chicago.
En 1995 la collection The Library of Living Philosophers a consacré un volume à la philosophie de Paul Ricœur qui atteste l'écho international que rencontre la pensée du philosophe français, en même temps qu'il permet de mesurer l'ampleur et l'originalité d'un itinéraire philosophique qui a commencé au début des années 1950 sous le signe de la philosophie de la volonté. Au terme de cinquante années de travail acharné, ce parcours débouche sur une philosophie de l'action, fortement articulée sur la philosophie morale et politique, y compris le problème de la justice comme vertu et comme institution. Le livre s'ouvre sur une autobiographie intellectuelle, publiée en français sous le titre Réflexion faite. Ce titre marque une dette jamais reniée à l'égard de la tradition de la philosophie réflexive française, tout en se plaçant sous la double égide de la phénoménologie et de l'herméneutique.
« Un cogito militant et blessé »
L'autobiographie montre l'importance de la triple rupture instauratrice qui commande toute la pensée de l'auteur. C'est à l'école de Roland Dalbiez que cet « esprit curieux et inquiet » avait appris à résister à la prétention à l'immédiateté, à l'adéquation et à l'apodicticité, porteuse de caractères d'universalité et de nécessité absolues, qui marquent le cogito cartésien et le « Je pense » kantien. Encore fallait-il transformer ce réflexe en position philosophique réfléchie, en montrant pourquoi l'immédiateté doit laisser la place à la médiation, en quel sens l'adéquation, qui a sa source dans le jugement, peut être dépassée sans remettre en cause l'idée de vérité, comment enfin l'apodicticité du savoir philosophique peut faire droit à l'expérience du soupçon et inclure le moment de l'attestation.
Ce triple déplacement implique une idée déterminée du cogito que Ricœur définit comme un « cogito militant et blessé ». La conjonction de ces épithètes, qui font rarement bon ménage, ne va pas sans un certain nombre de tensions, à commencer par la tension de la critique et de la conviction, dont un livre d'entretiens, publié à la suite de l'autobiographie, révèle les enjeux.
Bien des aspects de la pensée de Ricœur se laissent comprendre à la lumière de la figure géométrique de l'ellipse à double foyer. Ses pôles furent successivement occupés par différents noms propres : Gabriel Marcel et Edmund Husserl, puis Karl Jaspers, « interlocuteur muet » mais d'autant plus efficace. Le regard rétrospectif sur l'œuvre y découvre une confrontation incessante qui n'élude aucune question critique, comme le montre encore le débat avec Jean-Pierre Changeux au sujet des neurosciences et de l'éthique (La nature et la règle, 1998). Cette ellipse implique un double renoncement : renoncer à construire un système philosophique, en particulier sous la forme hégélienne de la médiation parfaite ; renoncer à une philosophie qui se voudrait libre de toute présupposition.[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean GREISCH : docteur en philosophie, professeur émérite de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, titulaire de la chaire "Romano Guardini" à l'université Humboldt de Berlin (2009-2012)
Classification
Pour citer cet article
Jean GREISCH. RICŒUR PAUL (1913-2005) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Média
Autres références
-
LA MÉMOIRE, L'HISTOIRE, L'OUBLI (P. Ricœur)
- Écrit par Jean GREISCH
- 990 mots
Dans le prolongement de Soi-même comme un autre (1990) le livre de Paul Ricœur La Mémoire, l'histoire, l'oubli (Seuil, Paris, 2000) vient couronner une œuvre commencée en 1950 sous le signe d'une philosophie de la volonté. Cette immense enquête, qui se déploie à travers une patiente...
-
TEMPS ET RÉCIT, Paul Ricœur - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 880 mots
Temps et Récit (1983-1985) est une monumentale enquête consacrée à la théorie littéraire par le philosophe Paul Ricœur (1913-2005), l'un des introducteurs de la phénoménologie en France, et surtout le promoteur d'une herméneutique. Elle a été conçue en parallèle à La Métaphore...
-
APORIE
- Écrit par Françoise ARMENGAUD
- 803 mots
Terme appartenant à la philosophie grecque de l'Antiquité ; c'est la transcription littérale de aporia, dont le sens propre est « impasse », « sans issue », « embarras ». En philosophie, on peut lui donner un sens faible, comme le fait Aristote en insistant sur l'aspect...
-
ÉVÉNEMENT, histoire
- Écrit par Olivier LÉVY-DUMOULIN
- 1 367 mots
Mais le dévoilement de la nature et des formes de l'événement s'organise sur un autre plan lorsque Paul Ricœur (La Mémoire, l'histoire et l'oubli, 2000) envisage l'événement « supra-significatif », Auschwitz. Dans cette perspective, l'événement « aux limites » disqualifie une conception... -
HERMÉNEUTIQUE
- Écrit par Jean GREISCH
- 3 294 mots
- 3 médias
Longtemps considérée comme une spécialité exclusivement allemande, l'herméneutique s'acclimate en France grâce aux travaux de Paul Ricœur (1913-2005). À partir de la Symbolique du mal (1960) et jusque dans ses derniers écrits, celui-ci défend une conception originale de l'herméneutique qui oppose... -
HISTOIRE (Histoire et historiens) - Sources et méthodes de l'histoire
- Écrit par Olivier LÉVY-DUMOULIN
- 6 217 mots
- 6 médias
Pour comprendre les pratiques des historiens, deux notions clés s'avèrent indispensables. La première, les sources, appartient en propre aux professionnels de l'histoire ; la seconde, la méthode, est la clé de toutes les démarches de l'esprit.
Si faire de l'histoire consiste avant...
- Afficher les 16 références
Voir aussi