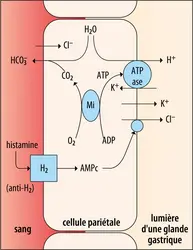ESTOMAC

Appareil digestif
Planeta Actimedia S.A.© Encyclopædia Universalis France pour la version française.
On peut se représenter notre estomac comme une dilatation du tube digestif formant une sorte de poche, entre la fin de l'œsophage et le début de l'intestin. Malgré cette appare nte simplicité de structure, il s'agit d'un organe dont le fonctionnement est relativement complexe. L'estomac joue un rôle important dans l'assimilation de notre nourriture. Il stocke momentanément les aliments pour les malaxer et les prédigérer avant de les délivrer de façon contrôlée à l'intestin. Dans le même temps, il détruit les germes microbiens ingérés. Enfin, c'est l'estomac qui produit le facteur intrinsèque indispensable à l'absorption intestinale de la vitamine B12. À côté de ces actions physiologiques bénéfiques, l'estomac est aussi la cause, ou la victime, d'un certain nombre d'affections dont la plus commune est la maladie ulcéreuse.
Fonctions mécaniques de l'estomac
La capacité de l'estomac de retenir, malaxer et expulser les aliments est due à l'activité contractile d'un important appareil de fibres musculaires. Comme dans le reste du tube digestif, ces fibres sont organisées en deux couches superposées, longitudinales et circulaires, permettant tous les mouvements possibles. Le tissu musculaire est très développé dans la partie basse de l'estomac (antre) qui a l'activité mécanique la plus importante, moins dans la partie haute (grosse tubérosité et fundus gastrique) qui joue plutôt le rôle d'un réservoir de remplissage.
Au niveau du cardia, jonction de l'estomac avec l'œsophage et surtout du pylore, jonction de l'estomac avec le duodénum, premier segment intestinal, existent des renforcements constitués de fibres circulaires qui constituent de puissants sphincters, dont la fermeture maintient la cavité gastrique close, notamment en direction de l'œsophage, mais aussi vers le duodénum tant que la pression intragastrique n'a pas atteint le seuil de franchissement pylorique. La durée pendant laquelle les aliments séjournent dans l'estomac varie en fonction de leur nature physicochimique et de leur valeur nutritive. Les liquides restent un temps compris entre trente minutes (eau pure) et deux heures (boissons sucrées). Ils franchissent le sphincter pylorique poussés par leur propre pression hydrostatique et par l'effet de poire exercé par les muscles de la grosse tubérosité et du fundus. La plupart des aliments solides ne quittent l'estomac qu'après avoir été réduits en fragments de quelques millimètres de diamètre (les fibres végétales font exception). Leur évacuation demande de trois à six heures. Elle se produit sous l'action d'ondes de contraction qui progressent de l'antre vers le pylore en poussant devant elles une portion du contenu gastrique (ondes péristaltiques). Pendant une première phase, le sphincter pylorique s'ouvre sous la pression propulsive et permet l'évacuation des plus petits fragments. Mais il se ferme ensuite alors que l'onde contractile continue à se propager. Il en résulte un phénomène de rétropulsion qui ramène le contenu gastrique du pylore vers l'antre. Cette succession d'aller et retour produit un vigoureux effet de brassage qui assure, à la longue, la destruction mécanique des aliments solides. Les matières grasses, qu'elles soient solides ou liquides, séjournent plus longtemps dans l'estomac et retardent son évacuation. L'arrivée des lipides dans l'intestin stimule en effet des récepteurs qui provoquent la fermeture du sphincter pylorique et inhibent la motricité antrale.
Les ondes péristaltiques gastriques sont créées par les cellules musculaires elles-mêmes. La différence de potentiel entre les faces interne et externe de la membrane de ces cellules (polarisation) n'est pas uniforme mais croît du haut au bas de l'estomac (de[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Miguel LEWIN : directeur de l'unité 10 de l'I.N.S.E.R.M., hôpital Bichat
Classification
Pour citer cet article
Miguel LEWIN. ESTOMAC [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
ABDOMEN
- Écrit par Claude GILLOT
- 6 346 mots
- 9 médias
...l'évolution du péritoine. Le tube digestif initial est sagittal (fig. 5) et présente de haut en bas différents segments. L'œsophage abdominal est court ; l'estomac a la forme d'une poche qui dirige sa concavité, la petite courbure, du côté ventral. Le duodénum forme une anse à concavité postérieure ; une... -
CANNON WALTER BRADFORD (1871-1945)
- Écrit par Jacqueline BROSSOLLET
- 490 mots
L'un des plus grands physiologistes américains, dont le nom reste surtout attaché à la théorie de l'homéostasie. Né dans le Wisconsin à Prairie-du-Chien, Cannon entre à Harvard en 1896. Docteur en médecine en 1900, il reste dans cette université où se déroulera sa carrière ; professeur...
-
CONTRÔLE CENTRAL DE L'APPÉTIT
- Écrit par Serge LUQUET
- 5 946 mots
- 6 médias
...siège d’intégration des afférences nerveuses issues de la sphère digestive. Parmi ces signaux rapides, certains sont initiés par des mécanorécepteurs de l’estomac qui relaient, via le nerf vague vers le NTS, une information sensitive d’origine viscérale (de type viscérosensitif). Ainsi, la distension gastrique... -
DIGESTIF APPAREIL
- Écrit par Universalis, Claude GILLOT
- 4 744 mots
- 5 médias
L'estomac est une portion dilatée, très mobile, du tube digestif, recouverte de péritoine en presque totalité, et logée à la partie supéro-gauche de l'abdomen. Sa moitié supérieure, coiffée par la coupole diaphragmatique, se cache sous les dernières côtes gauches. La partie inférieure, seule accessible... - Afficher les 16 références
Voir aussi
- REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN
- GRP (gastrin releasing peptide)
- ŒSOPHAGE
- DUODÉNUM
- SUC GASTRIQUE
- MUCUS
- SPHINCTER
- NERF PNEUMOGASTRIQUE ou NERF VAGUE
- ENDOCRINE SÉCRÉTION
- GLANDES
- PHYSIOLOGIE
- INHIBITEURS, biochimie
- APPÉTIT
- ŒSOPHAGITE
- EXOCRINE SÉCRÉTION
- RÉCEPTEUR, physiologie
- VITAMINE B12 ou CYANOCOBALAMINE
- BIERMER MALADIE DE ou ANÉMIE PERNICIEUSE
- PEPTIDES
- ANTIHISTAMINIQUES
- CHLORHYDRIQUE ACIDE
- PYLORE
- CONTRACTION MUSCULAIRE
- PEPSINE
- ULCÈRE DIGESTIF
- CHYME
- DYSPEPSIE
- HERNIE HIATALE
- GASTRITE
- RÉGULATIONS BIOCHIMIQUES
- NEUROPEPTIDES
- VIDANGE GASTRIQUE
- CIMÉTIDINE
- HYPERCHLORYDRIE
- SUC DIGESTIF
- ULCÈRE GASTRO-DUODÉNAL
- RANITIDINE
- FACTEURS DE CROISSANCE