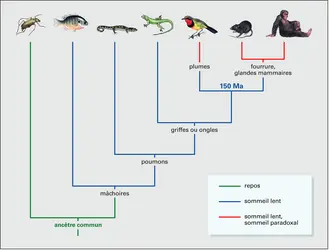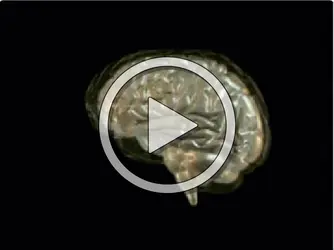NEUROPHYSIOLOGIE
Articles
-
ACUPUNCTURE
- Écrit par François BOUREAU
- 3 000 mots
- 1 média
De nombreux arguments indiquent que l'effet d'installation rapide correspond à la mise en jeu d'inhibitions pré- ou post-synaptiques s'exerçant au niveau spinal sur les cellules de relais des voies nociceptives (théorie du gate control de Melzack et Wall). Il ne fait guère de... -
AGRESSIVITÉ, éthologie
- Écrit par Philippe ROPARTZ
- 3 931 mots
Les neurophysiologistes et les physiologistes du comportement sont parvenus à localiser les substrats nerveux de l'agression au niveau de structures sous-corticales et diencéphaliques : amygdale et hippocampe dans le système limbique (cf. système limbique), hypothalamus latéral dans le... -
AUDITION - Acoustique physiologique
- Écrit par Pierre BONFILS, Yves GALIFRET, Didier LAVERGNE
- 14 809 mots
- 17 médias
Dans le nerf cochléaire, branche auditive du huitième nerf crânien, il y a environ 30 000 fibres afférentes chez l'Homme et 50 000 chez le Chat (150 000 à 200 000 chez les Baleines). Ces fibres, qui se rassemblent dans le modiolus, sont les axones des neurones dont les corps cellulaires forment... -
BEKHTEREV VLADIMIR MIKHAÏLOVITCH (1857-1927)
- Écrit par Universalis
- 294 mots
Neurophysiologiste et psychiatre russe qui a étudié les structures cérébrales et analysé les réflexes conditionnés.
Bekhterev, né à Sorali, dans la région de Vyatka (actuellement Kirov) obtient le doctorat de l'Académie médicochirurgicale de Saint-Pétersbourg en 1881, puis approfondit ses...
-
BERGER HANS (1873-1941)
- Écrit par Henri GASTAUT
- 828 mots
Le 21 mai 1873 à Neuses, petite ville près de Coburg, Hans Berger naît dans une famille d'intellectuels. Après avoir terminé ses études médicales, à l'âge de vingt-quatre ans, il rejoignit l'équipe de la clinique psychiatrique de l'université de Iéna qu'il ne quittera plus jusqu'à la fin de sa...
-
BERNARD CLAUDE (1813-1878)
- Écrit par Paul MAZLIAK
- 4 120 mots
- 1 média
Dans l'œuvre scientifique de Claude Bernard, les recherches sur le système nerveux occupent une très grande place. Son premier inspirateur en ce domaine fut Magendie. Ce physiologiste avait observé qu'en excitant la branche lacrymale de la cinquième paire de nerfs crâniens, on faisait couler abondamment... -
BLUE BRAIN PROJECT
- Écrit par Philippe ROCHAT
- 507 mots
Le cerveau présente un champ de recherche vaste et un domaine où l'expérimentation est particulièrement difficile pour des raisons évidentes, mais aussi parce que sa complexité et sa structure délicate rendent le fonctionnement quasi inaccessible aux mesures. Une simulation numérique du ...
-
BROWN-SÉQUARD CHARLES ÉDOUARD (1817-1894)
- Écrit par Universalis
- 328 mots
Physiologiste et neurologue, pionnier de l'endocrinologie et de la neurophysiologie, Brown-Séquard fut parmi les premiers à étudier la physiologie de la moelle épinière. Il décrivit notamment un syndrome qui porte son nom (il correspond à l'hémisection médullaire, dont les effets ont...
-
BULBE RACHIDIEN
- Écrit par Paul LAGET
- 4 096 mots
- 5 médias
Il est connu que le bulbe rachidien constitue une région d'importance vitale et que sa destruction ou une lésion même légère sont fatales (nœud vital de Flourens). Cela tient à la présence, au sein de la réticulée bulbaire, de centres de première importance pour le contrôle et la régulation respiratoire... -
CANAUX IONIQUES
- Écrit par Laurent COUNILLON, Mallorie POËT
- 4 298 mots
- 8 médias
Bien qu'il soit possible de les retrouver au niveau périphérique, ces canaux sont particulièrement importants dans le système nerveux central, puisqu'ils sont impliqués dans la transmission synaptique, mécanisme de base du fonctionnement de l'esprit, ainsi que dans la régulation du niveau général d'... -
CERVEAU ET LANGAGE ORAL
- Écrit par Jean-François DÉMONET
- 2 869 mots
- 5 médias
...langage s’est effectuée à l’aide de paradigmes issus de la psychologie expérimentale adaptés au comportement du tout jeune enfant, de méthodes de neurophysiologie (potentiels évoqués, imagerie optique) et d’imagerie cérébrale (imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMf). Ces travaux ont... -
CERVEAU HUMAIN
- Écrit par André BOURGUIGNON, Cyrille KOUPERNIK, Pierre-Marie LLEDO, Bernard MAZOYER, Jean-Didier VINCENT
- 12 782 mots
- 9 médias
Comprendre l'organisation du tissu cérébral et sa logique est l'une des questions centrales de la neurobiologie moderne. Or le cerveau humain est la structure vivante la plus complexe que nous connaissons. Cet organe n'est pas homogène et sa complexité s'exprime par la juxtaposition de différents...
-
CERVELET
- Écrit par Jean MASSION
- 7 767 mots
- 13 médias
Lesexpériences classiques de Horsley, de C. S. Sherrington et de F. Bremer avaient montré que l'excitation électrique d'une moitié du vermis fait apparaître une inhibition des muscles extenseurs du même côté suivie après la fin de la stimulation d'un effet opposé ou « rebond » caractérisé par l'exagération... -
CHARCOT JEAN-MARTIN (1825-1893)
- Écrit par Jean-Gaël BARBARA
- 3 047 mots
- 3 médias
...tard chaque pathologie par des troubles physiologiques spécifiques. Si certaines pathologies dont l’étiologie est simple peuvent suivre ce schéma, les pathologies dégénératives complexes comme les maladies neurologiques requièrent la prudence de la conception de Charcot, même si ce dernier se montra également... -
CHARLES SHERRINGTON : CONCEPT D'INTÉGRATION NERVEUSE
- Écrit par Yves GALIFRET, Yves LAPORTE
- 304 mots
La parution en 1906 d'un important ouvrage de sir Charles Scott Sherrington fait date en neurophysiologie. Dans Integrative Action of the Nervous System, il interprète l'unification du comportement d'un organisme comme l'expression ultime d'un processus d'intégration nerveuse. Sous sa forme...
-
COGNITIVES SCIENCES
- Écrit par Daniel ANDLER
- 19 262 mots
- 4 médias
...Behaviour,du psychologue Donald Hebb. Dans sa Préface, Hebb insiste sur les « larges recoupements » entre les recherches du psychologue et celles du neurophysiologiste. Hebb est professeur à l'université McGill, à Montréal. C'est là que travaille également Wilder Penfield. Ce neurochirurgien,... -
COMA
- Écrit par Marie-Elisabeth FAYMONVILLE, Geneviève LABORIT, Henri LABORIT, Steven LAUREYS, Pierre MAQUET
- 3 197 mots
- 3 médias
Le coma peut résulter d'une lésion focale touchant le système réticulé activateur (normalement, la formation réticulée a une fonction activatrice : elle « bombarde » le cortex d'informations qui maintiennent le sujet éveillé) ou d'une atteinte diffuse de neurones ou axones (les longs prolongateurs... -
CONSCIENCE
- Écrit par Henri EY
- 10 480 mots
- 1 média
...conscience s'est imposée en même temps qu'elle s'engageait ainsi dans l'impasse de la concomitance. Pour H. Jackson, en effet, père de toutes les théories neurophysiologiques des Temps modernes, le modèle du système nerveux était essentiellement moteur ou sensori-moteur, ou encore réflexe ; de telle sorte,... -
CONTRÔLE CENTRAL DE L'APPÉTIT
- Écrit par Serge LUQUET
- 5 946 mots
- 6 médias
Tous les organismes ont besoin d’un apport en calories qui s’équilibre avec leurs besoins énergétiques pour assurer leur survie. Ainsi des mécanismes sophistiqués et redondants se sont-ils mis en place au cours de l’évolution afin d’optimiser la capacité d’un organisme à s’adapter à ses besoins...
-
COUTEAUX RENÉ (1909-1999)
- Écrit par Jacques TAXI
- 1 104 mots
Né à Saint-Amand-les-Eaux (Nord), René Couteaux mena de front ses études de médecine et de sciences naturelles aux facultés de Lille, puis de Paris (1928-1933). Ayant toujours eu pour objectif la recherche scientifique, il entra dès 1932 au laboratoire de biologie expérimentale de la Sorbonne, dirigé...
Médias