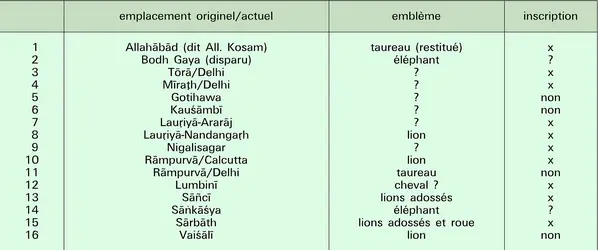MAURYA
Influences étrangères
La ville de Śiśupālgaṛh en Orissa, peut-être fondée au iiie siècle avant notre ère, présente un aspect très différent de ces villes purement indiennes. Elle a été à peine fouillée, mais son plan carré, ses entrées monumentales, le soin apporté à la construction du rempart de terre et de latérite, représentent une telle rupture avec l'urbanisme de l'Inde ancienne que l'on y suppose à bon droit l'influence d'architectes grecs, attirés en Inde par la puissance des Maurya.
En 1912 furent dégagés à Patna les restes d'un édifice que beaucoup considèrent comme le palais de Candragupta et qui consiste en une grande salle hypostyle, comportant plus de quatre-vingts colonnes de grès poli, hautes de 6 à 7 mètres. Ce plan évoque immédiatement celui de la salle d'audience de Darius à Persépolis. Sur le même emplacement avait été découvert un chapiteau à volutes, dont la forme rappelle celle de certains chapiteaux de Persépolis, décoré de rosettes semblables également à celles de Persépolis, mais aussi de palmettes qui évoquent davantage l'art hellénistique. On ne connaît pas en Inde de restes plus anciens d'une grande architecture en pierre de taille. L'introduction en Inde de ces techniques et de ces modèles procède incontestablement, de la part des souverains maurya, d'une volonté politique : celle d'élever, à l'imitation des grandes puissances passées (Achéménides) ou contemporaines (royaumes séleucide et bactrien), des monuments dignes de leur puissance. Pour ce faire, les Maurya attirèrent à leur service des artistes et des artisans perses, sans travail depuis la chute des Achéménides, et, grâce aux relations suivies qu'ils entretenaient avec l'Orient hellénistique, des artistes grecs ou hellénisés. La difficulté est dès lors de démêler ce qui, dans l'art maurya, appartient en propre à l'Inde, à la Perse, et à la Grèce.
Ainsi les grottes artificielles de Barābar et Nāgārjuni, au sud de Patna, imitent clairement par leurs volumes les huttes de bois des ascètes indiens. La façade de la plus belle d'entre elles, la grotte de Lomaśa Rṣi, est la transcription en pierre d'une porte et d'une avancée de toit en bois. Les habitations troglodytes sont suffisamment répandues pour que l'on ne cherche pas l'origine de ce procédé dans les tombes achéménides, mais le poli des parois évoque celui des sculptures de Persépolis.
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Gérard FUSSMAN : professeur au Collège de France
Classification
Pour citer cet article
Gérard FUSSMAN. MAURYA [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
AFGHANISTAN
- Écrit par Daniel BALLAND, Gilles DORRONSORO, Universalis, Mir Mohammad Sediq FARHANG, Pierre GENTELLE, Sayed Qassem RESHTIA, Olivier ROY, Francine TISSOT
- 37 316 mots
- 19 médias
...devenait le fief de Séleucos Nicator (355-280) qui dut toutefois céder l'Afghanistan situé au sud de l'Hindou-Kouch à Chandragupta, fondateur de l'empire Maurya des Indes. Le premier document écrit, découvert en Afghanistan, est dû à l'empereur Açoka, petit-fils de Chandragupta, qui fut célèbre aussi bien... -
ARTHAŚĀSTRA (attribué à Kautilya) - Fiche de lecture
- Écrit par François CHENET
- 1 506 mots
...remarquable au regard de nos critères, ce royaume idéal de consonance étrangement moderne correspond-il pour autant à la réalité historique des États indiens ? L'Empire Maurya, dans le bassin moyen du Gange, s'était certes doté d'une administration bureaucratique très organisée, qui contrôlait toute la vie... -
INDE (Le territoire et les hommes) - Histoire
- Écrit par Universalis, Christophe JAFFRELOT, Jacques POUCHEPADASS
- 22 936 mots
- 25 médias
...l'espace gangétique, des approches du Pañjāb aux confins du Bengale. En 321, le trône est usurpé par un aventurier d'ascendance aborigène, Çandragupta Maurya, qui étend la domination du Magadha vers le sud jusqu'à la Narmadā, et reprend en 303 sur Séleukos Nikator les provinces indiennes d'Alexandre.... -
INDE (Arts et culture) - L'art
- Écrit par Raïssa BRÉGEAT, Marie-Thérèse de MALLMANN, Rita RÉGNIER
- 49 040 mots
- 67 médias
Candragupta, père de la dynastie Maurya, fonda un empire qui allait s'étendre sur la majeure partie du subcontinent (l'extrême Sud excepté) et jusqu'à l'Hindukush. Ce premier effort d'unification indienne fut en quelque sorte l'aboutissement d'un sursaut national qui avait chassé du Sindh et du Pañjāb... - Afficher les 7 références
Voir aussi
- INDIEN ART
- COLONNE
- STŪPA
- PIERRE, sculpture
- MAURYA ART
- PERSAN ART
- BOUDDHIQUE ART
- PIERRE, architecture
- CHANDRAGUPTA, roi de l'Inde (313-289 av. J.-C.)
- PĀTNA ou PĀTALIPUTRA
- IRANO-BOUDDHIQUE ART
- INDE, histoire : des origines au XIIe s.
- CIVILE ARCHITECTURE, Antiquité
- VILLE, urbanisme et architecture
- KAUṬILYA ou KAUTALYA (IVe s.)
- INDIENNE ARCHITECTURE
- INDIENNE SCULPTURE
- ŚIŚUPĀLGAṚH ou ÇIÇUPĀLGAṚH, Inde
- MONOLITHES