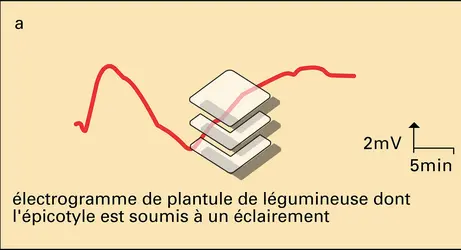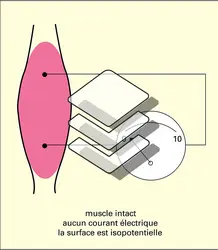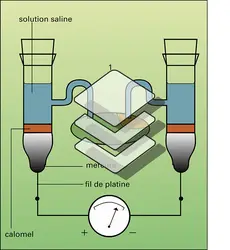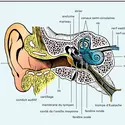ÉLECTROPHYSIOLOGIE
Électro-encéphalographie
L' électro-encéphalographie est l'investigation électrophysiologique permettant d'enregistrer et d'analyser l'activité des générateurs bioélectriques cérébraux, telle qu'elle se manifeste au niveau des enveloppes cutanées du crâne (ou scalp).
Le champ électrique créé par ces générateurs diffère selon les régions du scalp et varie constamment dans le temps. Il est capté par des couples d'électrodes judicieusement disposés à la surface du cuir chevelu, amplifié et enregistré sous la forme d'une courbe, appelée tracé électro-encéphalographique ou électro-encéphalogramme, qui exprime la variation temporelle des différences de potentiel qui s'établissent entre les deux électrodes. On désigne par électro-encéphalogramme (en abrégé : E.E.G.) un ensemble de plusieurs tracés électro-encéphalographiques recueillis en des points différents du scalp et enregistrés simultanément.
Ces tracés se présentent sous forme d'oscillations plus ou moins régulières, dont les fréquences sont, en gros, comprises entre 0,5 et 35 cycles par seconde. On désigne les phases de ces rythmes sous le nom d'« ondes cérébrales ». Les procédés les plus modernes d'enregistrement et d'analyse (cartographie par analyse de fréquence) sont utilisés pour extraire de ces tracés E.E.G. le maximum d'informations sur la localisation des sources intracérébrales ; ils permettent aussi de caractériser les ondes cérébrales, et d'établir dans un but diagnostique des corrélations entre ces ondes et le fonctionnement normal ou pathologique du cerveau.
Après quelques observations sur le cerveau animal, dont les premières remontent à 1875 (R. Caton, Liverpool), c'est seulement en 1924, à Iéna, que Hans Berger, aidé du sensible galvanomètre à corde, put recueillir le premier E.E.G. humain. Il publia en 1929 sa découverte de deux types d'activités électriques cérébrales quasi sinusoïdales, qu'il dénomma « rythme alpha », voisin de 10 cycles par seconde, et « rythme bêta », supérieur à 15 cycles par seconde.
Principe et technique
Pour capter l'information, l'amplifier, en donner une représentation claire sur un support aisé à conserver, l'appareillage E.E.G. comporte différents éléments.
Capteurs
Les capteurs, qui ne doivent pas se polariser, sont le plus souvent des électrodes d'argent chloruré, fixées sur le cuir chevelu soit par l'intermédiaire de brides qui entourent la tête du sujet, soit par collage. Au nombre de vingt, elles sont disposées de façon symétrique par rapport à la ligne sagittale du crâne (médiane antéropostérieure) et à égale distance les unes des autres, afin de pouvoir réaliser de multiples couples équidistants que des commandes permettent de sélectionner pour l'interrogation successive de collections différentes d'électrodes (longitudinales, transversales, circulaires...).
L'ensemble fonctionnel constitué par un couple d'électrodes, ses liaisons à une chaîne d'amplification et l'inscripteur correspondant est appelé dérivation.
Pour explorer toute la surface du scalp, on utilise simultanément plusieurs dérivations. Ces ensembles de dérivations, ou montages, intéressent des couples formés par des électrodes proches ou éloignées (dérivations à courte ou longue distance inter-électrodes).
Amplificateurs
Les différences de potentiel captées par des électrodes distantes de 3 à 5 cm se situent, grosso modo, entre 200 et 10 micro-volts (μV). Les amplificateurs utilisés doivent donc avoir un gain élevé (de l'ordre de 10 μV/cm). Ils sont constitués par un préamplificateur dont le bruit de fond est inférieur à 5 μV/cm et un postamplificateur à liaison continue. Des commandes manuelles permettent de modifier le gain d'amplification entre 10 et 300 μV/cm.[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Max DONDEY : assistant des Hôpitaux de Paris, directeur adjoint à l'École pratique des hautes études
- Jean DUMOULIN : professeur à la faculté libre de médecine de Lille
- Alfred FESSARD : professeur honoraire à la faculté des sciences de Paris
- Paul LAGET : professeur de psychophysiologie à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie
- Jean LENÈGRE : ancien professeur à la faculté de médecine de Paris.
Classification
Pour citer cet article
Max DONDEY, Jean DUMOULIN, Alfred FESSARD, Paul LAGET et Jean LENÈGRE. ÉLECTROPHYSIOLOGIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
ARSONVAL ARSÈNE D' (1851-1940)
- Écrit par Georges KAYAS
- 394 mots
Médecin, biologiste et physicien français, d'Arsonval a fait ses études au lycée impérial de Limoges, puis au collège Sainte-Barbe à Paris. Il se destinait à la médecine lorsqu'il fit la rencontre de Claude Bernard dont il devint le préparateur (1873-1878). De 1882 à 1910 il dirigea le laboratoire...
-
AUDITION - Acoustique physiologique
- Écrit par Pierre BONFILS, Yves GALIFRET, Didier LAVERGNE
- 14 809 mots
- 17 médias
Les premiers enregistrements intracellulaires du potentiel de récepteur des cellules ciliées de la cochlée des Mammifères ont été faits en 1977, par I. J. Russell et P. M. Sellick, et cette réussite constitue une étape importante dans le développement de la physiologie de l'audition. On constate qu'avec... -
BERGER HANS (1873-1941)
- Écrit par Henri GASTAUT
- 828 mots
Le 21 mai 1873 à Neuses, petite ville près de Coburg, Hans Berger naît dans une famille d'intellectuels. Après avoir terminé ses études médicales, à l'âge de vingt-quatre ans, il rejoignit l'équipe de la clinique psychiatrique de l'université de Iéna qu'il ne quittera plus jusqu'à la fin de sa...
-
CANAUX IONIQUES
- Écrit par Laurent COUNILLON, Mallorie POËT
- 4 298 mots
- 8 médias
Bien que la possibilité d'une forme d'énergie électrique intervenant dans le fonctionnement du système nerveux ait déjà été évoquée par Newton dans ses Principia mathematica en 1713, il faut attendre la fin du xviiie siècle pour que Luigi Galvani montre que la contraction du...
- Afficher les 44 références
Voir aussi
- SOMMEIL-RÊVE-ÉVEIL CYCLE
- FŒTALE VIE
- CRISE D'ÉPILEPSIE
- GRAND MAL ÉPILEPTIQUE
- RYTHMES CÉRÉBRAUX
- ONDE ou RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE
- ÉLECTROCARDIOGRAMME (ECG)
- BRADYCARDIE
- DIPÔLE, électricité
- AMPLIFICATEURS
- IONISATION
- COURANT ÉLECTRIQUE
- POTENTIEL ÉLECTRIQUE
- MYASTHÉNIE
- DÉCHARGE ÉLECTRIQUE
- CAPTEURS BIOMÉDICAUX
- ÉLECTRODES
- NERNST ÉQUATION DE
- TORPILLE, zoologie
- ÉLECTRODE AU CALOMEL
- PHYSIOLOGIE
- CHRONAXIE
- ÉLECTROMYOGRAPHIE
- ÉLECTROTHÉRAPIE
- BIOÉLECTROGENÈSE ou ÉLECTROGENÈSE BIOLOGIQUE
- DUCHENNE DE BOULOGNE GUILLAUME BENJAMIN (1806-1875)
- ERB WILHELM HEINRICH (1840-1921)
- ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIE (EEG)
- POTENTIEL DE REPOS
- POTENTIEL D'ACTION
- POTENTIEL SYNAPTIQUE
- INSUFFISANCE CORONARIENNE
- FORCE ÉLECTROMOTRICE
- NERFS
- NEUROPHYSIOLOGIE
- SODIUM, biologie
- POTASSIUM, biologie
- NEURONE ou CELLULE NERVEUSE
- MEMBRANES BIOLOGIQUES
- ÉLECTRORÉCEPTEUR
- ANALGÉSIE
- DIÉLECTROLYSE
- PHYSIOTHÉRAPIE
- SOMMEIL PARADOXAL
- ÉVEIL
- BIOPOTENTIELS
- POTENTIELS ÉVOQUÉS
- CONTRACTION MUSCULAIRE
- PERMÉABILITÉ, physiologie cellulaire
- INFORMATIQUE, biologie et médecine
- MÉDECINE HISTOIRE DE LA
- ENREGISTREMENTS PHYSIOLOGIQUES
- PACEMAKERS
- DÉRIVATIONS, électrophysiologie
- NEUROSTIMULATION TRANSCUTANÉE
- CONDUCTION INTRACARDIAQUE
- COURANT D'ACTION, électrophysiologie
- POISSONS ÉLECTRIQUES
- BLOC DE BRANCHE
- ÉLECTRODIAGNOSTIC
- ÉLECTROPLAQUES
- ÉLECTROTONUS
- REPOLARISATION, physiologie
- VECTOCARDIOGRAPHIE