- 1. Les isotopes naturels et artificiels de l’hydrogène
- 2. Le spectre de l’atome d’hydrogène et l’avènement de la mécanique quantique
- 3. Hydrogène et naissance de l’électrodynamique quantique
- 4. Structure du noyau de l’atome d’hydrogène et chromodynamique quantique
- 5. L’antihydrogène
- 6. Les phases de l’hydrogène
- 7. Hydrogène et astrophysique
- 8. Hydrogène et énergie
HYDROGÈNE (physique)
- Article mis en ligne le
- Modifié le
- Écrit par Bernard PIRE
Structure du noyau de l’atome d’hydrogène et chromodynamique quantique
L’élucidation du spectre de l’hydrogène a ainsi débouché sur une physique de l’électron différente de l’électromagnétisme classique, mais qui lui est cependant reliée. Le noyau de l’atome d’hydrogène n’a pas moins contribué à la compréhension de la matière et des interactions fondamentales : la quête des constituants élémentaires de l’Univers, entreprise par le biais des accélérateurs de particules toujours plus puissants, est naturellement passée par l’étude de ce noyau, le plus simple possible, autrement dit le proton.
À partir des années 1950, les physiciens américains tentent de mesurer les caractéristiques du noyau de l’atome d’hydrogène grâce aux faisceaux d’électrons accélérés jusqu’à 1 gigaélectronvolt (GeV), à l'université Stanford (Californie), qui constituent des sortes de supermicroscopes électroniques permettant de discerner des détails extrêmement fins. En étudiant les distributions angulaires des trajectoires des électrons lorsqu’ils rebondissent sur le noyau d’hydrogène, l’équipe de Robert Hofstadter (1915-1990) démontre que la forme moyenne du proton est celle d’une boule de rayon de l’ordre de 0,8 femtomètre (1 fm = 10–15 m) dans laquelle les charges électriques semblent réparties de manière homogène, entourée d'une zone dans laquelle la densité de charge décroît très rapidement.
Cette vision est affinée à la fin des années 1960 lorsque des expériences utilisant des faisceaux d’électrons encore plus puissants révèlent que le noyau atomique est un édifice qui semble constitué de protons et de neutrons, lorsqu’on l’observe avec certains moyens expérimentaux, mais est en fait constitué de particules élémentaires appelées quarks, antiquarks et gluons. Le noyau d’hydrogène, le proton, est ainsi une superposition d’états constitués de divers assemblages de quarks, d’antiquarks et de gluons. Une nouvelle théorie quantique émerge alors dans les années 1970 comme la seule description cohérente connue de l’interaction nucléaire : la chromodynamique quantique, construite sur le modèle de l'électrodynamique quantique, généralise le concept de charge électrique en postulant l'existence d'une charge dite de « couleur » portée par les quarks présents dans les protons et les neutrons. Des gluons de masse nulle, porteurs eux aussi d'une charge de « couleur », sont les messagers de cette interaction élémentaire, qui reste aujourd’hui l’objet de nombreuses recherches théoriques et expérimentales.
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Bernard PIRE : directeur de recherche émérite au CNRS, centre de physique théorique de l'École polytechnique, Palaiseau
Classification
Pour citer cet article
Bernard PIRE. HYDROGÈNE (physique) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Article mis en ligne le et modifié le 27/09/2022
Médias
Autres références
-
DÉCOUVERTE DE L'HYDROGÈNE PAR CAVENDISH
- Écrit par Bernard PIRE
- 728 mots
L’article envoyé en mai 1766 par l’honorable Henry Cavendish (1731-1810) à la Royal Society, dont il est membre, décrit de façon magistrale la découverte d’un gaz léger s’échappant de certaines réactions chimiques : l’hydrogène. Ces travaux, publiés dans la livraison datée du 1...
-
ACIDO-BASIQUE ÉQUILIBRE
- Écrit par Pierre KAMOUN
- 2 955 mots
- 1 média
L'apport alimentaire en ions hydrogène H+ est essentiellement représenté par les amino-acides introduits par les protéines (10 g de protéines libèrent 6 à 7 milliéquivalents d'ions H+). -
AMMONIAC
- Écrit par Henri GUÉRIN
- 5 033 mots
- 5 médias
L'action des sels d'ammonium sur les métaux dans l'ammoniac liquide est semblable à celle des acides en phase aqueuse : on obtient un sel du métal attaqué et un dégagement d'hydrogène :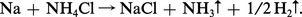
-
ARCHÉES ASGARD
- Écrit par Patrick FORTERRE
- 3 785 mots
- 3 médias
...avec une bactérie sulfato-réductrice du genre Desulfovibrio et une archée productrice du méthane du genre Methanogenium. L’archée Loki produit de l’hydrogène qui est utilisé par la bactérie pour produire du sulfure d’hydrogène et par Methanogenium pour produire du méthane. Hiroyuki Imachi... -
ASTROCHIMIE
- Écrit par David FOSSÉ et Maryvonne GERIN
- 4 388 mots
- 3 médias
- Afficher les 59 références








