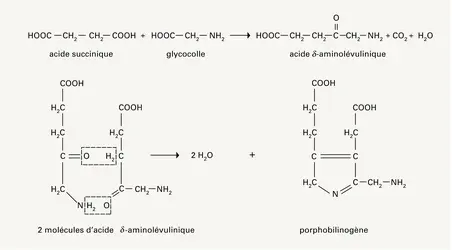CHLOROPHYLLES
Propriétés optiques
La richesse des molécules de chlorophylles en doubles liaisons conjuguées entre les atomes de carbone et d'azote, doubles liaisons séparées par une seule liaison simple ( = C − C = ou = C − N = ), leur communique une intense coloration. En solution dans l'éther, l'acétone ou le méthanol, la chlorophylle a est bleu-vert alors que la chlorophylle b est vert-jaune. Ces pigments possèdent deux bandes d'absorption intense. L'une concerne les radiations bleues (420-480 nm, ), elle est commune à tous les pigments tétrapyrroliques (bande de Soret) ; l'autre se situe dans la partie rouge du spectre (640-680 nm).
Leurs spectres montrent l'importance de l'absorption des radiations visibles dans le bleu et le rouge.
Dans les chloroplastes où les chlorophylles sont concentrées en agrégats, on observe un décalage des maximums d'absorption vers les grandes longueurs d'onde. L'agrégation des molécules de chlorophylles entre elles et avec d'autres molécules, en complexes colloïdaux, s'accompagne en effet d'un déplacement des maximums d'absorption de 10 à 15 nanomètres vers les grandes longueurs d'onde. Les solutions colloïdales aqueuses de chlorophylles présentent un déplacement du même ordre. Une partie de la diffusion de la lumière par les cellules végétales est due à un tel état d'agrégation.
Quant aux bactériochlorophylles, leurs maximums d'absorption sont situés dans le proche infrarouge. In vivo, ils se situent à 800, 850, 890 nm, pour les bactéries pourpres.
Les solutions de chlorophylles présentent une belle fluorescence rouge correspondant à une émission de radiations de plus grande longueur d'onde que celle de la lumière absorbée. Cette fluorescence est diminuée par l'addition de quinone qui joue le rôle d'extincteur (quencher).
Les monocouches de molécules de chlorophylles juxtaposées, obtenues à partir de solutions inertes convenablement étalées et dont le solvant a été évaporé, ne sont pas fluorescentes tandis que les chlorophylles in vivo le sont. On ne peut donc assimiler leur état biologique à celui de monocouches amorphes.
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Alexis MOYSE : professeur honoraire à l'université de Paris-Sud, correspondant de l'Académie des sciences
Classification
Pour citer cet article
Alexis MOYSE. CHLOROPHYLLES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
ALGUES
- Écrit par Bruno DE REVIERS
- 4 869 mots
- 9 médias
...souvent nommées plantes terrestres et qui regroupent, au sens large, les mousses, les fougères et les plantes à graines –, les algues possèdent de la chlorophylle. Ce pigment vert permet aux algues et aux embryophytes de fabriquer (synthétiser) de la matière vivante à partir du dioxyde de carbone (CO... -
AUTOTROPHIE & HÉTÉROTROPHIE
- Écrit par Alexis MOYSE
- 2 503 mots
- 2 médias
Les euglènes, algues unicellulaires des mares, possèdent de la chlorophylle et, par photosynthèse, assimilent le gaz carbonique. Cependant elles ne peuvent vivre sur des milieux purement minéraux. Quelques substances organiques leur sont indispensables : la vitamine B12, les constituants de... -
CHLOROPLASTES
- Écrit par Paul MAZLIAK
- 865 mots
Dans les cellules chlorophylliennes des végétaux supérieurs, il existe deux modes de fixation du gaz carbonique (CO2 ou dioxyde de carbone) : le type de fixation en C3 et le type en C4 ainsi désignés en fonction du nombre d'atomes de carbone de la molécule photosynthétisée (voir...
-
COMPLEXES, chimie
- Écrit par René-Antoine PARIS, Jean-Pierre SCHARFF
- 4 304 mots
- 5 médias
...l'importance des chélates dans le règne végétal qu'en rappelant leur rôle essentiel dans les processus fondamentaux tels que la photosynthèse initiée par la chlorophylle (en réalité, il existe plusieurs types de chlorophylles qui ont toutes en commun un chromophore constitué par la jonction de quatre noyaux... - Afficher les 13 références
Voir aussi
- ABSORPTION, physique
- PHYTOL
- PHYCOCYANINE
- PHYCOÉRYTHRINE
- CHROMOPHORE
- FLUORESCENCE
- EXCITATION ÉLECTRONIQUE ÉNERGIE D'
- THYLAKOÏDES
- VÉGÉTALE BIOLOGIE
- EXCITATION, physique
- TRANSITION, physique
- OXYDATION
- TÉTRAPYRROLIQUES COMPOSÉS
- BACTÉRIOCHLOROPHYLLES
- HÈME
- PYRROLE & NOYAU PYRROLIQUE
- DÉCOLORATION
- NIVEAU, physique atomique
- RÉDUCTION, chimie
- BIOSYNTHÈSES
- OXYDORÉDUCTIONS, biologie
- BIOÉNERGÉTIQUE
- TRANSPORT D'ÉLECTRONS, bioénergétique
- PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE ou PHYTOBIOLOGIE
- CYTOLOGIE VÉGÉTALE
- MOLÉCULES BIOLOGIQUES, structure et fonction
- SPECTRE D'ABSORPTION
- CARBONIQUE GAZ ou DIOXYDE DE CARBONE