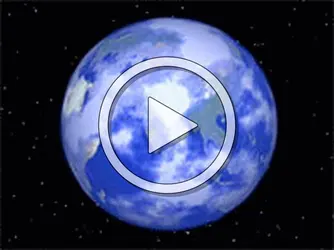CARBONIQUE GAZ ou DIOXYDE DE CARBONE
Articles
-
ACIDIFICATION DES OCÉANS
- Écrit par Paul TRÉGUER
- 2 201 mots
- 5 médias
Par sa capacité à dissoudre les gaz atmosphériques responsables de l'effet de serre, l'océan joue un rôle essentiel dans la régulation du climat. Toutefois, l'absorption de l'excès de dioxyde de carbone (CO2) rejeté par les activités humaines (anthropiques) depuis 1850...
-
ACIDO-BASIQUE ÉQUILIBRE
- Écrit par Pierre KAMOUN
- 2 955 mots
- 1 média
L'acide carbonique existe en fait sous forme de CO2 dissous (moins de 1 p. 100 étant sous forme de H2CO3). On désigne donc sous le terme de CO2 dissous la somme H2CO3 + CO2 définie par l'expression S × pCO2 où S est le coefficient qui relie la somme H2CO3 + CO2 en mmol/l... -
AGROMÉTÉOROLOGIE
- Écrit par Emmanuel CHOISNEL, Emmanuel CLOPPET
- 6 627 mots
- 7 médias
...tempérées), par rapport aux plantes en C4 (plantes ayant pour la plupart une origine tropicale, comme le maïs, la canne à sucre, le sorgho ou le millet). En effet, les plantes en C3 (plantes qui, par photosynthèse, fixent le dioxyde de carbone [CO2]en formant un composé à trois atomes de carbone) auront... -
ANTARCTIQUE
- Écrit par Pierre CARRIÈRE, Edmond JOUVE, Jean JOUZEL, Gérard JUGIE, Claude LORIUS
- 16 481 mots
- 24 médias
...atmosphérique. Enfin, on a observé pour la première fois une corrélation directe entre l'évolution de la température et la teneur de l' atmosphère en gaz carbonique, les périodes les plus chaudes étant associées à des teneurs plus élevées et vice versa. En ce qui concerne l'époque récente, on a pu mesurer... -
AUTOMOBILE - Défis
- Écrit par Daniel BALLERINI, François de CHARENTENAY, André DOUAUD, Francis GODARD, Gérard MAEDER, Jean-Jacques PAYAN
- 11 590 mots
- 8 médias
Lesémissions de CO2 sont directement liées à l'utilisation des moteurs thermiques. Sans effets négatifs sur la santé, à la différence des polluants, le dioxyde de carbone contribue à l'effet de serre. Il n'y a pas à ce jour de réglementation européenne, mais un engagement de l'A.C.E.A. (Association... -
BARNOLA JEAN-MARC (1956-2009)
- Écrit par Universalis
- 208 mots
Le glaciologue Jean-Marc Barnola, né le 3 janvier 1956 à Bourg-en-Bresse (Ain), est décédé le 21 septembre 2009 à La Mure dans l'Isère. Aux côtés de Claude Lorius, de Jean Jouzel et de Dominique Raynaud, il a amplement contribué à l'essor de la glaciologie moderne et des implications...
-
BÉTON
- Écrit par Jean-Michel TORRENTI
- 8 163 mots
- 1 média
...disparaître si le pH diminue. Dans ce cas, la corrosion démarre et, à terme, se traduit par de la fissuration et des éclatements de béton de parement. La carbonatation, réaction du CO2 provenant de l'air avec la portlandite, fait baisser le pH. La cinétique de ce phénomène est pilotée par la diffusion... -
BIOCARBURANTS ou AGROCARBURANTS
- Écrit par Jean-Paul CHARVET, Anthony SIMON
- 6 509 mots
- 10 médias
Les programmes de promotion des biocarburants participent à lalimitation des émissions de dioxyde de carbone (CO2), gaz considéré comme responsable d’un effet de serre additionnel dans le contexte du réchauffement climatique. Se posent toutefois à leur sujet bien des questions, qu’il s’agisse de... -
BLACK JOSEPH (1728-1799)
- Écrit par Georges BRAM
- 487 mots
Chimiste et physicien écossais né à Bordeaux, où son père était négociant en vins, et mort à Édimbourg. Il étudie à l'université de Glasgow, puis à celle d'Édimbourg où il obtient en 1754 son doctorat en médecine. Après avoir enseigné à partir de 1756 la médecine et la chimie à l'université de Glasgow,...
-
CALVIN MELVIN (1911-1997)
- Écrit par Georges BRAM
- 631 mots
Fils d'émigrés russes, né le 8 avril 1911 à Saint Paul (Minn.), le biochimiste américain Melvin Calvin est décédé à Berkeley (Calif.) le 8 janvier 1997.
Après un doctorat obtenu en 1935, Calvin effectue un stage postdoctoral de deux ans en Grande-Bretagne à l'université de Manchester...
-
CARBONE
- Écrit par Jean AMIEL, Henry BRUSSET
- 8 257 mots
- 11 médias
...oxygène est particulièrement importante car elle produit une partie de l'énergie industrielle. On obtient souvent un mélange de mono- et de dioxyde de carbone ; il semble que le monoxyde soit un produit primaire de la réaction. Dans le cas d'une combustion du carbone en présence d'un excès... -
CARBURANTS
- Écrit par Daniel BALLERINI, Jean-Claude GUIBET, Xavier MONTAGNE
- 10 527 mots
- 9 médias
La combustion des produits issus de matières premières d'origine fossile (charbon, gaz naturel, pétrole) fournit du dioxyde de carbone (CO2) et d'autres substances (méthane, oxydes d'azote) qui, directement ou indirectement, contribuent à accroître l'effet de serre dont on redoute... -
CARBURANTS POUR L'AVIATION
- Écrit par Paul NASH, Odile PÉTILLON
- 3 244 mots
- 3 médias
...à effet de serre émis est le dioxyde de carbone. Au niveau mondial, le trafic aérien n'est responsable que d'un peu plus de 10 p. 100 des émissions de CO2 liées au transport. Toutefois, avec un taux de croissance du trafic aérien de l'ordre de 4,5 p. 100 par an, qui devrait se maintenir dans les prochaines... -
CHANGEMENT ANTHROPIQUE DU CLIMAT
- Écrit par Jean-Louis DUFRESNE, Céline GUIVARCH
- 8 203 mots
- 7 médias
La concentration de l’atmosphère enCO2 est mesurée directement depuis la fin des années 1950 par prélèvement continu de l’air sur quelques sites, ces données étant complétées par des mesures satellitaires depuis les années 1990. Elle est passée de 315 parties par million en volume (ppmv ; ici, nombre... -
CHARBON - Industrie charbonnière
- Écrit par Michel BENECH, Pierre BERTE, Jacques BONNET, Robert PENTEL
- 11 928 mots
- 3 médias
Cependant, comme le pétrole et le gaz, le charbon est un combustible fossile qui émet dudioxyde de carbone (CO2), gaz à effet de serre, lors de sa combustion. La contribution la plus importante et la plus rentable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre réside dans l'augmentation du... -
CHIMIE - Histoire
- Écrit par Élisabeth GORDON, Jacques GUILLERME, Raymond MAUREL
- 11 186 mots
- 7 médias
...fort loué par Lavoisier, que revient la gloire de fonder positivement la chimie « pneumatique ». Grâce à lui, le caractère d'espèce chimique d'un gaz, l'« air fixe », notre anhydride carbonique, est défini sans ambages. Il démontre, dans sa dissertation de 1754, que les différences chimiques entre «... -
CHIMIE - La chimie aujourd'hui
- Écrit par Pierre LASZLO
- 10 856 mots
- 3 médias
Le grand pionnier de la chimie environnementale fut le Suédois Svante Arrhenius (1859-1927). Dès 1895, la connaissance du spectre infrarouge dudioxyde de carbone CO2 lui fit comprendre l'effet de serre dû au dégagement de ce gaz dans l'atmosphère, à la suite de combustions. Il aura fallu un siècle... -
CHIMIE - Chimie durable
- Écrit par Hagop DEMIRDJIAN
- 2 953 mots
- 3 médias
Ledioxyde de carbone (CO2), à l'état supercritique (intermédiaire entre gaz et liquide), est utilisé comme substitut aux solvants organiques apolaires. Il remplace par exemple le tétrachlorométhane CCl4, très toxique, dans le procédé de décaféination. Le dioxyde de carbone cumule de nombreux... -
CHLOROPHYLLES
- Écrit par Alexis MOYSE
- 3 547 mots
- 4 médias
La photosynthèse se caractérise matériellement par un transfert d'électrons et de protons de l'eau au bioxyde de carbone qui se trouve réduit avec formation de glucides. Cette opération requiert de l'énergie et, dans les meilleures conditions, il faut 8 photons-grammes (8 einsteins) par molécule-gramme... -
CHLOROPLASTES
- Écrit par Paul MAZLIAK
- 865 mots
Dans les cellules chlorophylliennes des végétaux supérieurs, il existe deux modes de fixation du gaz carbonique (CO2 ou dioxyde de carbone) : le type de fixation en C3 et le type en C4 ainsi désignés en fonction du nombre d'atomes de carbone de la molécule photosynthétisée (voir...
Médias