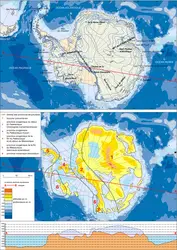ANTARCTIQUE
Statut de l'Antarctique en droit international
Après avoir, longtemps, laissé libre cours aux initiatives privées, les États-Unis proposèrent, en 1948, la réunion d'une conférence internationale pour régler le sort de l'Antarctique. Elle ne put avoir lieu, du fait des exigences soviétiques. Il fallut attendre qu'en 1956 se déclenche un mouvement général d'intérêt pour les sciences de la Terre, à la faveur de l' Année géophysique internationale (A.G.I.). Un plan très ambitieux fut alors mis sur pied. Il prévoyait, en particulier, l'exploration du continent austral. Les objectifs de l'A.G.I. furent largement atteints en 1958.
Amplifiés en 1959 par la Coopération géophysique internationale, ils furent donc pérennisés par la signature, le 1er décembre 1959 à Washington, d'un traité sur l'Antarctique, entré en vigueur le 23 juin 1961. Ce texte met en œuvre des idées déjà contenues dans une note du gouvernement des États-Unis en date du 2 mai 1958. Les négociations furent longues. Mais la détente entre l'Est et l'Ouest favorisa l'adoption de cette convention.
Celle-ci vise « la région située au sud du 60e degré de latitude sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires ». Elle fait de l'Antarctique le domaine réservé de ce qu'on a appelé une « aristocratie conventionnelle ». Cette dernière est formée de douze États signataires qui ont apporté une contribution effective à l'A.G.I. et qui, à des titres divers, avaient tous des prétentions sur la zone polaire sud. Sept ont fait valoir des droits territoriaux : un premier groupe composé de l'Australie, de la France, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni, un second groupe formé de l'Argentine et du Chili. À ceux-ci devaient s'ajouter, pour des raisons variées, cinq autres États (ceux de la deuxième vague) : d'une part les deux Grands, États-Unis et l'U.R.S.S., d'autre part la Belgique, le Japon et l'Afrique du Sud. Il était admis que d'autres États pourraient rejoindre les Douze.
Le régime juridique de l'Antarctique peut se résumer en deux formules : « gel » des revendications territoriales ; internationalisation fonctionnelle fondée sur une utilisation pacifique de ce territoire.
Gel des prétentions territoriales
Le désir d'appropriation de l'Antarctique n'est pas seulement motivé par des recherches désintéressées. Il s'explique aussi par des raisons économiques et stratégiques.
L'une des principales sources de richesses exploitées fut longtemps la chasse à la baleine, dans laquelle des capitaux considérables ont été investis. Certains savants sont aussi fascinés par les énormes réserves de minéraux que recélerait ce continent.
Des idées audacieuses ont également été émises. On a suggéré que l'excédent des récoltes mondiales soit stocké dans l'Antarctique. On a proposé que les courants aériens qui, tout au long de l'année, balaient ces zones glaciales soient captés et utilisés comme source d'énergie.
Ce continent présente, en outre, un intérêt stratégique. La terre de Graham n'est qu'à un millier de kilomètres du cap Horn. En cas de conflit mondial, ou s'il s'agissait de tracer de nouvelles routes commerciales, la maîtrise du détroit de Drake pourrait se révéler très utile.
Pour toutes ces raisons, force fut aux signataires du traité de Washington de tenir le plus grand compte des situations existantes. Ils décidèrent donc le maintien du statu quo en matière territoriale. En revanche ils spécifièrent qu'aucune prétention nouvelle ne saurait être acceptée après l'entrée en vigueur de la convention.
Ainsi – dans la phase initiale d'application du traité, tout au moins – le « gel » porte sur le contentieux, non sur les droits. Les revendications et[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre CARRIÈRE : agrégé de géographie, docteur d'État ès lettres
- Edmond JOUVE : professeur à la faculté de droit de l'université de Paris-V-René-Descartes, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer
- Jean JOUZEL : directeur de recherche au Commissariat à l'énergie atomique, directeur de l'institut Pierre-Simon-Laplace des sciences de l'environnement global, président du conseil d'administration de l'institut polaire français Paul-Émile-Victor
- Gérard JUGIE : directeur de recherche au C.N.R.S., directeur de l'Institut polaire français Paul-Émile-Victor (I.P.E.V.)
- Claude LORIUS : directeur de recherche émérite au C.N.R.S, laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement, Grenoble
Classification
Pour citer cet article
Pierre CARRIÈRE, Edmond JOUVE, Jean JOUZEL, Gérard JUGIE et Claude LORIUS. ANTARCTIQUE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
FORMATION DE LA CALOTTE ANTARCTIQUE
- Écrit par Vincent LEFEBVRE
- 733 mots
- 1 média
Au cours des temps géologiques, le continent Antarctique et sa calotte n'ont pas toujours été tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ce continent, bien que situé autour du pôle Sud depuis plus de 70 millions d'années (Ma), n'a pas toujours été recouvert de glace. L'âge...
-
AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie
- Écrit par Jean AUBOUIN, René BLANCHET, Jacques BOURGOIS, Jean-Louis MANSY, Bernard MERCIER DE LÉPINAY, Jean-François STEPHAN, Marc TARDY, Jean-Claude VICENTE
- 24 158 mots
- 23 médias
Vers le sud, l'Amérique du Sud est reliée au continent Antarctique par la cordillère de la Scotia qui, par les îles Géorgie du Sud, Sandwich du Sud, Orcades du Sud et Shetland du Sud, forme un cadre continental autour de la mer de la Scotia. Cette dernière comporte plusieurs bassins océaniques dont... -
AMUNDSEN ROALD (1872-1928)
- Écrit par Jean-Marcel CHAMPION
- 554 mots
- 2 médias
Explorateur norvégien. Fils d'un petit armateur, Roald Amundsen se destine d'abord à la médecine avant d'être saisi d'une vocation irrésistible pour l'exploration polaire. En 1893, il s'engage comme simple matelot sur un phoquier et, de 1897 à 1899, il participe à l'expédition ...
-
AUSTRALIE
- Écrit par Benoît ANTHEAUME, Jean BOISSIÈRE, Bastien BOSA, Vanessa CASTEJON, Universalis, Harold James FRITH, Yves FUCHS, Alain HUETZ DE LEMPS, Isabelle MERLE, Xavier PONS
- 27 355 mots
- 29 médias
...(celui de l'océan Indien, par exemple), dont l'accrétion est directement liée à l'« éclatement » du Gondwana. L'Inde s'est séparée de l'Australie et de l'Antarctique, encore joints, vers le début du Crétacé, il y a 130 millions d'années, et l'Antarctique s'est séparé de l'Australie vers la fin du... -
BARNOLA JEAN-MARC (1956-2009)
- Écrit par Universalis
- 208 mots
Le glaciologue Jean-Marc Barnola, né le 3 janvier 1956 à Bourg-en-Bresse (Ain), est décédé le 21 septembre 2009 à La Mure dans l'Isère. Aux côtés de Claude Lorius, de Jean Jouzel et de Dominique Raynaud, il a amplement contribué à l'essor de la glaciologie moderne et des implications...
- Afficher les 33 références
Voir aussi
- ÉCOULEMENT, hydrologie
- RELIEF TERRESTRE
- RAYONNEMENT SOLAIRE
- TEMPÉRATURE, météorologie et climatologie
- FROIDS CLIMATS
- GLACIATIONS QUATERNAIRES
- FAUNE
- AUSTRALES TERRES
- GLACIAIRE DOMAINE
- BOUVET JEAN-BAPTISTE DE LOZIER- (1705-1786)
- EXPLORATIONS ET EXPÉDITIONS POLAIRES
- PLATEAU CONTINENTAL
- PÔLE SUD
- ICEBERG
- ANNÉE GÉOPHYSIQUE INTERNATIONALE (AGI)
- CAROTTAGE
- FLORE
- INLANDSIS
- GLACIOLOGIE
- GERLACHE DE GOMERY ADRIEN DE (1866-1934)
- NORDENSKJÖLD OTTO (1869-1928)
- CATABATIQUES VENTS
- WASHINGTON TRAITÉ DE (1959)
- WEDDELL MER DE
- ROSS MER & BARRIÈRE DE
- VINSON MONT
- SHELFS, glaciologie
- OROGENÈSE
- GLACIAIRES ÉPOQUES
- CONTINENT
- MARINE HISTOIRE DE LA
- ROYAUME-UNI, histoire, de 1945 à nos jours
- EPICA (European Project of Ice Coring in Antarctica)
- LACS SOUS-GLACIAIRES
- CHANGEMENT CLIMATIQUE
- EXTINCTION ou DISPARITION DES ESPÈCES
- CLIMATIQUES VARIATIONS
- MONTRÉAL PROTOCOLE DE (1987)
- COOPÉRATION INTERNATIONALE
- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1945 à nos jours
- BALEINE
- PALÉOTEMPÉRATURE
- THERMOPHILES
- FRANCE, histoire, de 1939 à 1958
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours
- URSS, histoire
- EXPLORATIONS ET EXPÉDITIONS SCIENTIFIQUES
- AQUATIQUE VIE
- CALOTTE GLACIAIRE
- TRANSPORT & TRAFIC AÉRIENS
- KRILL
- CHLOROFLUOROCARBURES (CFC)
- CARBONIQUE GAZ ou DIOXYDE DE CARBONE
- PROTECTION ou CONSERVATION DES ESPÈCES