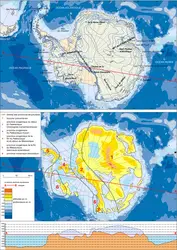ANTARCTIQUE
Découverte et conquête
Les expéditions individuelles
Une vieille tradition, héritée des Grecs, voulait que le district polaire austral fût occupé par un vaste continent, dont Magellan, lors de son voyage autour du monde, pensait avoir vu l'extrême avancée en doublant la Terre de Feu. On vécut longtemps sur cette erreur, sans que ce continent mythique ait attiré beaucoup de curiosité. La première expédition officielle pour la recherche de la « Terre australe » est celle du Français Bouvet qui, en 1739, découvre l'île qui porte son nom depuis lors, et dont on se désintéresse aussitôt. Au cours de la seconde expédition, en 1772-1775, Cook découvre les îles Sandwich du Sud, franchit le cercle polaire en trois points et atteint la latitude record de 710 10′, sans rencontrer le continent.
Ce sont ensuite les chasseurs de phoques et de baleines qui s'aventurent dans les eaux australes, à la recherche des littoraux où s'assemblent ces animaux. Leurs découvertes, d'abord tenues secrètes, finissent par s'ébruiter. L'Anglais William Smith annonce, en 1819, la découverte des îles Shetland du Sud, et son compatriote Bransfield voit, en janvier 1820, une terre qui est, peut-être, l'extrémité de la péninsule Antarctique, aperçue une deuxième fois, en novembre 1820, par l'Américain Palmer. Entre-temps, Lazarev, second de Bellingshausen qui dirige la première expédition russe dans les eaux australes, consigne sur sa carte de navigation avoir aperçu, le 27 janvier 1820, des glaces s'élevant à perte de vue devant son navire, en direction du sud. Bellingshausen aborde ensuite à l'île Pierre Ier, le 9 janvier 1821, puis, huit jours plus tard, à la terre Alexandre, qui est en réalité une île. Le 7 février 1821, les marins de l'Américain Davis débarquent, pour la première fois, sur le continent. Les îles Orcades du Sud sont découvertes, conjointement, par le Britannique Powel et l'Américain Palmer, le 6 décembre 1821, tandis qu'en 1823 l'Anglais Weddell pénètre dans la mer qui porte son nom et bat le record de latitude sud avec 740 15′. En 1830, John Biscoe, opérant pour le compte des frères Enderby, découvre un secteur continental que l'on nomme terre d'Enderby.
L'intérêt scientifique prend le pas sur les préoccupations économiques ou territoriales, et l'étude du magnétisme austral attire dans l'Antarctique, de 1838 à 1843, neuf navires appartenant à trois expéditions différentes. L'expédition française (1838-1840), conduite par Dumont d'Urville, découvre, en Antarctide orientale, la terre Louis-Philippe, l'île Joinville et la terre Adélie. Sous la direction de Wilkes, l'expédition américaine (1839-1842), plus puissante mais mal organisée, reconnaît la portion du littoral de l'Antarctide orientale située au long de la terre dite, dès lors, de Wilkes. Le chef de l'expédition anglaise, James Ross, découvre, dans la mer à laquelle son nom est attaché, l'extraordinaire barrière de glace qu'il suit sur plus de 600 km, atteignant 780 sud. Il baptise au passage du nom de ses navires les deux volcans Erebus et Terror, et consacre à la reine Victoria la terre qui borde la mer nouvellement découverte.
Après une interruption d'un demi-siècle commence l'exploration du continent dont les expéditions marines antérieures ont fixé les contours. Les techniques ont progressé, et le Belge Adrien de Gerlache réussit avec son bateau le premier hivernage dans les glaces de la péninsule antarctique. L'année suivante, le Norvégien Borchgrevink dirige le premier hivernage à terre et fait usage de traîneaux, attelés à des chiens de Sibérie et du Groenland. Sur proposition des délégués allemands au Congrès de géographie de Berlin, une campagne de recherche internationale est entreprise dans l'Antarctique,[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre CARRIÈRE : agrégé de géographie, docteur d'État ès lettres
- Edmond JOUVE : professeur à la faculté de droit de l'université de Paris-V-René-Descartes, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer
- Jean JOUZEL : directeur de recherche au Commissariat à l'énergie atomique, directeur de l'institut Pierre-Simon-Laplace des sciences de l'environnement global, président du conseil d'administration de l'institut polaire français Paul-Émile-Victor
- Gérard JUGIE : directeur de recherche au C.N.R.S., directeur de l'Institut polaire français Paul-Émile-Victor (I.P.E.V.)
- Claude LORIUS : directeur de recherche émérite au C.N.R.S, laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement, Grenoble
Classification
Pour citer cet article
Pierre CARRIÈRE, Edmond JOUVE, Jean JOUZEL, Gérard JUGIE et Claude LORIUS. ANTARCTIQUE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
FORMATION DE LA CALOTTE ANTARCTIQUE
- Écrit par Vincent LEFEBVRE
- 733 mots
- 1 média
Au cours des temps géologiques, le continent Antarctique et sa calotte n'ont pas toujours été tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ce continent, bien que situé autour du pôle Sud depuis plus de 70 millions d'années (Ma), n'a pas toujours été recouvert de glace. L'âge...
-
AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie
- Écrit par Jean AUBOUIN, René BLANCHET, Jacques BOURGOIS, Jean-Louis MANSY, Bernard MERCIER DE LÉPINAY, Jean-François STEPHAN, Marc TARDY, Jean-Claude VICENTE
- 24 158 mots
- 23 médias
Vers le sud, l'Amérique du Sud est reliée au continent Antarctique par la cordillère de la Scotia qui, par les îles Géorgie du Sud, Sandwich du Sud, Orcades du Sud et Shetland du Sud, forme un cadre continental autour de la mer de la Scotia. Cette dernière comporte plusieurs bassins océaniques dont... -
AMUNDSEN ROALD (1872-1928)
- Écrit par Jean-Marcel CHAMPION
- 554 mots
- 2 médias
Explorateur norvégien. Fils d'un petit armateur, Roald Amundsen se destine d'abord à la médecine avant d'être saisi d'une vocation irrésistible pour l'exploration polaire. En 1893, il s'engage comme simple matelot sur un phoquier et, de 1897 à 1899, il participe à l'expédition ...
-
AUSTRALIE
- Écrit par Benoît ANTHEAUME, Jean BOISSIÈRE, Bastien BOSA, Vanessa CASTEJON, Universalis, Harold James FRITH, Yves FUCHS, Alain HUETZ DE LEMPS, Isabelle MERLE, Xavier PONS
- 27 355 mots
- 29 médias
...(celui de l'océan Indien, par exemple), dont l'accrétion est directement liée à l'« éclatement » du Gondwana. L'Inde s'est séparée de l'Australie et de l'Antarctique, encore joints, vers le début du Crétacé, il y a 130 millions d'années, et l'Antarctique s'est séparé de l'Australie vers la fin du... -
BARNOLA JEAN-MARC (1956-2009)
- Écrit par Universalis
- 208 mots
Le glaciologue Jean-Marc Barnola, né le 3 janvier 1956 à Bourg-en-Bresse (Ain), est décédé le 21 septembre 2009 à La Mure dans l'Isère. Aux côtés de Claude Lorius, de Jean Jouzel et de Dominique Raynaud, il a amplement contribué à l'essor de la glaciologie moderne et des implications...
- Afficher les 33 références
Voir aussi
- ÉCOULEMENT, hydrologie
- RELIEF TERRESTRE
- RAYONNEMENT SOLAIRE
- TEMPÉRATURE, météorologie et climatologie
- FROIDS CLIMATS
- GLACIATIONS QUATERNAIRES
- FAUNE
- AUSTRALES TERRES
- GLACIAIRE DOMAINE
- BOUVET JEAN-BAPTISTE DE LOZIER- (1705-1786)
- EXPLORATIONS ET EXPÉDITIONS POLAIRES
- PLATEAU CONTINENTAL
- PÔLE SUD
- ICEBERG
- ANNÉE GÉOPHYSIQUE INTERNATIONALE (AGI)
- CAROTTAGE
- FLORE
- INLANDSIS
- GLACIOLOGIE
- GERLACHE DE GOMERY ADRIEN DE (1866-1934)
- NORDENSKJÖLD OTTO (1869-1928)
- CATABATIQUES VENTS
- WASHINGTON TRAITÉ DE (1959)
- WEDDELL MER DE
- ROSS MER & BARRIÈRE DE
- VINSON MONT
- SHELFS, glaciologie
- OROGENÈSE
- GLACIAIRES ÉPOQUES
- CONTINENT
- MARINE HISTOIRE DE LA
- ROYAUME-UNI, histoire, de 1945 à nos jours
- EPICA (European Project of Ice Coring in Antarctica)
- LACS SOUS-GLACIAIRES
- CHANGEMENT CLIMATIQUE
- EXTINCTION ou DISPARITION DES ESPÈCES
- CLIMATIQUES VARIATIONS
- MONTRÉAL PROTOCOLE DE (1987)
- COOPÉRATION INTERNATIONALE
- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1945 à nos jours
- BALEINE
- PALÉOTEMPÉRATURE
- THERMOPHILES
- FRANCE, histoire, de 1939 à 1958
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours
- URSS, histoire
- EXPLORATIONS ET EXPÉDITIONS SCIENTIFIQUES
- AQUATIQUE VIE
- CALOTTE GLACIAIRE
- TRANSPORT & TRAFIC AÉRIENS
- KRILL
- CHLOROFLUOROCARBURES (CFC)
- CARBONIQUE GAZ ou DIOXYDE DE CARBONE
- PROTECTION ou CONSERVATION DES ESPÈCES