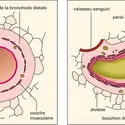ALLERGIE & HYPERSENSIBILITÉ
- 1. Définition et cadre de l'allergie
- 2. Les allergènes
- 3. L'induction de la réaction allergique
- 4. Classification des réactions allergiques
- 5. Syndromes allergiques expérimentaux
- 6. Mécanismes cellulaires et moléculaires des réactions allergiques
- 7. Les syndromes allergiques cliniques
- 8. Bibliographie
La notion d'allergie a trait au phénomène paradoxal de la nocivité de certaines réactions immunitaires. La paternité de ce concept (apparu en 1906) revient au médecin viennois Clemens von Pirquet. Il cherchait notamment à expliquer par cette « réactivité altérée » (traduction des termes grecs réunis dans le mot allergie) les aléas d'une immuno-thérapie, alors à ses débuts.
À Paris, Émile Roux, disciple de Louis Pasteur, avait réussi, en 1894, à vacciner des chevaux contre le bacille diphtérique, afin de pouvoir extraire de leur sang un sérum antidiphtérique renfermant des substances défensives agissant contre ce microbe chez les sujets qu'il infectait.
Cependant, la fiabilité de cette sérothérapie devait être préalablement évaluée afin d'assurer la réussite du traitement. C'est à Paul Ehrlich qui, à l'Institut d'évaluation des sérums, à Francfort, établit quelques années plus tard les principes permettant de doser l'efficacité de la réaction de défense assurée par des « anticorps » du sérum – spécifiquement protecteur – vis-à-vis des « antigènes » microbiens.
Il devenait donc possible d'éviter les aléas de la sérothérapie. Néanmoins, on constata que tout n'était pas réglé : des accidents (maladie du sérum) restaient imprévisibles. La réactivité des personnes traitées restait donc un élément capital du succès thérapeutique. Or Charles Richet et Paul Portier avaient déjà montré, dès le début du xxe siècle, que la non-réactivité pouvait avoir des effets mortels (phénomène d'anaphylaxie ou « réactivité insuffisante »).
Il était donc indispensable que les recherches en allergologie, c'est-à-dire sur les altérations de la réactivité, fussent associées au développement des vaccins et des sérums qui devait marquer la première moitié du xxe siècle. Elles ont investi notamment toute une panoplie de réactions d'hypersensibilité affectant certains sujets mis en contact de facteurs environnementaux normalement inoffensifs pour la plupart des gens. Pour des raisons assez mystérieuses (on invoque entre autres l'artificialisation progressive de l'environnement), on a assisté au cours du xxe siècle à une progression considérable du nombre de personnes allergiques dans la population des pays développés, mais aussi dans le monde entier. Le phénomène allergique a ainsi cessé d'être limité à l'échelle individuelle (pour ainsi dire comportementale) pour atteindre la dimension d'une question majeure de santé publique malgré la récente mise en pratique du principe de précaution en matière de sécurité des aliments (étiquetage) et malgré l'entrée en jeu d'un important arsenal thérapeutique (antihistaminique, anti-inflammatoires).
Définition et cadre de l'allergie
Il serait malaisé de définir le concept d'allergie de manière concise sans aboutir à des propositions tronquées ou distorses. Le mot allergie couvre une série d'entités biologiques et pathologiques ayant des aspects différents, mais reliées par le même mécanisme fondamental, de nature immunologique.
L' allergie apparaît comme un état biologique particulier qui se traduit par une réponse altérée de l'organisme vis-à-vis de substances normalement tolérées. C'est pour exprimer ce concept de réactivité altérée que Clement von Pirquet a proposé, en 1906, le terme « allergie ».
Il existe en effet un certain nombre de faits expérimentaux et cliniques qui, bien qu'ils appartiennent au domaine de l'immunologie, ne s'accordent pas aisément avec son cadre. Ces faits concernent essentiellement les phénomènes d'hypersensibilité survenant au cours de l'immunisation.
En voici quelques exemples :
Un cobaye sain supporte sans inconvénient l'injection de 2 ml de vieille tuberculine de Koch, alors[...]
- 1. Définition et cadre de l'allergie
- 2. Les allergènes
- 3. L'induction de la réaction allergique
- 4. Classification des réactions allergiques
- 5. Syndromes allergiques expérimentaux
- 6. Mécanismes cellulaires et moléculaires des réactions allergiques
- 7. Les syndromes allergiques cliniques
- 8. Bibliographie
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Bernard HALPERN : membre de l'Institut, professeur au Collège de France, directeur de l'Institut d'immunologie
- Georges HALPERN
: docteur en médecine,
adjunct professor of medicine ,division of rheumatology-allergy , University of California, Davis. - Salah MECHERI : docteur vétérinaire, chef de laboratoire
- Jean-Pierre REVILLARD : professeur d'immunologie à l'université de Lyon-I-Claude-Bernard
Classification
Pour citer cet article
Bernard HALPERN, Georges HALPERN, Salah MECHERI et Jean-Pierre REVILLARD. ALLERGIE & HYPERSENSIBILITÉ [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
ACARIENS
- Écrit par Jean-Louis CONNAT, Gabriel GACHELIN
- 6 631 mots
- 2 médias
...le plus souvent du genre Dermatophagoïdes – qui vivent dans la poussière, la literie, etc., et se nourrissent de débris tégumentaires humains. Ils sont responsables d'une pluralité de phénomènes allergiques de gravité variable, qui sont liés à leurs déjections ou à des composants de leur cuticule.... -
ALIMENTATION (Aliments) - Risques alimentaires
- Écrit par Jean-Pierre RUASSE
- 4 757 mots
- 1 média
D'autrepart, les observations s'accumulent d'accidents allergiques liés à la présence d'antibiotiques dans les aliments d'origine animale. La question n'est pas résolue par le fait de ne pas déceler, à l'analyse, de résidus actifs, car les résidus métaboliques, dénués de pouvoir antibiotique, peuvent... -
ANESTHÉSIE
- Écrit par Francis BONNET, François CHAST
- 4 117 mots
- 2 médias
...par l'étude de critères anatomiques lors de la consultation préanesthésique. Cette consultation permet de choisir les techniques d'intubation adaptées. Le risque allergique, en partie imprévisible, est cependant augmenté quand le patient présente certains antécédents : la consultation préanesthésique permet... -
ASTHME
- Écrit par Philippe GODARD, François-Bernard MICHEL
- 5 857 mots
- 2 médias
...à l'asthme, connue depuis l'Antiquité, puisqu'il existe des familles d'asthmatiques, fournissant à cette maladie un « terrain » favorable ou atopie. L'atopie est en effet l'aptitude d'un organisme à réagir aux allergènes contenus dans l'air de l'environnement par une production spontanée d'immunoglobulines... - Afficher les 31 références
Voir aussi
- INTERFÉRON
- MICRO-ORGANISME
- LANGERHANS CELLULE DE
- TERRAIN, médecine
- ALLERGÈNE
- POLYNUCLÉAIRES BASOPHILES
- INTRADERMO-RÉACTION
- ATOPIE
- CHIMIOKINES ou CHÉMOKINES
- COMPLÉMENT, immunologie
- PEAU MALADIES DE LA ou DERMATOSES
- INFECTION
- MÉDIATEURS BIOCHIMIQUES
- HISTOLOGIE PATHOLOGIQUE
- FREUND ADJUVANT DE
- TUBERCULINE
- AUTO-IMMUNITAIRES MALADIES ou AUTO-IMMUNES MALADIES
- BASEDOW MALADIE DE
- ANTICORPS
- RESPIRATOIRE PATHOLOGIE
- HAPTÈNE
- ANAPHYLAXIE
- ARTHUS PHÉNOMÈNE D'
- ANTIANAPHYLAXIE
- BESREDKA ALEXANDRE (1870-1940)
- CORYZA SPASMODIQUE
- TOLÉRANCE IMMUNITAIRE
- IMMUNOGLOBULINES
- IMMUN-SÉRUM ou ANTISÉRUM
- LYMPHOCYTES
- MASTOCYTE
- PORTIER PAUL (1866-1962)
- SCHULTZ-DALE PHÉNOMÈNE DE
- RÉAGINE
- QUINCKE ŒDÈME DE
- SÉRIQUE MALADIE
- RÉACTION IMMUNITAIRE
- ÉPITOPES ou DÉTERMINANTS ANTIGÉNIQUES
- IMMUNOGÉNICITÉ
- PRÉSENTATION DE L'ANTIGÈNE
- PROSTACYCLINE
- ENDOTHÉLIUM VASCULAIRE
- LYMPHOKINES
- CYTOLYSE
- RECONNAISSANCE, immunologie
- GERMES, biologie
- CYTOTOXICITÉ
- INTERLEUKINES
- CYTOKINES
- IMMUNISATION
- COMPLEXE IMMUN
- CHOC ANAPHYLACTIQUE
- LYMPHOCYTES B
- LYMPHOCYTES T
- IgG
- IgA
- IgE
- DERMATITE DE CONTACT ou DERMITE DE CONTACT
- MONOKINES
- RÉCEPTEUR, biochimie
- ADJUVANTS, biologie et médecine