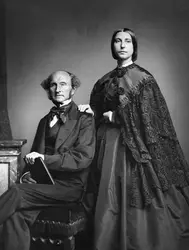PROGRÈS
Le problème de la croissance des connaissances
Il est aujourd'hui entendu qu'on ne peut plus soutenir, comme Turgot au xviiie siècle, que « tout sort de la marche générale de l'esprit ». L'humanité a commencé par les pieds. « La pensée, écrit André Leroi-Gourhan, n'a pas fracassé les cloisons anatomiques pour se construire un cerveau. » Mais pouvait-on facilement admettre que le silex ait pu être taillé par quelque demi-singe ? Même Rousseau, dans sa quête du degré zéro de la culture, souscrit entièrement à la théorie cérébraliste de l'évolution humaine. On ne peut plus également dire avec l'abbé Terrasson, l'auteur de La Philosophie applicable à tous les objets de la raison (1754), que, d'une manière générale, l'homme acquiert toujours au lieu de perdre. Le devenir, en fait, est jalonné de pertes. On ne peut accéder à un stade donné du développement qu'à la condition de renoncer aux bénéfices qui s'attachaient au précédent. La théorie psychanalytique, qui constitue l'espace de la culture de substituts à des jouissances perdues, peut ici se soutenir de l'anthropologie préhistorique mise en place dans Le Geste et la Parole : la société seule profite du progrès. Dans tous les domaines, l'organisme social s'est substitué à l'espèce zoologique, et l'ordre ethnique à l'ordre génétique. De telle sorte que l'homme zoologique n'est plus qu'une cellule dépersonnalisée dans un organisme planétaire. Cournot, en recourant à d'autres métaphores, l'avait déjà prédit.
Si, enfin, le xviiie siècle a clairement aperçu que le progrès est fonction d'une diversification du corps social – l'injustice étant l'image négative du triomphe sur le milieu naturel –, l'ethnologie contemporaine a fait une place majeure, à côté du progrès par différenciation interne, aux changements provoqués par l'introduction de partenaires extérieurs. Lié à la division du travail par Adam Smith, à la propriété, preuve d'avancement dans l'histoire de la société (matter of progress), par Adam Ferguson, le progrès économique est bien, pour Rousseau, à l'origine de la séparation des consciences et des difficultés sociales. Mais l'analyse structurale a remplacé par une corrélation fonctionnelle la relation de causalité que la pensée des Lumières avait introduite entre les transformations techniques et les transformations sociales.
Le problème demeure, cependant, du progrès scientifique, de l'accroissement des connaissances, du passage d'un paradigme du savoir à un autre. Sans doute, l'économie du progrès doit-elle, dans son ensemble, être finalement rapportée à la succession des systèmes d'explication du monde. L'introduction du langage quantitatif, à laquelle Cassirer assimile le progrès, a déterminé le remplacement de la description des choses par l'expression générale des relations. De l'appréhension immédiate à la construction de concepts par postulation, la distance est celle qui sépare la pensée mythique de la pensée scientifique. Il reste que l'histoire des sciences sert d'appui à Popper pour rejeter comme logiquement contradictoires toutes lois du progrès.
Le développement de la science n'est pas dû, en effet, à l'accumulation progressive de nos expériences. Après l'âge classique, qui a cru au « pas décisif » et cédé à l'illusion de l'« homme accompli », les philosophes des Lumières ont imaginé, à tort, le progrès scientifique sur le mode d'une accumulation continue. Beaucoup d'entre eux en ont attendu une mutation qualitative de l'esprit. Mais peut-on affirmer penser mieux que Platon ? Le progrès intellectuel porte essentiellement sur l'élargissement des moyens et des champs de spéculations. Or, l'histoire des sciences fait justice du mythe[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Bernard VALADE
: professeur à l'université de Paris-V-Sorbonne, secrétaire général de
L'Année sociologique
Classification
Pour citer cet article
Bernard VALADE. PROGRÈS [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
ANCIENS ET MODERNES
- Écrit par Milovan STANIC, François TRÉMOLIÈRES
- 5 024 mots
- 4 médias
...Pourtant, l'assimilation du modèle antique comme forme et comme règle, qui est l'un des fondements de la pensée renaissante, n'excluait pas une certaine idée du progrès, voire celle d'un dépassement possible des modèles, au point que même ceux qui ne doutaient pas de la prééminence des artistes antiques... -
BACON chancelier FRANCIS (1560 ou 1561-1626)
- Écrit par Michèle LE DŒUFF
- 2 170 mots
- 1 média
Né à Londres dans une famille qui a déjà fourni à la Couronne anglaise quelques grands serviteurs mais qui n'appartient pas à la noblesse terrienne, Bacon fut élève de Trinity College (Cambridge) et étudia le droit à Gray's Inn (Londres). Il séjourna en France de 1576 à 1578 (ou 1579) auprès de l'ambassadeur...
-
CIVILISATION
- Écrit par Jean CAZENEUVE
- 7 138 mots
- 1 média
Lorsqu'on fait de la civilisation la marque d'un certain degré du progrès de l'humanité, il faut pouvoir dire à quoi l'on reconnaît qu'un peuple ou une société est rangé parmi les civilisés ou les non-civilisés. Cette démarche n'est pas seulement l'inverse de celle qui consiste à définir les sociétés... -
COLONISATION, notion de
- Écrit par Myriam COTTIAS
- 1 618 mots
On ne saurait cependant associer le siècle des Lumières à l'établissement d'un anticolonialisme radical. Bien au contraire, au nom de la raison universelle, qui permet d'accéder en même temps à la vérité et au bonheur, les philosophes construisent un paradigme européocentrique du progrès... - Afficher les 49 références
Voir aussi