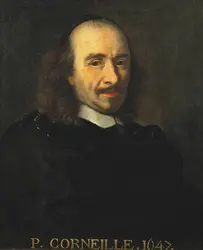CORNEILLE PIERRE (1606-1684)
Corneille et le genre tragique
Corneille était certainement convaincu de l'excellence de la tragédie régulière ; son théâtre a marqué un moment dans le triomphe progressif des règles. On n'en trouve pas moins chez lui, de façon latente, une résistance à la régularisation du poème tragique. Il hésitait, à ses débuts, entre le goût moderne et la discipline des doctes. Le Cid est une tragi-comédie médiocrement régulière ; mais, même dans ses tragédies les plus achevées, Cinna, Polyeucte, les critiques ont constaté une imparfaite conformité aux préceptes des théoriciens. Un des plus en vue parmi ces théoriciens, l'abbé d'Aubignac, avait déjà publié, en 1657, sa Pratique du théâtre, quand Corneille fit paraître, en 1660, ses trois discours : De l'utilité et des parties du poème dramatique ; De la tragédie et des moyens de la traiter selon le vraisemblable et le nécessaire ; Des trois unités. Sans contredire dans leur ensemble les vues d'Aristote, telles que les interprétaient ses commentateurs modernes, il les discute plus d'une fois, en homme qui a peine à concilier son génie propre avec les doctrines officielles. Ainsi, il soutient que la fin première du poème dramatique est le plaisir, se donnant par là le droit d'inventer et de créer hors de l'emprise des règles. Cette affirmation, qui revient plus d'une fois dans ses écrits, est bien naturelle chez un auteur ; Racine, plus régulier que lui, et, dans un autre domaine, Molière diront la même chose. En art, l'effet importe évidemment plus que le précepte ; les écrivains, en acceptant la loi des doctes, ont toujours réservé leur privilège de créateurs. Mais, plus précisément, Corneille est grand expérimentateur de formes dramatiques. Outre l'originalité, constamment renouvelée, de ses créations dans la comédie, la tragi-comédie et la tragédie pure, il a écrit des « comédies héroïques », qui annoncent le drame moderne, comme Don Sanche et Pulchérie, des pièces à machines, qui annoncent l'opéra, comme Andromède et La Toison d'or. Aussi perçoit-il une contradiction entre son instinct d'inventeur et une poétique toute faite.
Il est significatif qu'il refuse d'interpréter comme la majorité de ses contemporains le précepte d'Aristote selon lequel la tragédie est la représentation du possible. Les théoriciens entendent par « possible » ce qui est conforme au train ordinaire des choses, le vraisemblable. Corneille entend par là tout ce qui n'est pas impossible, même si c'est extraordinaire. Les grands sujets, selon lui, « doivent toujours aller au-delà du vraisemblable » ; il suffit que l'histoire ou la légende les accrédite. Tels sont, parmi d'autres, les sujets du Cid, d'Horace, de Rodogune. De même, l'opinion d'Aristote qui veut que le personnage tragique ne soit ni tout à fait bon ni tout à fait méchant, et tombe par quelque faiblesse dans un malheur digne de commisération, ne convient guère à Corneille, peintre des grandes vertus et des grands crimes : aussi la critique-t-il longuement. Dans l'ensemble, les Discours et les Examens donnent l'impression d'une opposition sourde aux préceptes. La soumission timide et parfois scrupuleuse de Corneille laisse percer sans cesse des contestations et chicanes diverses, qui trahissent des objections de fond.
La tragédie cornélienne est faite pour exalter, non pour apitoyer ou terrifier. Contrairement à la tragédie antique, elle est, par essence, optimiste. La vie des personnages et leur bonheur sont en péril, mais ce que la tragédie enseigne, ce n'est pas la toute-puissance du malheur ou la débilité de la condition humaine, c'est, au contraire, la grandeur de l'homme, sa capacité de vaincre le destin. Elle fait agir, non la pitié et la terreur, suivant la formule aristotélicienne, mais l'admiration.[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Paul BÉNICHOU : ancien élève de l'École normale supérieure, professeur honoraire de littérature française à l'université Harvard
Classification
Pour citer cet article
Paul BÉNICHOU. CORNEILLE PIERRE (1606-1684) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Média
Autres références
-
LE CID, Pierre Corneille - Fiche de lecture
- Écrit par Christian BIET
- 1 276 mots
- 1 média
D'abord joué en janvier 1637 sous la bannière de la tragi-comédie, Le Cid de Pierre Corneille (1606-1684) connaît immédiatement un grand succès au théâtre du Marais. La « Querelle du Cid » s'ouvre quelques semaines après la première représentation, en avril 1637, avec les ...
-
CINNA, Pierre Corneille - Fiche de lecture
- Écrit par Christian BIET
- 1 072 mots
Après la querelle du Cid (1637) et un silence de trois années, Corneille (1606-1684) composa coup sur coup Horace et Cinna (dont les premières représentations eurent lieu en 1640 ou 1641), deux pièces romaines à fin heureuse. Il ne fit éditer Cinna qu'en 1642, pour éviter qu'elle ne tombe trop...
-
HORACE, Pierre Corneille - Fiche de lecture
- Écrit par Christian BIET
- 1 197 mots
On a coutume de lire Horace (joué en 1640 au théâtre du Marais, publié en 1641) et Cinna (probablement jouée en 1641 au théâtre du Marais, et publiée en 1643) comme des tragédies idéalisantes où se met en place un équilibre dramaturgique. L'ambition y est guidée par la volonté dans une voie vertueuse,...
-
L'ILLUSION COMIQUE, Pierre Corneille - Fiche de lecture
- Écrit par Christian BIET
- 1 516 mots
Comment défendre le théâtre et les comédiens au moyen du théâtre ? Comment, lorsqu'on est Pierre Corneille (1606-1684), poète dramatique de bientôt trente ans, déjà assez connu à Paris, auteur d'une tragi-comédie (Clitandre, 1631), de quatre comédies (Mélite, 1629-1630 ;...
-
POLYEUCTE MARTYR, Pierre Corneille - Fiche de lecture
- Écrit par Christian BIET
- 1 343 mots
Créé au théâtre du Marais en 1643, Polyeucte martyr est la première tragédie chrétienne de Pierre Corneille (1606-1684). Suivra Théodore, vierge et martyre, la seconde et dernière, en 1646. Le genre de la tragédie de saints et de martyrs, dans les années 1640, donne lieu à de nombreuses réalisations...
-
SURÉNA, Pierre Corneille - Fiche de lecture
- Écrit par Christian BIET
- 1 060 mots
Dernière tragédie de Corneille (1606-1684), Suréna (1674) ne connut pas le succès à son époque : on ne voulut pas l'entendre et l'on croyait l'auteur trop vieux et dépassé. Pourtant, cette tragédie, longtemps oubliée, passe depuis peu pour un chef-d'œuvre.
-
TROIS DISCOURS SUR LE POÈME DRAMATIQUE, Pierre Corneille - Fiche de lecture
- Écrit par Christian BIET
- 1 719 mots
Pierre Corneille (1606-1684) est peut-être le premier, en France, à se distinguer clairement de l'auteur employé-au-texte comme de l'auteur chef de troupe : il devient en effet l'« auteur dramatique » et, pour ce faire, établit sa légitimité sur plusieurs fronts. Pour s'affranchir du pouvoir...
-
AUBIGNAC FRANÇOIS HÉDELIN abbé d' (1604-1676)
- Écrit par Bernard CROQUETTE
- 698 mots
L'un de ces abbés qui tiennent tant de place dans l'histoire de la littérature — et des théories littéraires — au xviie siècle. Il a été prédicateur, romancier, dramaturge, poète, mais il a surtout voulu être, quant à lui, le législateur du théâtre. En 1640, une querelle l'oppose...
-
GENRES DRAMATIQUES
- Écrit par Elsa MARPEAU
- 1 606 mots
...à définir la tragédie, ils laissent partiellement dans l'ombre sa sœur comique. Aussi faut-il souvent la déduire par une opposition des deux genres. La tragédie présente ainsi un « péril de vie » et exige « quelque grand intérêt d'État ou quelque passion plus noble et plus mâle que l'amour » (Pierre... -
CID LE
- Écrit par Charles Vincent AUBRUN
- 2 823 mots
...Les Exploits du Cid. Les Jeunesses organisent dramatiquement un conflit entre l'amour et l'honneur chez Rodrigue aussi bien que chez Chimène. Corneille, peu de temps après, lisait la pièce et la refaisait. Éliminant les épisodes romanesques tels que la prophétie du lépreux et l'ordalie, il donne... -
CLÉMENCE, littérature
- Écrit par Jean MASSIN
- 700 mots
Décidant en dernier recours du sort d'un condamné, le prince a toujours la partie belle ; s'il laisse faire son office au bourreau, on s'incline devant sa justice et on célèbre son obéissance, peut-être douloureuse, au devoir et à la raison d'État ; s'il fait grâce, on soupçonne parfois avec admiration...
- Afficher les 19 références
Voir aussi