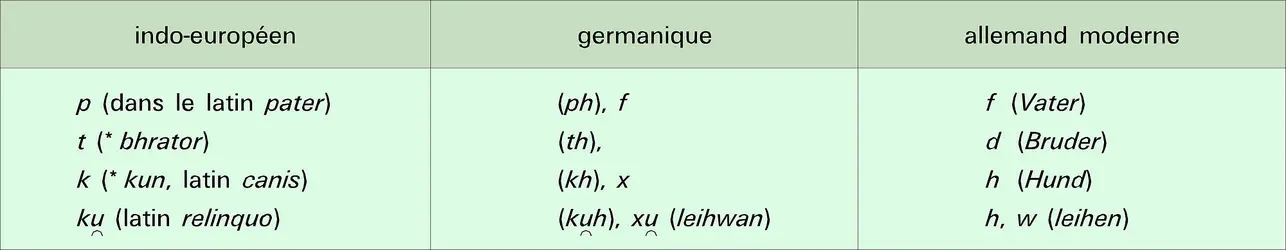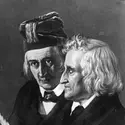GRIMM JAKOB (1785-1863) et WILHELM (1786-1859)
Il est sans doute peu d'œuvres qui aient connu à l'égal des Contesdes frères Grimm une telle fortune auprès des lecteurs de tout âge et de toutes les couches sociales. Ce succès durable est à la fois mérité et injuste : il rend certes hommage au génie littéraire des deux frères, mais il étouffe leurs personnalités réciproques en les confondant dans une même gloire ; il les sacre grands écrivains modernes, mais fait oublier qu'ils sont, surtout l'aîné, les fondateurs de la germanistique. Il n'est pas un enfant qui ignore leurs contes, mais il est bien peu d'adultes qui comprennent ce que fut l'admirable travail de Jakob et Wilhelm, qui sont d'abord de grands écrivains romantiques.
Élaboration des « Contes »
Les frères Grimm naquirent à Hanau, Jakob en 1785, Wilhelm en 1786, et tous deux moururent à Berlin, le cadet en 1859, Jakob en 1863. Au cours de leurs études de droit, ils furent disciples du célèbre juriste Friedrich von Savigny.
L'aîné connut une carrière brillante : bibliothécaire du roi de Westphalie, professeur d'histoire médiévale à l'université de Göttingen – dont il fut renvoyé à cause de ses idées politiques –, membre du Parlement de Francfort ; le cadet ne fut que sous-bibliothécaire, avant de professer également à l'université de Göttingen.
Mais l'œuvre des deux frères – qu'il s'agisse des Contes ou de leur travail scientifique – est née tout entière de leur profonde intimité, d'une communauté de sentiments et d'intérêts intellectuels qui les unit jusqu'au bout. Leur gloire montante éclipsa bientôt le talent de graveur et de dessinateur de Ludwig, le troisième des frères Grimm, dont les Mémoires sont pleins d'intérêt.
Les frères Grimm ne voulaient pas faire œuvre véritablement créatrice en éditant leurs contes, mais seulement sauver, pendant qu'il en était temps encore, les grands témoignages du sentiment populaire poétique en Allemagne. Cette intention n'était pas très originale au moment de leur première édition. Ils avaient eu pour précurseurs de nombreux romantiques, dont Ludwig Tieck, les deux frères Schlegel, Joseph von Görres. Dans une intention analogue, mais en se permettant de remanier les textes (comme l'avait fait autrefois le jeune Goethe sous l'influence de Herder), Achim von Arnim et Clemens Brentano venaient d'éditer leur recueil de Volkslieder (chants populaires), Le Cor merveilleux(Des Knaben Wunderhorn, 1806-1808), auquel Jakob et Wilhelm avaient d'ailleurs collaboré. Les deux frères avaient travaillé ensemble à des problèmes de littérature médiévale (le premier livre de Jakob, Über den altdeutschen Meistergesang, 1811, était consacré à la poésie allemande de troubadours). Wilhelm se préoccupait de poésie médiévale scandinave qu'il traduisait, commentait et éditait. Ils avaient traduit le poème épique de l'Edda et participaient passionnément aux discussions théoriques sur la Naturpoesie (poésie naturelle, c'est-à-dire populaire) et la Kunstpoesie (poésie d'art, c'est-à-dire moderne et recréée). Cependant la gloire leur vint d'une manière un peu inattendue en 1812, quand ils éditèrent leur premier recueil de contes. Ils avaient commencé à rassembler les contes vers 1806 sans intentions précises. Persuadés de l'inspiration divine de toute « poésie naturelle », ils se refusaient à toute modification du contenu et reprochaient à leurs prédécesseurs de n'avoir pas respecté intégralement cette révélation de l'« âme du peuple ». Au contraire, les frères Grimm voulurent être aussi complets et fidèles que possible. Ils recherchèrent des informateurs dans toute l'Allemagne. En ce qui concerne la forme des contes, l'attitude des auteurs n'avait rien de rigide, seul le contenu étant à leurs yeux intangible. Par contre, la composition et le style étaient leur[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Michel-François DEMET : maître de conférences agrégé à l'université de Paris-IV-Sorbonne
Classification
Pour citer cet article
Michel-François DEMET. GRIMM JAKOB (1785-1863) et WILHELM (1786-1859) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
CONTE
- Écrit par Bernadette BRICOUT
- 5 807 mots
- 2 médias
...Ténèze, la collecte systématique des contes est postérieure, dans tous les pays d'Europe, à la publication des Kinder- und Hausmärchen des frères Grimm (1812-1815), dont l'impact fut considérable.Elle fut tantôt l'œuvre d'institutions nationales, comme la Société de littérature finnoise, créée en... -
CONTES DE L'ENFANCE ET DU FOYER, Jakob et Wilhelm Grimm - Fiche de lecture
- Écrit par Christian HELMREICH
- 1 094 mots
- 1 média
La publication en 1812 du premier volume des Contes des frères Jakob (1785-1863) et Wilhelm Grimm (1786-1859) s'inscrit dans un mouvement de redécouverte de la culture « populaire », particulièrement sensible en Allemagne depuis l'édition par Johann Gottfried Herder de son recueil...
-
DICTIONNAIRE DU XIXe SIÈCLE EUROPÉEN (dir. M. Ambrière) - Fiche de lecture
- Écrit par Bernard VALADE
- 1 346 mots
Faire renaître « notre avant-mémoire européenne et française » en révisant les jugements trop souvent injustes (le « stupide xixe siècle » de Léon Daudet) portés sur ce dont elle est formée : tel est l'objectif que s'est proposé d'atteindre Madeleine Ambrière, maître d'œuvre du ...
-
FOLKLORE
- Écrit par Nicole BELMONT
- 12 229 mots
- 1 média
Pour Jacob (1785-1865) et Wilhelm (1786-1859) Grimm, la poésie populaire – qui comprend non seulement le Lied, mais aussi l'épopée et même la mythologie – est une poésie de nature, une création collective du peuple poétisant, une création divine en dernier ressort : « Les chants épiques sont...
Voir aussi