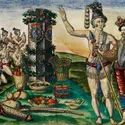LÉVINAS EMMANUEL (1905-1995)
Athènes et Jérusalem
Une deuxième période s'ouvre avec la publication de En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger (1949). Elle trouve son apogée en 1961 avec la publication de la thèse d'État, Totalité et Infini. Elle est aussi marquée par la rencontre avec Chouchani, maître talmudiste hors pair. Fort de son enseignement, Lévinas donnera annuellement, à partir de 1957, une leçon talmudique dans le cadre du colloque des intellectuels juifs de langue française. Son œuvre s'enrichit ainsi d'une série de commentaires talmudiques, qui entretiennent un rapport étroit et paradoxal avec ses travaux philosophiques. Autant on aurait tort d'estimer que sa philosophie n'est qu'un prolongement des lectures talmudiques – une sorte de glose philosophique d'une foi religieuse –, autant il ne faut pas sous-évaluer leur importance philosophique. L'étrange diptyque que constitue l'œuvre de Lévinas, unique en son genre dans la philosophie moderne, se laisse éclairer à travers sa thèse selon laquelle le rapport au livre, loin d'être extrinsèque à l'homme, définit un véritable mode d'être, plus intérieur que tous les états d'âme. C'est en ce sens que la Bible est essentielle à la pensée comme telle, dans la mesure où elle nous invite à énoncer des principes que la Grèce ignorait.
Si Lévinas n'a cessé de récuser l'appellation de « philosophe juif », c'est parce que, à ses yeux, la philosophie est une invention grecque, et que tout philosophe, qu'il le veuille ou non, est obligé de parler la langue des philosophes grecs. C'est précisément pour cela que cette langue doit s'ouvrir à d'autres pensées et d'autres interrogations que celles qui ont vu le jour sous le ciel de la Grèce.
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean GREISCH : docteur en philosophie, professeur émérite de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, titulaire de la chaire "Romano Guardini" à l'université Humboldt de Berlin (2009-2012)
Classification
Pour citer cet article
Jean GREISCH. LÉVINAS EMMANUEL (1905-1995) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Autres références
-
TOTALITÉ ET INFINI, Emmanuel Lévinas - Fiche de lecture
- Écrit par Francis WYBRANDS
- 710 mots
En 1987, dans la Préface à la traduction allemande de son livre, Emmanuel Lévinas (1905-1995) écrit : « Ce livre conteste que la synthèse du savoir, la totalité de l'être embrassée par le moi transcendantal, la présence saisie dans la représentation et le concept et l'interrogation sur...
-
ABENSOUR MIGUEL (1939-2017)
- Écrit par Anne KUPIEC
- 898 mots
- 1 média
Utopie, émancipation, critique, politique – tels sont les termes qui peuvent qualifier le travail conduit par Miguel Abensour, professeur de philosophie politique, éditeur et penseur.
Miguel Abensour est né à Paris le 13 février 1939. Agrégé de sciences politiques, auteur d’une thèse d’État (...
-
ALTRUISME
- Écrit par Guy PETITDEMANGE
- 3 328 mots
- 1 média
...mon moi, et m'ouvre sans tristesse sur l'abîme des commencements et l'indistinction de la fin, telle pourrait être, simplifiée à l'extrême, la thèse d' Emmanuel Levinas, le penseur le plus radical de l'altérité. Éthique ? Non, si l'on entend par là le corollaire d'une conception du monde, un système de... -
BLANCHOT MAURICE (1907-2003)
- Écrit par Christophe BIDENT
- 2 333 mots
...propriétaires terriens aisés. C'est auprès de son père, précepteur pour enfants de grandes familles, qu'il apprend l'essentiel de son savoir littéraire. Vers 1923, à l'université de Strasbourg, où il étudie la philosophie et l'allemand, il rencontre un étudiant juif venu de Lituanie auquel il se... -
DÉSIR, philosophie
- Écrit par Jean GREISCH
- 1 360 mots
C'est cette lacune qu'Emmanuel Lévinas comble dans Totalité et Infini (1961), à travers une relecture critique de Platon et de Hegel. Réagissant contre l'interprétation du désir comme simple manifestation de l'indigence et de l'incomplétude propre au besoin, Lévinas lui assigne comme terme véritable... - Afficher les 17 références
Voir aussi