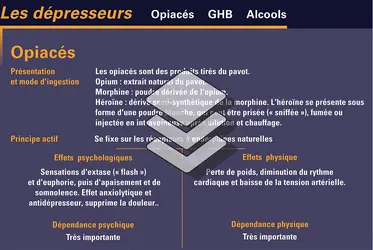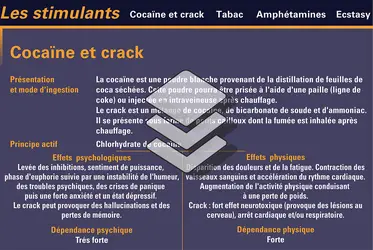DROGUE
Depuis des décennies, nombre de médecins, d'éducateurs, de sociologues, d'anciens « drogués », d'associations ont travaillé à modifier les approches contemporaines de la toxicomanie. On ne parle plus simplement de « drogue » à moins d'accepter d'être considéré comme réactionnaire ou répressif ; on parle de substances psychoactives, de dépendance, d'addiction, de comportement « toxico ». Force est d'admettre que la drogue et son approche, bien qu'elles aient changé, n'ont pas éliminé, pour le public, le drogué, même si ce dernier est moins souvent considéré comme pervers ou comme rebut de la société. Et l'on reconnaît aussi qu'« il n'y a pas de drogué heureux », comme le rappellait le docteur Claude Olievenstein dans un de ses ouvrages. Pourtant, la drogue reste un objet incompris. On la définissait naguère comme une « substance naturelle ou synthétique inscrite sur une liste annexée à une convention internationale et soumise à réglementation ». Mais la description, l'analyse, le traitement des conduites addictives ont amené les spécialistes à une compréhension plus problématique et moins administrative du phénomène : tout peut être drogue pour les individus ; cependant, les troubles engendrés par tel ou tel produit (sucre, café, vin, cocaïne...) peuvent être distingués sous certains aspects – la rapidité d'apparition de l'addiction, son irradicabilité relative, ses conséquences morbides, etc. – et permettent une description qui, tout en admettant une relative spécificité de la position « toxicomaniaque », n'évitera pas le problème de la nature des produits.
La relativité des classifications et des distinctions (« drogue dure », « drogue douce ») s'impose lorsque l'on sait que, outre les stupéfiants proprement dits (dont le nom servait autrefois à désigner une brigade de police spécialisée), les hallucinogènes et les amphétamines, plusieurs centaines de produits pharmaceutiques sont utilisés à des fins toxicomaniaques. De plus, l'usage détourné de solvants organiques (ou de produits de grande consommation qui en contiennent) a allongé et rendu plus fluctuante encore la liste des substances susceptibles d'être utilisées comme stupéfiants.
Mais aussi, à côté des « drogues de plaisir », utilisées, du moins les premiers temps, pour la découverte de sensations inédites et de paradis artificiels, la civilisation contemporaine a su produire des drogues que l'on serait tenté d'appeler « de besoin » : tranquillisants et excitants, qui, au-delà d'un usage thérapeutique fondé et vérifié, sont, parfois et même souvent, utilisés comme palliatifs ou comme adjuvants pour une bonne perception de soi-même au sein d'une civilisation dure ou menaçante.
On peut alors se demander : qu'est-ce qui fait le drogué ? Une réponse classique, reprise dans la préface de Jean Thuillier au livrePhantastica de Louis Lewin, affirme : « Dans une quête avouée ou inconsciente, l'homme a recherché par les drogues des paradis artificiels pour échapper à ses conditions d'existence, soulager ses douleurs physiques ou morales, communiquer avec les dieux, sacrifier à des rites ou secouer l'ennui d'un ego trop fortement équilibré ou trop pauvrement structuré ». Pourtant, la drogue est aussi un produit « qui à doses faibles ou moyennes provoque chez l'homme des syndromes psychiatriques réversibles ». L'usage de tels produits dans la civilisation contemporaine inscrit la modification de conscience comme un but ou une exigence non négligeables de l'activité humaine. Aussi la société tente-t-elle d'établir un point de repère, un standard distinguant le bien et le mal, l'usage et la manie, en se servant des concepts de réversibilité et d'irréversibilité. Mais le maniement extrêmement délicat de ces concepts (l'escalade,[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Alain EHRENBERG : directeur du Groupement de recherche psychotropes, politique, société du C.N.R.S. et du Centre de recherches psychotropes, santé mentale, société, unité C.N.R.S., université de Paris-V
- Olivier JUILLIARD : écrivain
- Alain LABROUSSE : retraité de l'Éducation nationale, expert dans le domaine de la géopolitique des drogues
- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Pour citer cet article
Alain EHRENBERG, Universalis, Olivier JUILLIARD et Alain LABROUSSE. DROGUE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
AFGHANISTAN
- Écrit par Daniel BALLAND, Gilles DORRONSORO, Universalis, Mir Mohammad Sediq FARHANG, Pierre GENTELLE, Sayed Qassem RESHTIA, Olivier ROY, Francine TISSOT
- 37 316 mots
- 19 médias
-
ASIE (Géographie humaine et régionale) - Espaces et sociétés
- Écrit par Philippe PELLETIER
- 23 142 mots
- 4 médias
...social, politique, économique et culturel de l'État central, parfois en opposition ouverte ou larvée avec celui-ci. Leur économie repose généralement sur la production et le trafic de drogue, à partir de la culture du pavot : Triangle d'or à la frontière de la Birmanie, de la Thaïlande, du Laos et maintenant... -
ASIE (Géographie humaine et régionale) - Dynamiques régionales
- Écrit par Manuelle FRANCK, Bernard HOURCADE, Georges MUTIN, Philippe PELLETIER, Jean-Luc RACINE
- 24 799 mots
- 10 médias
...politique d'islamistes radicaux et surtout avec le trafic de drogue. L'Afghanistan est en effet devenu le premier producteur mondial d'opium. Le trafic de drogue (opium et héroïne) constitue un solide réseau économique, politique et social unifiant toute la région, d'Istanbul à Tachkent en passant... -
BOLIVIE
- Écrit par Virginie BABY-COLLIN, Jean-Pierre BERNARD, Universalis, Jean-Pierre LAVAUD
- 11 790 mots
- 8 médias
...légale des yungas, destinés à la consommation traditionnelle, c'est-à-dire sous forme de mastication et de tisanes, ne représentent rien par rapport aux cultures illégales de la province du Chapare (au nord de Cochabamba). Malgré les nombreux programmes de substitution financés par l'aide internationale... - Afficher les 27 références
Voir aussi
- ANOREXIE
- ISLAMISME
- MARGINALITÉ SOCIALE
- PSYCHOTHÉRAPIE
- DÉSIR & BESOIN
- ANTIDÉPRESSEURS
- PLUS-VALUE
- PSYCHOLEPTIQUES
- AGRICULTEURS
- AMPHÉTAMINES
- PSYCHOTROPES
- PSYCHOANALEPTIQUES
- PSYCHODYSLEPTIQUES
- PAIEMENT ET MONNAIE ÉLECTRONIQUES
- BUPRENORPHINE
- PROZAC
- GAFI (Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux) ou FATF (Financial Action Task Force)
- RÉGULATION FINANCIÈRE INTERNATIONALE
- GLOBALISATION FINANCIÈRE
- AUTODÉFENSES UNIES DE COLOMBIE (AUC)
- TOXICOMANIES
- TRANQUILLISANTS
- SUBSTITUTION TRAITEMENT DE, addictologie
- STUPÉFIANTS
- DÉPENDANCE, toxicologie
- CANNABIS
- HÉROÏNE
- ALCOOLISME
- HYPNOTIQUES ou SOMNIFÈRES
- INSTITUTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES
- DÉPÔTS BANCAIRES
- POLITIQUE SANITAIRE
- TALIBANS
- LSD (diéthylamide de l'acide lysergique)
- HALLUCINOGÈNES
- FRANCE, droit et institutions
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours
- EUPHORISANTS
- SEVRAGE, toxicologie
- MÉTHADONE
- DÉSINTOXICATION
- LEWIN LOUIS (1850-1929)
- ANXIOLYTIQUES
- COMMERCE DES ARMES
- ZONES FRANCHES
- TABAGISME
- POLYTOXICOMANIE
- TRAFIC DE DROGUE
- BLANCHIMENT DE CAPITAUX