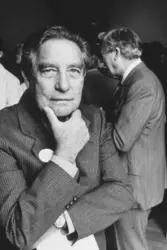AMÉRIQUE LATINE Littérature hispano-américaine
Un panorama des lettres hispano-américaines peut-il être autre chose qu'une juxtaposition de vues sur les littératures propres à chacune des nations qui forment l'Amérique hispanique ? On pourrait d'abord en douter. Pourtant, quelles que soient les différences dues à la diversité des climats, des sources et des modes de peuplement, à l'inégalité de l'évolution économique et sociale, du point de vue littéraire, les ressemblances l'emportent de beaucoup. Elles sont essentiellement le résultat de trois siècles de domination espagnole, autant que d'un effort commun et simultané pour s'en libérer. Cette émancipation accomplie, la tradition espagnole n'en a pas moins subsisté dans la religion, les mœurs, les goûts et, par-dessus tout (malgré des différences dialectales qui vont d'ailleurs s'effaçant) dans la langue.
Certes – contre le vœu du libérateur Bolivar –, les nouvelles nations issues du démembrement de l'ancien empire espagnol ont, en général, moins cultivé le sentiment de leur unité que celui de leurs particularismes. Aujourd'hui encore la définition, toujours inachevée, de leur identité nationale (« mexicanité », « péruvianité », « argentinité », etc.) offre aux littérateurs un thème inépuisable de spéculations plus ou moins arbitraires. Mais, pour qui observe de l'extérieur cette vaste partie du monde, le développement des lettres y apparaît remarquablement analogue en ce qu'il résulte d'évolutions politiques très similaires : passage brusque d'une économie agraire quasi féodale aux formes modernes du capitalisme ; dictatures nées de coups d'État ou de révolutions avortées ; conflits entre nations limitrophes ; et, plus récemment, résistance à l'impérialisme nord-américain – autant de facteurs qui ont déterminé chez les écrivains de ces nations un état d'inquiétude et de mobilisation permanente, moins favorable à l'exercice des lettres pures qu'à celui d'une littérature d'action. Aussi bien, malgré des exceptions (notamment au début de la période dite moderniste), ce caractère militant fut et reste l'un des traits saillants et communs de la littérature en prose.
On note, par ailleurs, le fait que la ligne de démarcation paraît moins nette qu'en d'autres lieux entre la prose et la poésie, la plupart des écrivains qui comptent ayant été à la fois poètes et prosateurs (le cas de Domingo Faustino Sarmiento, Juan Montalvo ou José Enrique Rodó, qui n'ont guère écrit qu'en prose, est exceptionnel). Et si la poésie fut et continue d'être largement pratiquée presque partout, ainsi que la littérature historique, la narration brève et l'essai, en revanche, le roman proprement dit n'est guère apparu que dans la seconde moitié du xixe siècle. Quant à la littérature dramatique, elle est généralement négligeable.
Autre caractéristique, la proportion élevée d'auteurs importants ayant exercé des fonctions diplomatiques et consulaires (Rubén Darío, Alberto Blest Gana, Alfonso Reyes, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Octavio Paz, etc.) contribue à manifester les liens qui existent, d'une part, entre la culture proprement hispano-américaine et celle du dehors, et, d'autre part, entre la littérature et la politique.
On ne saurait trop insister sur ces liens. À la différence des hommes de lettres européens, les auteurs hispano-américains se définissent moins en fonction de telle esthétique ou de telle idéologie que par l'importance relative qu'ils donnent à l'idéologie et à l'esthétique ; moins par la préférence qu'ils accordent à telle ou telle littérature étrangère que par leur ouverture – ou leur opposition – aux influences étrangères, d'où qu'elles viennent. Au reste, dans la mesure où les écrivains participent aux luttes politiques et[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Albert BENSOUSSAN : professeur émérite à l'université de Rennes-II-Haute-Bretagne
- Michel BERVEILLER : maître de conférences à la faculté des lettres et sciences humaines d'Amiens
- François DELPRAT : professeur émérite, université de Paris-III-Sorbonne nouvelle
- Jean-Marie SAINT-LU : agrégé d'espagnol, maître de conférences honoraire à l'université de Toulouse-II-Le Mirail
Classification
Pour citer cet article
Albert BENSOUSSAN, Michel BERVEILLER, François DELPRAT et Jean-Marie SAINT-LU. AMÉRIQUE LATINE - Littérature hispano-américaine [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
ALLIANCE POUR LE PROGRÈS
- Écrit par Universalis
- 928 mots
Créée le 13 mars 1961 à Washington, l'Alliance pour le progrès (Alianza para el progreso) est lancée en août par la conférence de Punta del Este qui définit ses objectifs et ses organes d'exécution. L'effort entrepris s'inscrit dans la ligne politique inaugurée par les États-Unis, en 1895, lors...
-
AMAZONE, fleuve
- Écrit par Pierre CARRIÈRE
- 2 326 mots
- 2 médias
-
AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géographie
- Écrit par Jacqueline BEAUJEU-GARNIER, Danièle LAVALLÉE, Catherine LEFORT
- 18 105 mots
- 9 médias
Quant aux Ibériques, nombreux furent les chefs militaires, les administrateurs et les religieux qui gagnèrent les rives de l'Amérique centrale et de l'Amérique méridionale : ils furent accompagnés d'un certain nombre de paysans qui arrivèrent, eux aussi, très tôt. De pauvres cultivateurs, rudes et privés... -
ANARCHISME
- Écrit par Henri ARVON, Universalis, Jean MAITRON, Robert PARIS
- 13 391 mots
- 7 médias
L'influence des idées anarchistes en Amérique latine, principalement en Argentine, s'est fait sentir avec la pénétration des théories bakouniniennes. Un centre de propagande ouvrière édita en 1879 un opuscule, Una idea, exposant les conceptions de Bakounine. Les journaux El Descamisado... - Afficher les 53 références
Voir aussi
- CHILIENNE LITTÉRATURE
- AMÉRIQUE ESPAGNOLE
- HISPANO-AMÉRICAINE LITTÉRATURE
- SKARMETA ANTONIO (1940- )
- CASTELLANOS MOYA HORACIO (1957- )
- BELLATÍN MARIO (1960- )
- RUY SÁNCHEZ ALBERTO (1951- )
- FUGUET ALBERTO (1964- )
- CRACK GROUPE DU
- VOLPI JORGE (1968- )
- PADILLA IGNACIO (1968-2016)
- URROZ KANAN ELOY (1967- )
- AIRA CÉSAR (1949- )
- REY ROSA RODRIGO (1958- )
- SABINES JAIMES (1926-1999)
- POMA DE AYALA FELIPE GUAMÁN (1530 env.-env. 1615)
- ESPAGNOLE LITTÉRATURE, des origines au XVIIIe s.
- ESPAGNOLE LITTÉRATURE, XIXe, XXe et début du XXIe s.
- ARGENTINE LITTÉRATURE
- PÉRUVIENNE LITTÉRATURE
- MEXICAINE LITTÉRATURE
- CUBAINE LITTÉRATURE
- CARAÏBES ou ANTILLES LITTÉRATURES DES
- COLOMBIENNE LITTÉRATURE
- LARRETA ENRIQUE (1875-1961)
- LÓPEZ Y FUENTES GREGORIO (1895-1966)
- MALLEA EDUARDO (1903-1982)
- MATTO DE TURNER CLORINDA (1852-1909)
- MERA LEÓN JUAN (1832-1894)
- PRADA MANUEL GONZÁLES (1848-1918)
- REYLES CARLOS (1868-1938)
- ZORRILLA DE SAN MARTÍN JUAN (1855-1931)
- INDIANISME, littérature
- INDIGÉNISME, littérature
- BALBUENA BERNARDO DE (1563-1625)
- RODÓ JOSÉ ENRIQUE (1871-1917)
- DÍAZ JESÚS (1941-2002)
- FUENTES VILMA (1949- )
- CABALLERO ANTONIO (1945-2021)
- AÍNSA FERNANDO (1937-2019)
- CARBALLIDO EMILIO (1925-2008)
- IBARGÜENGOITIA JORGE (1928-1983)
- BUENAVENTURA ENRIQUE (1925-2003)
- VILLAURRUTIA XAVIER (1903-1950)
- COSSA ROBERTO (1934- )
- CHOCRÓN ISAAC (1930-2011)
- SOLARI SWAYNE ENRIQUE (1915-1995)
- CHALBAUD ROMÁN (1931-2023)
- GARRO ELENA (1920-1998)
- GAMBARO GRISELDA (1928- )
- PIÑERA VIRGILIO (1912-1979)
- CABRUJAS IGNACIO (1937-1995)
- LEÑERO VICENTE (1933-2014)
- SÁNCHEZ LUIS RAFAEL (1936- )
- FINZI ALEJANDRO (1951-2021)
- WOLFF EGON (1926-2016)
- DRAGÚN OSVALDO (1929-1999)
- TRIANA JOSÉ (1931-2018)
- PAVLOVSKY EDUARDO (1933-2015)
- SPREGELBURD RAFAEL (1970- )