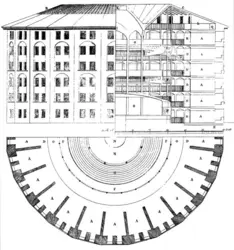URBANISME Théories et réalisations
Urbanisme et aménagement à l'ère des médias
Les sociétés modernes sont entrées dans l'ère post-urbaine annoncée dès 1968 par Melvin Webber, sous le nom de post-city age.
Les mutations intervenues dans les domaines des transports, de la communication et des télécommunications ont rendu inutile la concentration urbaine et favorisent une distribution homogène des activités et des populations, qui commence sous nos yeux.
L'urbanisme progressiste a contribué à cet éclatement des anciens établissements urbains au profit d'une urbanisation uniforme et généralisée, qui récuse également les anciens établissements ruraux, les anciennes villes et les anciennes formes d'urbanité.
Cependant, l'« urbain » promu substantif continue de hanter les instances décisionnelles, les praticiens, le public : « produire la ville » est devenu un leitmotiv. Ce retour paradoxal sur les positions d'un urbanisme culturaliste, pourtant démystifié, qui s'inscrit en faux contre la marche de l'histoire, est favorisé, du côté des architectes, par le mouvement post-moderne et son hostilité à l'architecture et à l'urbanisme du mouvement moderne. Par ailleurs, la vogue du patrimoine historique, qui a fini par englober le tissu urbain ancien (loi Malraux sur les secteurs sauvegardés, 1962 ; charte d'Amsterdam, 1975) revalorise l'image traditionnelle de la ville et pose aussi, de façon cruciale, la question du traitement des ensembles anciens dans le processus d'urbanisation.
Les exigences de la lucidité conduisent à se demander si le terme même d'urbanisme, si connoté par l'urbs et par la cité, ne doit pas être désormais confiné dans le champ du droit où il désigne une réglementation liée aux nouvelles modalités de l'urbanisation.
« Urbanisme » tend d'ailleurs à être remplacé par le terme « aménagement », qui subsume une multiplicité d'échelles d'intervention, relevant de problématiques différentes. Au sommet, un aménagement des territoires, directement en prise sur les grands choix économiques, sociaux, écologiques des États et des communautés d'États, solidarise, par la médiation des techniques de pointe du génie urbain, des réseaux d'infrastructures de plus en plus vastes, performants, sophistiqués et fragilisés par cette complexité même. À la base, et sans pour autant, jusqu'ici, menacer les opérations géantes et les mégastructures (gratte-ciel de Norman Foster à Hong Kong, Mosquée de Rabat), un aménagement à l'échelle des parcelles et des îlots traditionnels correspond à la pratique que les Anglo-Saxons appellent urban design. Les études de morphologie et les recherches sur les parcellaires urbain et rural, lancées avant la Seconde Guerre mondiale par la géographie lablachienne et par Marc Bloch, ont été reprises par des architectes, d'abord en Italie (G. Samona, C. Aymonino, A. Rossi) et dès le début de la crise du mouvement moderne. Cette démarche pourrait présager une réconciliation de l'aménagement avec l'échelle humaine et permettre aux architectes de retrouver un rôle créateur, à la mesure de leurs ambitions légitimes.
Au regard des récentes mutations sociétales, induites par l'innovation technique, les théories de l'urbanisme, de Cerdá aux C.I.A.M., apparaissent aujourd'hui singulièrement naïves. Il n'en demeure pas moins souhaitable que la multiplication des savoirs et des pratiques impliqués dans la production de notre environnement laisse subsister une réflexion de synthèse, commune à la diversité des intervenants.
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Françoise CHOAY : professeur à l'université de Paris-VIII
Classification
Pour citer cet article
Françoise CHOAY. URBANISME - Théories et réalisations [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
ALBERTI LEON BATTISTA (1404-1472)
- Écrit par Frédérique LEMERLE
- 3 110 mots
- 8 médias
...cité idéale a un plan rationnel, avec des édifices régulièrement disposés de part et d'autre de rues larges et rectilignes. Cette nouvelle conception de l'urbanisme, en rupture avec les pratiques médiévales, est liée sans doute à l'essor sans précédent de la cité-république. Alberti reprend la plupart des... -
ALPHAND ADOLPHE (1817-1891)
- Écrit par Universalis, Michel VERNÈS
- 1 674 mots
Ouvrir de nouveaux espaces, assainir les anciens, créer des jardins, embellir l'ensemble, tels sont les différents gestes d'une même démarche qui ont conduit à faire de Paris une capitale moderne au xixe siècle. Jean-Charles Adolphe Alphand, paysagiste et administrateur français de...
-
ANGIVILLER CHARLES CLAUDE DE LA BILLARDERIE comte d' (1730-1809)
- Écrit par Marie-Geneviève de LA COSTE-MESSELIÈRE
- 607 mots
- 1 média
La faveur de Louis XVI vaut à d'Angiviller de remplacer, en 1774, le marquis de Marigny comme surintendant des bâtiments du roi. Ses idées sont plus personnelles que celles de son prédécesseur, mais il reconnaît la valeur de l'œuvre accomplie par lui grâce aux sages conseils dont il a su s'entourer...
-
ANTHROPOLOGIE URBAINE
- Écrit par Thierry BOISSIÈRE
- 4 898 mots
- 2 médias
L’autre grande école d’anthropologie urbaine est britannique et voit le jour à la fin des années 1930 en Rhodésie du Nord (auj. Zambie), alors dominée par la Grande-Bretagne. Le Rhodes-Livingstone Institute y est fondé en 1937, avec pour mission d’étudier les changements affectant les sociétés d’Afrique... - Afficher les 144 références
Voir aussi
- ARCHITECTURE THÉORIE DE L'
- CONTESTATION
- INDUSTRIELLE SOCIÉTÉ
- CHARTE D'ATHÈNES (1933)
- URBANISME AU XXe ET AU DÉBUT DU XXIeSIÈCLE, France
- AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE URBAIN
- SORIA Y MATA ARTURO (1844-1920)
- SITTE CAMILLO (1843-1903)
- VILLES NOUVELLES
- CULTURALISTE URBANISME
- CIAM (Congrès internationaux d'architecture moderne)
- CERDA ILDEFONSO (1816-1876)
- ESPACE URBAIN
- URBANISATION
- ROYAUME-UNI, droit et institutions
- VILLE, urbanisme et architecture
- FRANÇAISE ARCHITECTURE
- ITALIENNE ARCHITECTURE
- MUSÉE SOCIAL (Centre d'études, de documentation, d'information et d'action sociales)
- MODERNISME & POSTMODERNISME, art
- RENAISSANCE ARCHITECTURE DE LA
- ARCHITECTURE DU XXe ET DU DÉBUT DU XXIe SIÈCLE
- URBANISME DROIT DE L'