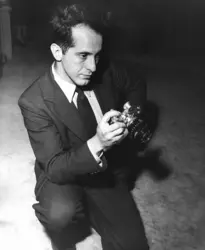PHOTOGRAPHIE (art) Un art multiple
Comme toute technique accédant à la création artistique, la photographie a connu un épanouissement artistique, jalonné de divers courants. De la plaque daguerrienne à la diffusion numérique, au cours d'une histoire relativement brève, elle n'a cessé de se remettre en question, notamment en ce qui concerne la notion d'unicité matérielle de l'œuvre, longtemps représentée par le tirage sur papier baryté, numéroté ou non.
Quand elle franchit le seuil du xxe siècle, la photographie dispose encore de son statut d'invention récente, inscrite dans une modernité liée à un essor industriel qui devait transformer la civilisation occidentale. Outil capable d'accomplir une restitution « objective » de la réalité, elle a évolué, de l'expérimentale héliographie de Nicéphore Niépce au commode système négatif-positif gélatino-bromure des années 1860. À l’articulation des xixe et xxe siècles, dans le sillage des pionniers qui déjà revendiquaient une reconnaissance artistique, l'école pictorialiste reprend les codes régissant les genres du paysage, de la nature morte et du portrait en travaillant l’image mécanique au moyen de divers procédés chimiques.
Avec les avancées techniques qui introduisaient la notion inédite d'instantané, la tendance à l'imitation allait laisser place à une utilisation nouvelle d’un médium appelé à rejoindre pleinement l'ensemble des domaines artistiques, renouvelés ou bouleversés par l'effervescence novatrice qui suivra la Première Guerre mondiale, de la sculpture à la musique, en passant par le théâtre et la danse.
Un art en plein essor
Depuis sa création, la photographie n’a cessé d’occuper une place grandissante dans le paysage culturel jusqu’à nos jours. Les États-Unis ont été, à n’en pas douter, les fers de lance de cette reconnaissance : Alfred Stieglitz la fait entrer dans les musées dès le début du xxe siècle ; le Museum of Modern Art de New York ouvre en 1940 un département de photographie ; Kodak fonde en 1949 la George Eastman House, qui deviendra l'International Museum of Photography. Présente à la Library of Congress de Washington, au Metropolitan Museum de New York et au musée de Philadelphie, elle acquiert une légitimité à laquelle souscriront rapidement le Fogg Art Museum (Harvard University) de Boston, l'Art Institute de Chicago, le Museum of Art de San Francisco, le Center for Creative Photography à Tucson (Arizona). En 1974, Cornell Capa fonde l'International Center of Photography à New York, organisant expositions et conférences autour de ses collections... Au Canada, celles de la Galerie nationale d'Ottawa et l'activité de l'Office national du film sont au premier plan. En Europe, le temps perdu se rattrape autour des collections déjà anciennes du département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale à Paris, de la National Portraits Gallery et du Victoria and Albert Museum de Londres, du Folkwang Museum d'Essen, du Museum Ludwig à Cologne, du Prentenkabinet de Leyde (Pays-Bas). À travers le monde, des centres nouveaux voient le jour : au musée de l'université de Parme (Italie), au Kunsthaus de Zurich (Suisse), au Stedelijk Museum d'Amsterdam, au Moderna Museet de Stockholm, au musée des Arts décoratifs de Prague, à Lodz (Pologne), à Siaulai (Lituanie), à l'Australian Center for Photography de Sydney. En France, le musée Nicéphore-Niépce de Chalon-sur-Saône, la galerie municipale du Château-d'Eau à Toulouse témoignent du dynamisme de la province. À Arles, le musée Réattu est inséparable d'un festival annuel fondé en 1970 et qui deviendra la plus grande rencontre mondiale d'auteurs et d'amateurs. Enfin, en 1978, le congrès de Mexico révèle l'éveil de la photo latino-américaine.
Un autre signe de la vitalité de[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Hervé LE GOFF : professeur d'histoire de la photographie, critique
- Jean-Claude LEMAGNY : agrégé de l'Université, conservateur au Cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale
Classification
Pour citer cet article
Hervé LE GOFF et Jean-Claude LEMAGNY. PHOTOGRAPHIE (art) - Un art multiple [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE (M. Poivert)
- Écrit par Jean-Marc HUITOREL
- 958 mots
La photographie, pour être une technique – et c'est sans doute là sa seule définition générale et incontestable –, désigne aussi ce que produit cette technique, c'est-à-dire des photographies, en d'autres termes l'ensemble de ces objets visuels, issus de la mécanique et de la chimie, qui appartiennent...
-
AARONS SLIM (1916-2006)
- Écrit par Universalis
- 175 mots
Photographe américain. Entré dans l'armée à dix-huit ans, en 1935, George Allen « Slim » Aarons devient bientôt photographe officiel de l'Académie militaire de West Point. La guerre le conduit en Afrique du Nord et en Italie comme reporter en campagne. Il en revient blessé et décoré, mais surtout séduit...
-
ABDESSEMED ADEL (1971- )
- Écrit par Giovanni CARERI
- 989 mots
L'œuvre photographique qui a servi de manifeste à l'exposition du Centre Georges-Pompidou à Paris, du 3 octobre 2012 au 7 janvier 2013, montre l'artiste debout devant la porte de son atelier parisien. Adel Abdessemed, l'œil à demi fermé, croise les bras devant sa poitrine et s'offre au feu qui,...
-
ACTIONNISME VIENNOIS
- Écrit par Matthias SCHÄFER
- 2 242 mots
L'appareil photographique favorise cette nouvelle forme d'art. Contraignant (cadrage, éclairage, composition), il pousse l'artiste à se concentrer totalement sur son action, au cours de laquelle il manipule objets, matériaux, corps humains et animaux. Véritable outil de contrôle, l'appareil photographique... -
ADAMS ANSEL (1902-1984)
- Écrit par Christian CAUJOLLE, Universalis
- 1 687 mots
- 2 médias
Célèbre photographe américain, emblématique d'un mouvement prônant une photographie artistique « pure », Ansel Adams a contribué, au cours des années 1930, à définir une nouvelle voie esthétique se distinguant de la photographie « pictorialiste » alors en vogue. Au sein du groupe f/64, dont il est...
- Afficher les 243 références
Voir aussi
- PORTRAIT, photographie
- NU, photographie
- PHOTOGRAPHIE DE MODE
- CHIMIGRAMME
- PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
- PHOTOGRAPHIE EN COULEURS
- DYE TRANSFER
- MEYEROWITZ JOEL (1938- )
- GALERIES D'ART
- GERZ JOCHEN (1940- )
- FULTON HAMISCH (1946- )
- REPORTAGE
- NOUVEAUX TOPOGRAPHES, photographie
- DAVIES JOHN (1949- )
- FLEISCHER ALAIN (1944- )
- STARKEY HANNAH (1968- )
- LOCKHART SHARON (1964- )
- CREWDSON GREGORY (1962- )
- MERCADIER CORINNE (1955- )
- SCHORR COLLIER (1963- )
- D'AGATA ANTOINE (1961- )
- RITTS HERB (1952-2002)
- GÓMEZ ALAIR (1921-1992)
- DELAHAYE LUC (1962- )
- DELRUE ARNAUD (1981- )
- FANTASTIQUE ART
- ART DU XXe ET DU DÉBUT DU XXIe SIÈCLE
- PHOTOGRAPHIE SCIENTIFIQUE
- MARCHÉ DE L'ART
- MAGNUM AGENCE
- PHOTOGRAPHIE ET PEINTURE
- GAUTRAND CLAUDE (1932- )
- REVUES D'ART
- WEILL ÉTIENNE-BERTRAND (1919-2001)
- HAJEK-HALKE (1898-1983)
- WALKER TODD (1917-2006)
- HEINECKEN ROBERT (1931- )
- UELSMANN JERRY (1934- )
- METZKER RAY (1931- )
- MEATYARD RALPH EUGÈNE (1925-1972)
- DE LAPPA WILLIAM (1943- )
- PHOTOJOURNALISME
- ZACHMANN PATRICK (1955- )
- SCHNECK ANTOINE (1963- )