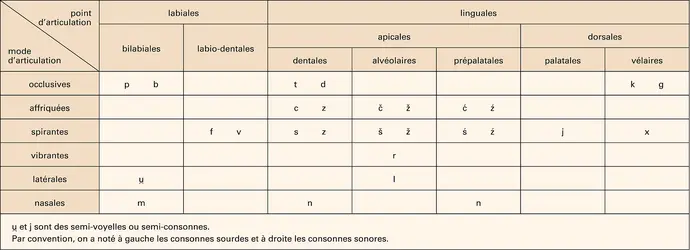PHONOLOGIE
Les changements phonétiques
Pour la phonétique historique du xixe siècle, les changements phonétiques s'expliquaient par deux causes : soit l'effet des pressions syntagmatiques auxquelles sont soumis les sons dans la chaîne parlée ; soit un glissement des habitudes articulatoires chez les usagers ou l'impact d'un substrat linguistique (de la part de populations adoptant une nouvelle langue) dont on pouvait rarement donner les preuves. Elle délimitait donc deux types de changements :
– les changements conditionnés par le contexte (exemple : si le [k] initial devant [a] du latin est devenu [ʃ] en français, c'est le contexte qui en est responsable) ;
– les changements inconditionnés ou spontanés étant dès lors tous ceux pour lesquels le contexte était jugé inopérant (exemple : tous les [u] latins sont devenus [y] en français, quels que soient les contextes).
Avec la phonologie structurale, des linguistes comme Martinet ont mis l'accent sur la causalité due au système (vu comme un tableau des relations de traits entre les phonèmes) plutôt que sur la causalité due au contexte. Dans cette perspective, tout changement phonétique constitue la partie visible d'un changement linguistique plus profond qui affecte l'équilibre du système phonologique. Et, effectivement, on peut montrer aisément que certains changements connus (dans les langues germaniques) ont affecté non un son unique, mais une série entière de phonèmes, obligeant ainsi d'autres séries à se repositionner. Des contre-exemples, cependant, donnent un certain poids à la théorie des marques, dans la mesure où celle-ci permet de comprendre pourquoi un seul phonème peut être touché à un moment donné de l'évolution. De son côté, la sociolinguistique, comme nous venons de le voir, a élargi les problématiques d'analyse en prenant en compte les facteurs sociaux, idéologiques et identitaires du changement.
Le succès spectaculaire qu'a connu la phonologie jusqu'aux années 1960 peut surprendre, d'autant qu'avec l'approfondissement de ses concepts et de ses méthodes elle est nettement plus avancée aujourd'hui dans la connaissance des phénomènes phoniques. Son succès était largement conditionné par les tenants d'une méthode d'analyse structurale, utilisant la phonologie comme garant scientifique. De nos jours, les passions structuralistes se sont apaisées et la phonologie peut poursuivre son œuvre en toute sérénité. La réflexion des phonologues s'efforce de surmonter certains clivages d'écoles, de définir l'extension des phénomènes relevant de la discipline et d'approfondir les méthodologies d'analyse. C'est ainsi que les développements récents s'efforcent de dépasser le clivage phonétique/morphologie et d'intégrer des phénomènes dépassant le cadre du mot.
On a vu plus haut comment les phénomènes dits supralinéaires, ou même linéaires mais relevant de grandeurs plus larges que le phonème (syllabes, suites prosodiques), avaient été quelque peu négligés dans les premiers travaux structuralistes, malgré les réflexions prémonitoires de N. Troubetzkoy. Or les développements récents de la phonologie convergent fortement vers une exploration minutieuse de ce domaine. L'explication en est double. D'une part, les mises en garde de la sociolinguistique, signalées plus haut, invitaient à ne pas limiter l'attention aux faits phoniques à la seule question : « Comment distingue-t-on un mot d'un autre ? » Par ailleurs, la forte domination exercée par les phonologies génératives a conduit ses propres praticiens à mesurer certaines impasses dans les traitements purement segmentaux de leurs règles : il y a manifestement, on le sait par l'histoire, des rapports entre l'accent et les phonèmes. Sinon, pourquoi une langue comme le portugais aurait-elle moins de voyelles en position postaccentuée[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean Léonce DONEUX : professeur de sciences du langage à l'université de Provence, Aix-Marseille-I
- Véronique REY : linguiste, maître de conférences en sciences du langage, directeur du département des sciences du langage, Aix-en-Provence, université de Provence-Aix-Marseille-I
- Robert VION : docteur d'État, professeur de linguistique générale à l'université de Provence-Aix-Marseille-I
Classification
Pour citer cet article
Jean Léonce DONEUX, Véronique REY et Robert VION. PHONOLOGIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Média
Autres références
-
PHONOLOGIE ARTICULATOIRE
- Écrit par Ioana CHITORAN, Pierre HALLÉ
- 1 040 mots
- 2 médias
La phonologie articulatoire est une théorie phonologique, proposée dans les années 1980 par Cathy Browman et Louis Goldstein, qui s’appuie sur des observations empiriques. Elle a été influencée par les idées de Sven Öhman et de Carol Fowler sur la coproduction (production simultanée) des consonnes et...
-
ANALYSE & SÉMIOLOGIE MUSICALES
- Écrit par Jean-Jacques NATTIEZ
- 5 124 mots
- 1 média
En linguistique, le modèle phonologique a pour objectif de déterminer quels sons appartiennent en propre à une langue : le japonais ne distingue pas entre l et r, le français distingue entre le é de « chantai » et le è de « chantais », l'allemand entre le ch de « Kirche » (église)... -
ANGLAIS (ART ET CULTURE) - Langue
- Écrit par Guy Jean FORGUE, Hans KURATH
- 6 289 mots
- 2 médias
L'anglais possède des consonnes occlusives (ou momentanées) et fricatives (ou continues), sourdes (comme p ou f) ou sonores (comme b ou v), et des consonnes résonnantes sonores (nasales, latérales et semi-voyelles). Toutes ces consonnes se trouvent en position d'initiales de mots, à l'exception... -
APPRENTISSAGE DE LA LECTURE
- Écrit par Jonathan GRAINGER, Johannes ZIEGLER
- 1 847 mots
D’où l’importance du second mécanisme, le décodage ou déchiffrage, qui consiste à trouver pour chaque symbole le son correspondant. Le décodage est au cœur de l’apprentissage de la lecture. Son efficacité repose sur deux bases : d’une part, les symboles de la majorité des systèmes d’écriture... -
APPRENTISSAGE DES LANGUES ÉTRANGÈRES
- Écrit par Daniel GAONAC'H
- 1 242 mots
Les recherches sur l’apprentissage des langues étrangères ont d’abord été liées au domaine de la psycholinguistique, puis à celui du bilinguisme. Elles prennent actuellement davantage en compte les concepts de la psychologie cognitive : modalités d’apprentissage, automatisation, coût cognitif....
- Afficher les 51 références
Voir aussi
- COMMUTATION, linguistique
- NEUTRALISATION, linguistique
- VOYELLE
- CONSONNE
- TRAIT DISTINCTIF, phonologie
- LANGUES ÉVOLUTION DES
- INTONATION
- GRAMMAIRE GÉNÉRATIVE & TRANSFORMATIONNELLE
- LANGAGE PATHOLOGIE DU
- VARIANTES, linguistique
- UNITÉS LINGUISTIQUES
- LINGUISTIQUE AMÉRICAINE
- STRUCTURALISME, grammaire
- LINGUISTIQUE HISTORIQUE ou GRAMMAIRE HISTORIQUE
- SYSTÈME NOTION DE, linguistique
- GRAMMAIRE FONCTIONNELLE
- SOCIOLINGUISTIQUE
- PSYCHOLINGUISTIQUE
- OPPOSITION, linguistique
- DISTINCTIVITÉ, linguistique
- COMPACT & DIFFUS, phonologie