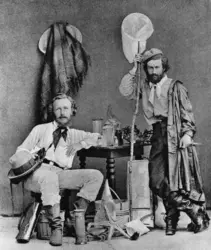PALÉOANTHROPOLOGIE ou PALÉONTOLOGIE HUMAINE
- 1. Des pierres de foudre à l’archéologie préhistorique
- 2. Les premiers hommes fossiles
- 3. L’homme antédiluvien
- 4. La découverte de l’homme de Néandertal et de la race de Cro-Magnon
- 5. « Le chaînon manquant » du singe à l’homme
- 6. L’homme de Piltdown et la théorie des présapiens
- 7. Le berceau de l’humanité se promène : de l’Asie vers l’Afrique
- 8. Bibliographie
L’homme de Piltdown et la théorie des présapiens
À cinq ans d'intervalle, en 1907 et 1912, deux autres découvertes survenues dans des couches anciennes en Europe même, vont illustrer à leur tour l'existence d'un être intermédiaire entre les singes et l'homme. La première, représentée par une mâchoire inférieure, provenait d'une sablière située près de Heidelberg, à Mauer. La trouvaille était fort ancienne à en juger par son enfouissement sous 24 mètres de sables et de lœss et par la faune qui l'accompagnait. Tandis que les uns s’efforçaient de trouver à cette mâchoire étonnamment massive et sans menton des caractères très simiesques par opposition aux dents manifestement humaines, son découvreur, Otto Schoetensack, l'attribua d'emblée à un nouveau type humain : l’Homo heidelbergensis. Elle n'apporta cependant rien de neuf puisqu’on se trouve dans l'impossibilité de la comparer aux fossiles de Java et en l'absence de tout contexte archéologique.
Autrement importante fut la découverte, en 1912, du fameux crâne de l' homme de Piltdown, dans le Sussex, en Angleterre. Tandis que le crâne reconstitué à partir de cinq morceaux était « tout pareil à celui d'un bourgeois de Londres », la mâchoire, quant à elle, présentait toutes les caractéristiques de celle d'un singe en dépit de ses dents d'apparence humaine. Le retentissement de cette découverte inespérée, faite par un archéologue amateur, Charles Dawson, fut considérable : elle fit l'objet de près de 500 publications de par le monde jusqu'au moment où, en 1953, l'on découvrit que l'homme de Piltdown n'était qu'une supercherie. La découverte de ces ossements à vrai dire tombait à pic en faisant renaître l'idée, déjà en faveur à la fin du xixe siècle, que le crâne avait dû atteindre sa forme présente à une époque fort ancienne. La différenciation des « races » humaines était alors généralement tenue pour un processus lent qui avait dû nécessiter toute la durée du Quaternaire. Deux lignées semblaient ainsi s'être côtoyées, en Europe, en y évoluant parallèlement : l'une menant aux hommes de Néandertal, l'autre qualifiée de « présapiens » donnant naissance à l'homme de type moderne représenté par les Cro-Magnons. La théorie des présapiens, confortée par la découverte de nouveaux restes d'hommes fossiles (Swanscombe, en Grande-Bretagne et Fontéchevade, en France) connut, à partir des années 1950, une large diffusion, puis fut peu à peu abandonnée, lorsque fut démontré que tous les prétendus représentants des présapiens menaient en fait vers les Néandertaliens.
- 1. Des pierres de foudre à l’archéologie préhistorique
- 2. Les premiers hommes fossiles
- 3. L’homme antédiluvien
- 4. La découverte de l’homme de Néandertal et de la race de Cro-Magnon
- 5. « Le chaînon manquant » du singe à l’homme
- 6. L’homme de Piltdown et la théorie des présapiens
- 7. Le berceau de l’humanité se promène : de l’Asie vers l’Afrique
- 8. Bibliographie
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Herbert THOMAS : sous-directeur honoraire au Collège de France
Classification
Pour citer cet article
Herbert THOMAS. PALÉOANTHROPOLOGIE ou PALÉONTOLOGIE HUMAINE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
AFRIQUE (Histoire) - Préhistoire
- Écrit par Augustin HOLL
- 6 326 mots
- 3 médias
Les recherches sur les origines de l'humanité sont pluridisciplinaires par nécessité et se composent d'une vaste panoplie dedisciplines faisant partie de ce que l'on peut appeler la « nébuleuse paléoanthropologie ». La branche archéologique se concentre sur l'étude des produits des activités hominidés/humaines... -
AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géographie
- Écrit par Jacqueline BEAUJEU-GARNIER, Danièle LAVALLÉE, Catherine LEFORT
- 18 105 mots
- 9 médias
Aucun anthropoïde actuel ou fossile qui puisse être ancêtre ou cousin d'un rameau humain n'a jamais été découvert en Amérique, où les plus anciens restes humains retrouvés ne remontent guère au-delà de 10 000 ou 11 000 ans et appartiennent presque tous à la variété mongoloïde de ... -
ARCHÉOLOGIE (Archéologie et société) - Aménagement des sites
- Écrit par Jean-Pierre MOHEN, Jean-François REYNAUD
- 5 946 mots
- 3 médias
Le chantier de fouilles ouvert en 1964 par Henry de Lumley dans la Caune de l'Arago (Pyrénées-Orientales) continue à être décapé. On y a trouvé plus de cent vestiges humains dont le crâne de l'homme de Tautavel « le premier Français », vieux de 400 000 ans. Le matériel archéologique est... -
ATAPUERCA, site préhistorique
- Écrit par Jean-Jacques HUBLIN
- 1 049 mots
Les gisements du complexe d'Atapuerca en Espagne ont acquis une renommée mondiale à la suite des découvertes qui y ont été faites à partir de 1980. Ces sites ont apporté des informations d'une importance exceptionnelle sur les premiers peuplements de l'Europe et sur l'origine des ...
- Afficher les 78 références
Voir aussi
- ANTHROPOLOGIE PHYSIQUE
- EUROPE, histoire
- CATASTROPHISME
- FOUILLES, archéologie
- SCIENCES HISTOIRE DES, XVIIe et XVIIIe s.
- SCIENCES HISTOIRE DES, XIXe s.
- ORIGINES DE L'HOMME
- CRO-MAGNON HOMME DE
- TERTIAIRE ÈRE
- SILEX
- SINGES
- AFRIQUE, préhistoire
- WADJAK ou WAJAK HOMME DE
- TRANSFORMISME
- PITHÉCANTHROPE
- AUSTRALOPITHÈQUES
- AUSTRALIE, NOUVELLE-GUINÉE & TASMANIE, préhistoire et archéologie
- LITHIQUES INDUSTRIES
- SQUELETTE HUMAIN
- PALÉOANTHROPOLOGIE HISTOIRE DE LA
- TRINIL SITE PRÉHISTORIQUE DE, Java