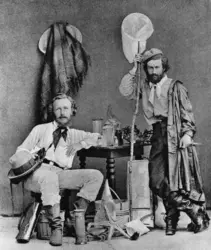PALÉOANTHROPOLOGIE ou PALÉONTOLOGIE HUMAINE
- 1. Des pierres de foudre à l’archéologie préhistorique
- 2. Les premiers hommes fossiles
- 3. L’homme antédiluvien
- 4. La découverte de l’homme de Néandertal et de la race de Cro-Magnon
- 5. « Le chaînon manquant » du singe à l’homme
- 6. L’homme de Piltdown et la théorie des présapiens
- 7. Le berceau de l’humanité se promène : de l’Asie vers l’Afrique
- 8. Bibliographie
Les premiers hommes fossiles
Malgré tout, certains de ces pionniers demeurent eux-mêmes sur la défensive, imprégnés par les idées d'une époque entièrement dominée par l'autorité de Georges Cuvier (1769-1832) qui avait, à diverses reprises, cru démontrer l'inexistence des hommes fossiles en faisant table rase des erreurs du passé. Tel fut le cas du baron Von Schlottheim, qui signala, en 1820, des os humains exhumés d'une grotte près de Köstriz en Saxe, accompagnés des vestiges d'une faune antédiluvienne parmi lesquels ceux d’un rhinocéros. Sur les instances de Cuvier, Schlottheim s'empressa de faire connaître les doutes qu'il avait lui-même sur le gisement. En 1823, l'Anglais William Buckland fit connaître à son tour, dans ses célèbres Reliquiae diluvianae, la découverte d'un squelette humain (caverne à Paviland, pays de Galles), qu'il surnomma la « dame rouge » et qui était associé à des ossements d'une faune éteinte. En dépit de ses fouilles minutieuses et de ses observations pourtant rigoureuses, Buckland se réfugie derrière les présupposés de l'époque : pour lui, l'occupation de la grotte datait de l'invasion romaine.
La même année, le géologue autrichien Ami Boué (1794-1881) exhuma des lœss anciens, qui affleurent près de Lahr sur les rives du Rhin, un autre squelette humain qu'il considéra comme fossile puisqu’il était également associé à des restes d'animaux disparus. Cuvier rejeta les conclusions d'Ami Boué, estimant que les os humains pouvaient provenir d'anciens cimetières. Au vrai, l'illustre paléontologiste venait de publier son fameux Discours sur les révolutions de la surface du globe où il niait l'existence des hommes fossiles, du moins en Europe, alors même que plusieurs naturalistes du midi de la France, tels que François Benit Vatar de Jouannet, Marcel de Serres, Jules de Christol et Tournal découvraient à leur tour, dans des remplissages de grottes, de nouveaux restes humains associés à des os d'animaux éteints. Cuvier, mort en 1832, ne connaîtra pas les fouilles mémorables du médecin et paléontologue Philippe-Charles Schmerling qui, durant plusieurs années, s'était consacré à l'exploration méthodique des grottes à ossements des environs de Liège. Le mémoire de Schmerling, très détaillé tomba rapidement dans l'oubli ; son auteur venait pourtant d'établir les preuves de l'existence de l'homme fossile. En dépit de ces témoignages successifs, nul n'imaginait encore l’ancienneté de tous ces vestiges que l'on venait tour à tour d'exhumer. En réalité, comme l'affirmait Tournal, la géologie seule pouvait désormais « donner quelques notions sur l'époque de la première apparition de l'homme ».
- 1. Des pierres de foudre à l’archéologie préhistorique
- 2. Les premiers hommes fossiles
- 3. L’homme antédiluvien
- 4. La découverte de l’homme de Néandertal et de la race de Cro-Magnon
- 5. « Le chaînon manquant » du singe à l’homme
- 6. L’homme de Piltdown et la théorie des présapiens
- 7. Le berceau de l’humanité se promène : de l’Asie vers l’Afrique
- 8. Bibliographie
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Herbert THOMAS : sous-directeur honoraire au Collège de France
Classification
Pour citer cet article
Herbert THOMAS. PALÉOANTHROPOLOGIE ou PALÉONTOLOGIE HUMAINE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
AFRIQUE (Histoire) - Préhistoire
- Écrit par Augustin HOLL
- 6 326 mots
- 3 médias
Les recherches sur les origines de l'humanité sont pluridisciplinaires par nécessité et se composent d'une vaste panoplie dedisciplines faisant partie de ce que l'on peut appeler la « nébuleuse paléoanthropologie ». La branche archéologique se concentre sur l'étude des produits des activités hominidés/humaines... -
AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géographie
- Écrit par Jacqueline BEAUJEU-GARNIER, Danièle LAVALLÉE, Catherine LEFORT
- 18 105 mots
- 9 médias
Aucun anthropoïde actuel ou fossile qui puisse être ancêtre ou cousin d'un rameau humain n'a jamais été découvert en Amérique, où les plus anciens restes humains retrouvés ne remontent guère au-delà de 10 000 ou 11 000 ans et appartiennent presque tous à la variété mongoloïde de ... -
ARCHÉOLOGIE (Archéologie et société) - Aménagement des sites
- Écrit par Jean-Pierre MOHEN, Jean-François REYNAUD
- 5 946 mots
- 3 médias
Le chantier de fouilles ouvert en 1964 par Henry de Lumley dans la Caune de l'Arago (Pyrénées-Orientales) continue à être décapé. On y a trouvé plus de cent vestiges humains dont le crâne de l'homme de Tautavel « le premier Français », vieux de 400 000 ans. Le matériel archéologique est... -
ATAPUERCA, site préhistorique
- Écrit par Jean-Jacques HUBLIN
- 1 049 mots
Les gisements du complexe d'Atapuerca en Espagne ont acquis une renommée mondiale à la suite des découvertes qui y ont été faites à partir de 1980. Ces sites ont apporté des informations d'une importance exceptionnelle sur les premiers peuplements de l'Europe et sur l'origine des ...
- Afficher les 78 références
Voir aussi
- ANTHROPOLOGIE PHYSIQUE
- EUROPE, histoire
- CATASTROPHISME
- FOUILLES, archéologie
- SCIENCES HISTOIRE DES, XVIIe et XVIIIe s.
- SCIENCES HISTOIRE DES, XIXe s.
- ORIGINES DE L'HOMME
- CRO-MAGNON HOMME DE
- TERTIAIRE ÈRE
- SILEX
- SINGES
- AFRIQUE, préhistoire
- WADJAK ou WAJAK HOMME DE
- TRANSFORMISME
- PITHÉCANTHROPE
- AUSTRALOPITHÈQUES
- AUSTRALIE, NOUVELLE-GUINÉE & TASMANIE, préhistoire et archéologie
- LITHIQUES INDUSTRIES
- SQUELETTE HUMAIN
- PALÉOANTHROPOLOGIE HISTOIRE DE LA
- TRINIL SITE PRÉHISTORIQUE DE, Java