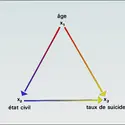FOURIER JOSEPH (1768-1830)
C'est surtout grâce à la série et à l'intégrale qui portent son nom que le mathématicien français Joseph Fourier est connu du mathématicien et du physicien modernes ; mais il a aussi amélioré les techniques d'approximation des racines des équations polynomiales. En fait, ses intérêts furent des plus variés, allant de la physique expérimentale à l'égyptologie.
Jusqu'à l'âge de quarante-sept ans, il partage son temps entre de lourdes tâches administratives et son amour des sciences exactes. Il enseigne quelques années à l'École polytechnique, puis, vers la fin de sa vie, est secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Son influence est alors grande sur une génération de jeunes mathématiciens, tels Charles Sturm, Ostrogradsky, Lejeune-Dirichlet et Liouville.
Éléments biographiques
Issu d'un milieu pauvre d'Auxerre, Fourier demeure longtemps inconnu des milieux scientifiques parisiens. Lorsque, en 1789, il envoie à l'Académie un mémoire sur l'approximation des racines des équations polynomiales, la tourmente révolutionnaire voue à l'échec cette première tentative de faire connaître ses travaux. D'ailleurs, la Révolution faillit être très funeste à sa propre personne. Fourier s'éloigne de sa ville natale pour suivre les cours de l'École normale de l'an III. Il s'y fait remarquer de Monge, Laplace et Lagrange et, à la fondation de l'École polytechnique, il est nommé assistant de Lagrange ; il lui succédera en 1797. Ses recherches suivent la variété de ses enseignements : des équations numériques à la mécanique rationnelle. En 1798, il accompagne le corps expéditionnaire français en Égypte et manifeste un vif intérêt pour les monuments antiques et leur interprétation, pour le calcul des erreurs d'observations et pour la statistique. En août 1799, il devient administrateur civil de l'Égypte.
De retour en France en 1802, il est nommé par Napoléon préfet à Grenoble. Bon diplomate, Fourier réussit à harmoniser les différentes tendances politiques en présence. Mais le préfet consciencieux reste géomètre. En 1804, il prépare une publication de ses travaux sur les équations numériques qui ne paraîtra que plus tard. Peu après, il édifie sa théorie de la propagation de la chaleur et, en 1807, présente sur ce sujet un mémoire à l'Académie, mémoire que celle-ci couronnera en 1812. À la suite de son attitude ambiguë lors des événements de 1814-1815, il revient à Paris totalement démuni. Heureusement, nommé directeur du Bureau de la statistique du département de la Seine, il peut s'adonner plus librement à ses activités scientifiques. Ce n'est qu'alors qu'il commence à publier régulièrement : théorie de la chaleur, équations numériques, statistiques. En avril 1816, le roi refuse d'entériner son élection comme académicien libre. Il acceptera pourtant, le 21 mai 1817, d'entériner une nouvelle élection, nommant ainsi Fourier membre de la section de physique. Celui-ci fait alors partie de la communauté scientifique et, quelques mois après avoir publié son œuvre majeure, Théorie analytique de la chaleur, devient en 1822 secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Il meurt, le 16 mai 1830, laissant près de soixante publications dont une, inachevée, l'Analyse des équations déterminées.
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Louis CHARBONNEAU : professeur de mathématiques à l'université du Québec, Montréal
Classification
Pour citer cet article
Louis CHARBONNEAU. FOURIER JOSEPH (1768-1830) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Autres références
-
REMARQUES GÉNÉRALES SUR LES TEMPÉRATURES DU GLOBE TERRRESTRE ET DES ESPACES PLANÉTAIRES (M. Fourier)
- Écrit par Jean-Louis DUFRESNE
- 988 mots
- 1 média
L’article intitulé « Remarques générales sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires » du mathématicien et physicien français Joseph Fourier (1768-1830) est reconnu comme étant la première publication scientifique à expliciter ce qu’on appelle aujourd’hui l’effet...
-
THÉORIE ANALYTIQUE DE LA CHALEUR (J. Fourier)
- Écrit par Bernard PIRE
- 318 mots
- 1 média
Joseph Fourier (1768-1830) a entrepris son étude de la propagation de la chaleur dès 1804 alors qu'il occupait le poste de préfet de l'Isère après avoir brièvement enseigné à l’École polytechnique puis suivi le corps expéditionnaire français en Égypte et y avoir été nommé administrateur civil...
-
ÂGE DE LA TERRE
- Écrit par Pascal RICHET
- 5 143 mots
- 5 médias
Un des effets les plus notables du problème cosmologique soulevé par Buffon fut d’inciter Joseph Fourier (1768-1830) à élaborer sa célèbre théorie de la propagation de la chaleur, dans laquelle il introduisit une distinction fondamentale entre les capacités qu’avait une substance de conduire... -
CALCUL ET RATIONALISATION - (repères chronologiques)
- Écrit par Pierre MOUNIER-KUHN
- 725 mots
1623 L'astronome allemand Wilhelm Schickard invente une « horloge à calcul ». Mais celle-ci disparaît dans un incendie et Schickard ne poursuit pas ce projet qui n'aura donc aucune influence historique.
1637 René Descartes, dans le Discours de la méthode, définit la méthode rationnelle...
-
CAUSALITÉ
- Écrit par Raymond BOUDON, Marie GAUTIER, Bertrand SAINT-SERNIN
- 12 987 mots
- 3 médias
...leur mode essentiel de production » (Cours de philosophie positive, 28e leçon). Cette critique de l'idée de cause va trouver dans les travaux de Joseph Fourier sur La Théorie analytique de la chaleur (1822) une caution essentielle. Le grand physicien observe, en effet : « Les causes primordiales... -
CHANGEMENT ANTHROPIQUE DU CLIMAT
- Écrit par Jean-Louis DUFRESNE, Céline GUIVARCH
- 8 203 mots
- 7 médias
Au début du xixe siècle, Joseph Fourier (1768-1830) établit que la température de la surface de la Terre dépend, d’une part, de la quantité de rayonnement solaire absorbé et, d’autre part, de la façon dont la Terre se refroidit en émettant du rayonnement infrarouge vers l’espace. Il mentionne que... - Afficher les 8 références
Voir aussi