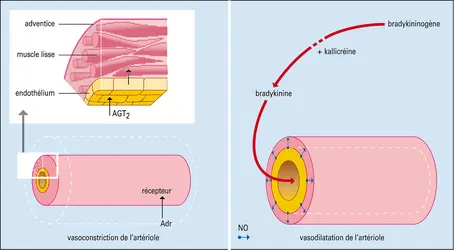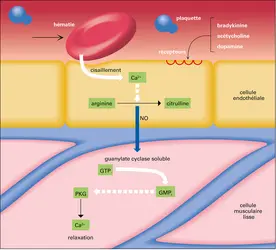HYPERTENSION
Thérapeutique
L'appréciation du risque cardio-vasculaire individuel
La notion de risque cardio-vasculaire, établie depuis plusieurs décennies, permet d'évaluer la probabilité que survienne chez un sujet donné un accident vasculaire cérébral ou un accident coronarien (angine de poitrine ou infarctus du myocarde). Cette probabilité est calculée sur la base des paramètres non modifiables, tels que l'âge, le sexe, la notion familiale d'accidents cardio-vasculaires prématurés, d'une part, et sur les paramètres modifiables par l'intervention médicale, tels que l'exposition au tabac, l'hypertension artérielle, le diabète et le niveau de cholestérol sanguin, d'autre part. Les différentes formules utilisées permettent d'établir le risque cardio-vasculaire absolu et relatif, qui représentent respectivement la probabilité d'avoir un accident lorsque les facteurs de risque sont absents (risque absolu) ou lorsqu'ils sont présents (risque relatif). On peut donc, pour un sujet donné, calculer le surcroît de risque lié à la présence du ou des facteurs de risque. Cette approche peut éclairer le pronostic et orienter la prise en charge thérapeutique. Les résultats actuellement observés – après utilisation d’agents hypocholestérolémiants chez, des sujets normo- ou hypercholestérolémiques, viennent confirmer l'intérêt de l'intervention sur les facteurs de risque, tels que l'hypertension, le diabète ou l'hypercholestérolémie. Ils confortent, chez les médecins traitants le souci de fixer des objectifs intermédiaires, tels que le contrôle du paramètre clinique (la pression artérielle) ou métabolique (le niveau de glycémie ou celui du cholestérol), pour l'objectif à long terme que constitue la prévention des maladies cardio-vasculaires.
La surveillance du traitement antihypertenseur
L'efficacité du traitement antihypertenseur est attestée par la baisse tensionnelle enregistrée lors de la mesure chez le médecin traitant. Dans les dernières années, deux techniques alternatives de mesure de la pression artérielle ont été développées. Il s'agit de la mesure ambulatoire de pression artérielle (ou M.A.P.A.) et de l'automesure tensionnelle. Ces deux techniques, bien que connues depuis plusieurs décennies, ont bénéficié d'innovations technologiques, telles que la miniaturisation des appareils de mesure et l'amélioration de l'autonomie des batteries les équipant.
La M.A.P.A. permet de répéter, à intervalles réguliers, les mesures tensionnelles durant vingt-quatre heures. Un enregistrement va donc comprendre plusieurs dizaines de mesures prises en vingt-quatre heures, en période d'activité (diurne) et en période de repos (nocturne). Le résultat est exprimé en moyennes sur ces deux périodes d'activité et de repos. Cette technique renseigne sur l'effet du traitement et sur l'importance et la régularité de celui-ci au cours des vingt-quatre heures.
L' automesure à domicile a également bénéficié des mêmes progrès techniques. Grâce à la standardisation des protocoles de mesure, le même type d'information peut être obtenu sur l'effet rémanent des traitements à distance de la prise médicamenteuse. À l'inverse de la M.A.P.A., qui est plus passive, cette technique fait intervenir directement le patient, qui mesure lui-même sa pression artérielle, à des horaires prédéterminés. Les mesures ont lieu le plus souvent le matin, vingt-quatre heures après la dernière prise du traitement en cas de prise monoquotidienne, et le matin et le soir, lorsque le traitement est administré en deux prises par jour. Dans tous les cas, ces techniques ont l'avantage de s'affranchir de l'effet lié à la présence du médecin, dit « effet blouse blanche », connu pour augmenter artificiellement le niveau tensionnel. Les chiffres donnés par M.A.P.A. ou par automesure reflètent[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Xavier JEUNEMAITRE : praticien hospitalier à l'hôpital Broussais, maître de conférences à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie
- Jacques JULIEN : ancien chef de clinique, assistant des Hôpitaux
- Jean-Baptiste MICHEL : docteur en médecine, docteur ès sciences, directeur de recherche
Classification
Pour citer cet article
Xavier JEUNEMAITRE, Jacques JULIEN et Jean-Baptiste MICHEL. HYPERTENSION [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
ADRÉNALINE
- Écrit par Jacques HANOUNE
- 3 565 mots
- 2 médias
...phéochromocytome. Il s'agit d'une tumeur développée à partir du tissu chromaffine surrénalien et qui est responsable de 0,5 p. 100 des cas d' hypertension artérielle. Le traitement est uniquement chirurgical, avec un bon pronostic. Le modèle du phéochromocytome a conduit à rechercher des anomalies... -
ARTÉRIOSCLÉROSE
- Écrit par Universalis
- 316 mots
Maladie artérielle se présentant sous trois formes principales : l'artériosclérose de l'intima ou athérosclérose, dans laquelle des plaques graisseuses (dites d'athérome) se déposent dans la partie la plus interne des vaisseaux sanguins ; l'artériosclérose de Mönckeberg...
-
ATHÉROSCLÉROSE
- Écrit par Loïc CAPRON
- 5 353 mots
- 1 média
...mieux établi dans l'athérosclérose est le cholestérol : on diminue le risque de la maladie coronaire en traitant l'hypercholestérolémie. Diabète et hypertension artérielle ont accédé plus récemment au rang d'authentiques facteurs de risque : ce sont des anomalies dont la correction améliore le pronostic... -
CŒUR - Maladies cardio-vasculaires
- Écrit par Jean-Yves ARTIGOU, Yves GROSGOGEAT, Paul PUECH
- 16 174 mots
- 4 médias
Les maladies du cœur ( cardiopathies) et celles des vaisseaux représentent actuellement en France et dans les pays industrialisés la première cause de mortalité, avant le cancer et les accidents de la circulation. Au cours des dernières décennies, le profil général des maladies cardio-vasculaires s'est...
- Afficher les 17 références
Voir aussi
- SYSTOLE
- RÉNINE
- DIASTOLE
- ANGIOTENSINE
- ARTÈRES
- TENSION ARTÉRIELLE
- VASODILATATION
- VASOCONSTRICTION
- GMP CYCLIQUE
- MONOXYDE D'AZOTE
- HÉRÉDITAIRES MALADIES ou MALADIES GÉNÉTIQUES
- CORTISOL ou HYDROCORTISONE
- MÉDULLOSURRÉNALE
- CATÉCHOLAMINES
- PRESSION SANGUINE
- NO-SYNTHASE
- INOSITOL TRIPHOSPHATE (IP3)
- HYPERTENSION RÉNOVASCULAIRE
- MAPA (mesure ambulatoire de pression artérielle)
- ANTIHYPERTENSEURS
- INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION
- LIDDLE SYNDROME DE
- ULICK SYNDROME DE
- DÉBIT SANGUIN
- AMILORIDE
- CANALOPATHIES
- ADÉNOSINE
- SODIUM, biologie
- RÉGULATION BIOLOGIQUE
- POLYKYSTOSE RÉNALE
- HYPERALDOSTÉRONISME
- ARTÉRIOLES
- PHOSPHOLIPASES
- AUTOMESURE TENSIONNELLE
- DIURÉTIQUES
- FACTEUR DE RISQUE, épidémiologie
- LIAISON GÉNÉTIQUE
- RECOMBINAISON GÉNÉTIQUE
- CONTRACTION MUSCULAIRE
- SIGNAL, biologie
- CALCIUM & MÉTABOLISME CELLULAIRE
- ENZYMOPATHIES
- ADÉNYLATE CYCLASE ou ADÉNYLCYCLASE ou ADÉNYLYL CYCLASE
- CARDIO-VASCULAIRES MALADIES
- ENDOTHÉLIUM VASCULAIRE
- ALPHA-ADRÉNERGIQUES RÉCEPTEURS
- GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE
- ENREGISTREMENTS PHYSIOLOGIQUES
- ANTICALCIQUES MÉDICAMENTS ou INHIBITEURS CALCIQUES
- CIRCULATION SANGUINE
- RÉSISTANCE VASCULAIRE
- VAISSEAUX SANGUINS
- HÉMODYNAMIQUE
- ENZYME DE CONVERSION
- FACTEURS DE RISQUE CARDIO-VASCULAIRE
- POMPE CARDIAQUE
- SECOND MESSAGER, biologie
- RÉABSORPTION, physiologie
- NUCLÉOTIDES CYCLIQUES
- RÉCEPTEURS MEMBRANAIRES
- MÉDECINE PRÉVENTIVE ET PRÉVENTION MÉDICALE
- TUBULE RÉNAL
- LISSES MUSCLES
- RELAXATION MUSCULAIRE
- GUANYLATE CYCLASE ou GUANYLYL CYCLASE
- PROTÉINES KINASES
- PRÉDISPOSITION GÉNÉTIQUE ou SUSCEPTIBILITÉ GÉNÉTIQUE AUX MALADIES
- ANGIOTENSINOGÈNE
- HÉRITABILITÉ