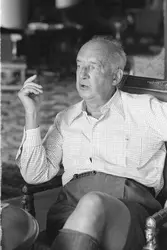ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (Arts et culture) La littérature
- 1. Le problème des origines
- 2. Les thèmes spécifiquement américains
- 3. Du puritanisme au transcendantalisme : une tradition spirituelle et intellectuelle
- 4. Naissance de l'historiographie américaine
- 5. La poésie au XXe siècle
- 6. Le Sud
- 7. La littérature afro-américaine
- 8. Les littératures latinas des États-Unis
- 9. Littératures des minorités
- 10. Bibliographie
Littératures des minorités
« J'ai décidé un jour d'écrire l'histoire des immigrants en Amérique. J'ai découvert alors que les immigrants étaient l'histoire de l'Amérique. » Cette formule lapidaire d'Oscar Handlin dans The Uprooted (1951) a le mérite de résumer la formation de la nation américaine mais le défaut de masquer la complexité du problème.
L'asservissement des Noirs, l'ethnocide des Indiens – péchés originels de la nation – constituent la conscience malheureuse de l'Amérique et structurent, explicitement ou non, sa pensée et sa création.
Les souvenirs des vagues d'immigration qui ont déposé sur les côtes du Nouveau Monde les alluvions bigarrées de populations diverses – fierté de la nation – modèlent d'une toute autre façon le rêve américain.
Vint un temps où l'Indien, le Noir, l'immigré et ses descendants cessèrent d'être uniquement objets de l'écriture pour en devenir les sujets. Ils prirent la parole pour dire leur univers tant matériel qu'émotionnel, imaginaire et symbolique.
Les immigrés le firent d'abord dans leurs idiomes natifs. Ainsi se développèrent sur le sol américain une presse, des maisons d'édition, des théâtres qui diffusèrent les œuvres de créateurs qui, tout en vivant aux États-Unis, continuaient à produire dans leurs langues d'origine. Mais, parallèlement, se dégageaient, au sein même de la littérature « américaine », des littératures minoritaires dans la langue hégémonique. Celles-ci relevaient de trois ensembles : la société d'origine, la société d'insertion et la société minoritaire, résultante du rapport dialectique entre les deux premières.
L'un des obstacles qui s'est longtemps opposé à la reconnaissance de ces littératures est leur utilisation de l'américain. C'est là en effet un des problèmes cruciaux auxquels se heurte toute production minoritaire. Pourtant, dans la mesure où toute écriture est nécessairement le « produit de l'homogénéité du dire et du vivre » (H. Meschonnic), elle ne peut qu'intégrer et assimiler, suivant des processus qui lui sont propres, les divers espaces culturels et linguistiques, même résiduels (souvenirs réels ou imaginaires, mémoires fragmentées), auxquels l'auteur appartient.
Le second obstacle tient au seuil numérique à partir duquel on est en droit de parler de la naissance ou de l'éclosion d'une littérature minoritaire. Un auteur isolé, minoritaire ou immigré, quel que soit son génie (Nabokov ou Kazan, par exemple) ne peut fonder le phénomène à lui seul.
La littérature, comme la langue, est le fruit d'un producteur collectif : le changement quantitatif entraîne un changement qualitatif et transforme la nature même du fait. L'abondance des créateurs au sein d'une société minoritaire traduit sa volonté, consciente ou inconsciente, d'exister.
Aussi les études consacrées à ces littératures sont-elles encore peu nombreuses. Il s'agit en outre de capter un phénomène éminemment variable, soumis aux changements du contexte politique et historique international (tels les flux migratoires) et national (situation économique et politique, caractère plus ou moins assimilationniste ou exclusif de la société d'accueil). Par ailleurs, la capacité de maintenir une existence aussi bien institutionnelle et culturelle que littéraire au sein d'une société majoritaire diffère d'un groupe à l'autre.
Parmi ces auteurs, certains ont une inspiration et une audience purement minoritaires, créant l'équivalent d'une sorte de littérature régionaliste ; d'autres, au contraire, utilisent des matériaux, puisent à des sources culturelles spécifiques et atteignent l'universel à travers le particulier.
Le naturalisme tourmenté des écrivains[...]
- 1. Le problème des origines
- 2. Les thèmes spécifiquement américains
- 3. Du puritanisme au transcendantalisme : une tradition spirituelle et intellectuelle
- 4. Naissance de l'historiographie américaine
- 5. La poésie au XXe siècle
- 6. Le Sud
- 7. La littérature afro-américaine
- 8. Les littératures latinas des États-Unis
- 9. Littératures des minorités
- 10. Bibliographie
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Marc CHÉNETIER : agrégé de l'Université, docteur ès lettres, professeur de littérature américaine à l'université d'Orléans
- Rachel ERTEL : professeur des Universités
- Yves-Charles GRANDJEAT : professeur des Universités à l'université Bordeaux-Montaigne
- Jean-Pierre MARTIN : professeur d'histoire et civilisation des États-Unis à l'université de Provence
- Pierre-Yves PÉTILLON : professeur de littérature américaine à l'université de Paris IV-Sorbonne et à l'École normale supérieure
- Bernard POLI : auteur
- Claudine RAYNAUD : professeure des Universités
- Jacques ROUBAUD : écrivain
Classification
Pour citer cet article
Marc CHÉNETIER, Rachel ERTEL, Yves-Charles GRANDJEAT, Jean-Pierre MARTIN, Pierre-Yves PÉTILLON, Bernard POLI, Claudine RAYNAUD et Jacques ROUBAUD. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (Arts et culture) - La littérature [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Voir aussi
- CAHAN ABRAHAM dit ABE (1860-1951)
- DORT SYNODE DE (1619)
- FANTE JOHN (1911-1983)
- PRICE REYNOLDS (1933-2011)
- TOOLE JOHN KENNEDY (1937-1969)
- TYLER ROYALL (1757-1826)
- WALKER MARGARET (1915-1998)
- DE CAPITE MICHAEL
- MCSORLEY EDWARD (1902-1966)
- PANUNZIO CONSTANTINE M. (1884-1964)
- SULLIVAN J. W.
- THORPE THOMAS BANG (1815-1878)
- DIASPORA JUIVE
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, droit et institutions
- IRLANDAISES LANGUE & LITTÉRATURE
- MÉTISSAGE
- MINORITÉS
- PRÉDICATION
- MIGRATIONS HISTOIRE DES
- AMÉRICAINE LITTÉRATURE
- MASON-DIXON LIGNE
- INDÉPENDANCE AMÉRICAINE GUERRE DE L'
- ÉGLISES & SECTES
- HISPANO-AMÉRICAINE LITTÉRATURE
- YIDDISH LANGUE ET LITTÉRATURE
- YIDDISH THÉÂTRE
- CHICANOS
- CANADA, histoire jusqu'en 1968
- HIJUELOS OSCAR (1951-2013)
- DANTICAT EDWIGE (1969- )
- CHRONIQUE
- IMMIGRATION
- NATURE IDÉE DE
- ART NÈGRE
- JUIVE LITTÉRATURE
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, des origines à 1865
- AMÉRINDIENS ou INDIENS D'AMÉRIQUE, Amérique du Nord
- JUIF HISTOIRE DU PEUPLE
- MEXICAINE LITTÉRATURE
- AMÉRICAIN THÉÂTRE
- CARAÏBES ou ANTILLES LITTÉRATURES DES
- AFRO-AMÉRICAINE LITTÉRATURE
- CRÈVECŒUR HECTOR SAINT-JOHN DE (1735-1813)
- HISTORIOGRAPHIE AMÉRICAINE
- RHODE ISLAND
- READING, poésie américaine
- REXROTH KENNETH (1903-1982)
- JOHNSON EDWARD (1598-1672)
- PARKMAN FRANCIS (1823-1893)
- WINTHROP L'AÎNÉ JOHN (1587-1649) & WINTHROP LE JEUNE JOHN (1638-1707)
- ANTIN DAVID (1932-2016)
- BLACKBURN PAUL (1926-1971)
- CORMAN CID (1924- )
- MATHEWS HARRY (1930-2017)
- O'HARA FRANK (1926-1966)
- OBJECTIVISTES, poésie américaine
- RAKOSI CARL (1910-2004)
- REZNIKOFF CHARLES (1898-1980)
- ROTHENBERG JEROME (1931- )
- SPICER JACK (1925-1965)
- WALDROP ROSEMARIE (1932- )
- LONGSTREET AUGUSTUS BALDWIN (1790-1870)
- TOOMER JEAN (1894-1967)
- MATTHEWS JAMES BRANDER (1852-1929)
- ÉCRITURES LES
- ROMANTISME, littérature
- DROITS POLITIQUES
- AFRO-AMÉRICAINS ou NOIRS AMÉRICAINS
- DÍAZ JUNOT (1968- )
- ALVAREZ JULIA (1950- )
- SANTIAGO ESMERALDA (1948- )
- CASTILLO ANA (1953- )
- LATINOS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
- ANZALDÚA GLORIA (1942-2004)
- RODRIGUEZ RICHARD (1944- )
- VILLARREAL JOSÉ ANTONIO (1924-2010)
- FAUSET JESSIE REDMON (1882-1961)
- LARSEN NELLA (1891-1964)
- MINSTREL SHOW
- BLACK LIVES MATTER