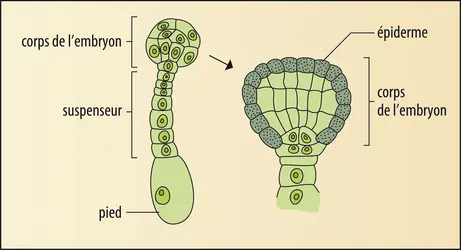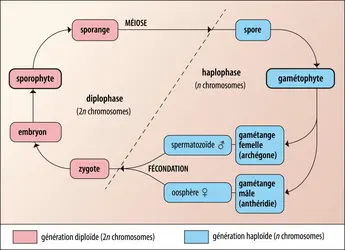EMBRYOPHYTES ou CORMOPHYTES ou ARCHÉGONIATES
Diversité écologique des Embryophytes
En tant qu’organismes terrestres, les Embryophytes sont normalement adaptées à la vie hors de l’eau. Ce sont des organismes fixés au sol par des rhizoïdes (chez les Hépatiques, Anthocérotes et Bryophytes) ou des racines (chez les Trachéophytes). Les rhizoïdes sont des émergences épidermiques sans tissus conducteurs tandis que les racines sont des organes vascularisés. Racines et rhizoïdes ont la double fonction d’ancrage et d’absorption de l’eau et des minéraux. Au niveau de l’appareil aérien, les échanges gazeux (absorption de l’oxygène et rejet du dioxyde de carbone pour la respiration ; absorption du dioxyde de carbone et rejet de l’oxygène pour la photosynthèse) sont effectués via des pores aérifères (chez les grandes Hépatiques thalloïdes) ou des stomates (chez les Trachéophytes, et au niveau des sporophytes des Anthocérotes et de quelques mousses). Chez les formes ayant perdu la cuticule (plantes aquatiques notamment), les stomates peuvent disparaître et les échanges gazeux se font alors directement par l’épiderme. Via les pores et les stomates, les plantes terrestres perdent également de l’eau par évapotranspiration. Pour éviter la dessiccation, l’eau perdue doit être compensée par son absorption au niveau du sol.

Diversité écologique des Angiospermes
Ton Bangkeaw/ Shutterstock (en haut à droite) ; Jean-Yves Dubuisson
Dans des conditions hydriques dites normales, il y a suffisamment d’eau dans le sol pour compenser les pertes dues à l’évapotranspiration. Or les plantes terrestres ont colonisé tous les milieux continentaux et les habitats les plus variés, des plus humides aux plus secs, hormis les déserts hyperarides ou polaires. De nombreux groupes sont même aquatiques, majoritairement dulçaquicoles, parfois adaptés aux milieux saumâtres. Certaines Angiospermes sont pleinement marines, comme les posidonies. Des adaptations ont donc été sélectionnées pour survivre à l’excès ou au manque d’eau, et elles illustrent et expliquent autant la diversité écologique que celle morphologique liée aux adaptations. Ainsi, on observe de nombreuses régressions chez les Embryophytes aquatiques ou des milieux très humides : perte de la cuticule et régression des racines, des tissus conducteurs ou de soutien, comme on peut l’observer chez l’Angiosperme cératophylle. Les Embryophytes vivant dans les milieux à saison sèche et les semi-déserts limitent les pertes en eau via des cuticules épaisses, des stomates protégés, des poils épidermiques plus ou moins denses, voire la régression des feuilles au niveau desquelles l’évapotranspiration se fait préférentiellement. L’eau peut également être stockée dans des organes hypertrophiés dits succulents, comme on peut l’observer chez les cactus. D’autres adaptations (souvent physiologiques) ont permis à certains groupes de coloniser les milieux salés, ou riches en métaux lourds, ou encore hyperacides. Certaines Embryophytes poussent sur d’autres plantes sans les parasiter, ce sont des épiphytes, comme de nombreuses orchidées tropicales ; d’autres sont pleinement parasites des autres plantes et peuvent à ce titre perdre leur capacité photosynthétique, comme les Angiospermes orobanches.
La diversité morphologique, liée à la diversité des adaptations et donc des types écologiques, explique ainsi la grande variété des Embryophytes, des écosystèmes et des paysages terrestres qu’elles façonnent depuis plus de 450 millions d’années.
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean-Yves DUBUISSON : professeur des Universités, Sorbonne université
- Sabine HENNEQUIN : maître de conférences, Sorbonne université
Classification
Pour citer cet article
Jean-Yves DUBUISSON et Sabine HENNEQUIN. EMBRYOPHYTES ou CORMOPHYTES ou ARCHÉGONIATES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
EUCARYOTES (CHROMOSOME DES)
- Écrit par Denise ZICKLER
- 7 721 mots
- 9 médias
...(faux-bourdon) alors que les diploïdes sont des femelles (la différenciation entre reine fertile et ouvrière stérile est liée à la nutrition embryonnaire). Chez les plantes supérieures, on peut dans certaines espèces induire le développement de plantes monoploïdes à partir de grains de pollen. Ces plantes... -
ALGUES
- Écrit par Bruno DE REVIERS
- 4 869 mots
- 9 médias
Comme les embryophytes – souvent nommées plantes terrestres et qui regroupent, au sens large, les mousses, les fougères et les plantes à graines –, les algues possèdent de la chlorophylle. Ce pigment vert permet aux algues et aux embryophytes de fabriquer (synthétiser) de la matière vivante à partir... -
ANTHÉRIDIES & ARCHÉGONES
- Écrit par Michel FAVRE-DUCHARTRE
- 957 mots
- 1 média
-
BOTANIQUE
- Écrit par Sophie NADOT, Hervé SAUQUET
- 5 647 mots
- 7 médias
- Afficher les 12 références
Voir aussi
- ZYGOTE
- ÉVAPOTRANSPIRATION
- CUTICULE
- FÉCONDATION
- DIPLOPHASE
- HAPLOPHASE
- GAMÉTANGE
- ZYGOSPORE
- SPORE
- OOSPHÈRE
- SPERMATOZOÏDE
- SPOROPHYTE
- VÉGÉTALE BIOLOGIE
- STOMATE
- TRACHÉOPHYTES
- MÉTAZOAIRES
- DIPLOÏDIE
- GAMÉTOPHYTE
- PHYLOGÉNIE ou PHYLOGENÈSE
- EMBRYON, botanique
- ANATOMIE ET MORPHOLOGIE VÉGÉTALE
- ADAPTATION BIOLOGIQUE
- CYTOLOGIE VÉGÉTALE
- MORPHOLOGIE, biologie
- VÉGÉTAL RÈGNE