PROPULSION AÉRONAUTIQUE
Des origines à la Seconde Guerre mondiale, l'essor de l'aviation a été associé à la propulsion par l'hélice. Suivant les possibilités technologiques apportées par d'autres branches d'activités, l'hélice fut mise en mouvement par un moteur à vapeur – cas des avions de Clément Ader –, puis par un moteur à combustion interne de plus en plus léger et puissant à la fois et, désormais, par une turbine à gaz.
Le fonctionnement de l'hélice s'inscrit dans le principe général de la propulsion par réaction, qui se matérialise plus souvent aujourd'hui sous la forme des turboréacteurs pour l'aviation et des fusées pour les applications spatiales.
L'hélice
L'hélice est composée d'un certain nombre de pales (de 2 à 6) fixées sur un moyeu tournant, chacune constituant une surface portante analogue à une aile d'avion. La pale change la direction de l'air, qui la contourne et lui transmet ainsi l'énergie reçue du moteur. En régime établi, l'hélice progresse à la vitesse de vol V0, brasse une quantité d'air Q, qui quitte les pales à une vitesse supérieure Vj. La force de traction exercée sur l'arbre de l'hélice est égale à la variation de la quantité de mouvement :
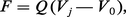
Les performances des hélices sont caractérisées par des coefficients de traction, de couple et d'efficacité propulsive qui varient en fonction de la vitesse de vol (cf. aérodynamique). Pour obtenir les meilleurs rendements dans toutes les phases du vol, le moyeu abrite un système d'engrenages permettant de faire pivoter les pales pour changer l'angle d'attaque de l'air brassé : c'est le pas variable.
L'efficacité du fonctionnement de l'hélice se dégrade lorsque les vitesses de l'écoulement sur les pales – à l'extrémité externe où la vitesse due à la rotation est la plus élevée – atteignent la vitesse du son, provoquant l'apparition d'ondes de choc génératrices de pertes. C'est pourquoi l'utilisation de l'hélice est limitée jusqu'à présent aux avions lents ne dépassant guère Mach 0,5 à Mach 0,7.
Les méthodes de calcul de mécanique des fluides extrêmement détaillées permettent maintenant d'accomplir des progrès considérables dans la maîtrise des écoulements, en particulier dans le domaine transsonique, et d'en déduire les formes adaptées des profils. Elles donnent une allure toute nouvelle aux pales, dont le nombre est plus élevé (de 8 à 12), et qui sont penchées vers l'arrière, à la manière des ailes d'avions en flèche. Ces hélices autorisent le vol jusqu'à Mach 0,75 avec des rendements acceptables. Ajoutons que les progrès accomplis sur les matériaux, notamment les composites, facilitent grandement la réalisation de ces hélices nouvelles.
Ainsi, l'hélice reste un moyen moderne et économique de propulsion des avions pour lesquels la vitesse n'est pas une exigence opérationnelle. Les appareils de transport militaires, par exemple, continueront à être équipés de turbopropulseurs comme l'avion européen A400M.
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean CALMON : ingénieur de l'École centrale des arts et manufactures, ancien directeur délégué technique et production de la S.N.E.C.M.A., membre et ancien président de l'Académie de l'air et de l'espace
Classification
Pour citer cet article
Jean CALMON. PROPULSION AÉRONAUTIQUE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Article mis en ligne le et modifié le 10/02/2009
Médias
Autres références
-
AVION BRITANNIQUE À RÉACTEUR
- Écrit par Bernard MARCK
- 234 mots
- 1 média
Le Gloster E 28-39, premier avion à réaction britannique, accomplit, le 15 mai 1941, au-dessus de Cranwell, son premier vol (17 min), piloté par Jerry Sawyer. Le moteur à réaction, ou turboréacteur, a été conçu par l'ingénieur et inventeur britannique Frank Whittle (1907-1996),...
-
BOEING 737
- Écrit par Bernard MARCK
- 1 054 mots
- 1 média
...versions peut transporter 108 passagers sur 5 550 kilomètres sans escale. Si le 737-500 utilise nombre d’éléments communs avec les autres Boeing 737, il est propulsé par deux moteurs CFM563, présents sur les versions 737-300 et 737-400. Autre avantage : les pilotes des Boeing 737-200, 737-300 ou 737400 n’ont... -
CARBURANTS
- Écrit par Daniel BALLERINI , Jean-Claude GUIBET et Xavier MONTAGNE
- 10 527 mots
- 9 médias
...destiné à plusieurs usages différents (alimentation des avions à réaction, emploi comme combustible de chauffage ou pour l'éclairage et la cuisine). Tous les avions à réaction utilisent du carburéacteur. Seuls les petits avions de tourisme à hélice utilisent un carburant appelé « essence avion »,... -
KÁRMÁN THEODORE VON (1881-1963)
- Écrit par Encyclopædia Universalis et Frank J. MALINA
- 974 mots
Ingénieur américain d'origine hongroise, né le 11 mai 1881 à Budapest, mort le 6 mai 1963 à Aix-la-Chapelle (R.F.A.).
Theodore von Kármán montre très tôt un don pour les mathématiques, mais son père l'incite à se diriger vers l'ingénierie. Diplômé de l'université technique de Budapest en...
- Afficher les 15 références





